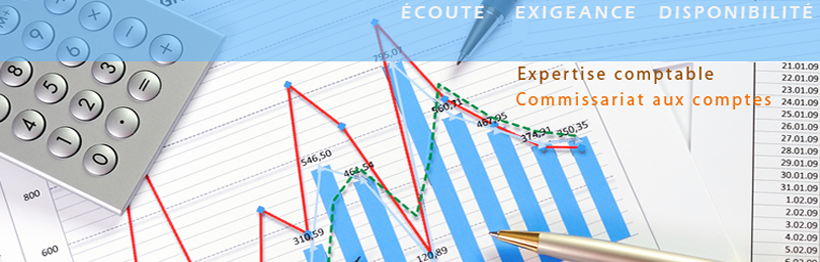Déloyauté du salarié : c’est l’intention qui compte !
Le salarié qui, pendant un arrêt de travail, tente d’exercer une activité concurrente à son employeur, peut être licencié pour avoir manqué à son obligation de loyauté.
Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418
Tous les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, y compris pendant la suspension de leur contrat de travail (arrêt de travail, congé sabbatique…). Une notion qui fait référence, en particulier, à la bonne foi, la discrétion, la confidentialité ou encore la non-concurrence. À ce titre, les juges ont déjà considéré comme étant déloyal un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait exercé une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un autre employeur. Et c’est aussi le cas du salarié qui, sans succès, entreprend des démarches dans ce sens. Explications.
Peu importe que l’activité concurrente ne soit pas effective
Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que peintre avait été placé en arrêt de travail. Pendant cet arrêt, il avait proposé à une autre entreprise d’effectuer, en qualité de sous-traitant, divers travaux de pose de bardage et de garde-corps ainsi que de maçonnerie. Des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés en raison du refus du « client ». Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, une sanction que le salarié avait contestée en justice.
Saisis du litige, les juges ont constaté que les prestations proposées par le salarié faisaient partie des travaux réalisés par son employeur. Ils en ont déduit qu’en proposant ses services à une société concurrente pendant son arrêt de travail, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Peu importe que l’activité n’ait finalement pas été réalisée. Son licenciement pour faute grave a donc été validé.
Dans les faits :
pour se défendre, le salarié avait prétendu que les propositions adressées à l’entreprise concurrente concernaient des travaux devant être réalisés après la rupture de son contrat de travail et avaient pour seul objectif de préparer sa future activité. Un argument écarté par les juges puisque ces propositions, mais aussi le refus du client, étaient intervenus avant la rupture du contrat de travail et que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner.
Évaluation des avantages en nature pour les véhicules électriques
La liste des véhicules électriques permettant de bénéficier d’un régime plus favorable lors de l’évaluation de l’avantage en nature véhicule accordé aux salariés vient d’être mise à jour.
Arrêté du 3 décembre 2025, JO du 4
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Quel que soit le type de véhicule mis à disposition (thermique, électrique...), l’avantage en nature est évalué, au choix de l’employeur :- soit sur la base des dépenses qu’il a réellement engagées ;- soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou, en cas de location du véhicule, de son coût global annuel.
Un régime de faveur pour les véhicules électriques
Pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et mis à la disposition des salariés depuis le 1er février 2025, le montant des dépenses pris en compte pour évaluer l’avantage en nature bénéficie, en 2025, d’un abattement de :- 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;- 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire.
Mais attention, cet abattement ne s’applique que pour les véhicules qui respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique.
La liste des véhicules concernés, fixée par arrêté , vient d’être récemment mise à jour. De plus, quatre nouveaux modèles de véhicules ont été ajoutés à cette liste depuis le 5 décembre 2025 :- MITSUBISHI Eclipse Cross (version RCBHE2J1EEA7L00KB0) ;- NISSAN LEAF (version ZE2AA01) ;- SKODA Elroq 85x (versions NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02N01BA et NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02V01BA).
Charge de travail excessive : attention à la démission !
La démission du salarié intervenue en raison d’une charge excessive de travail, dont l’employeur avait été informé, peut être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 13 novembre 2025, n° 23-23535
Le salarié qui souhaite démissionner doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Une démission que l’employeur doit examiner avec le plus grand intérêt, afin de s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou lorsqu’elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif. Ou encore, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation, lorsque la démission est liée à une surcharge de travail…
Surcharge de travail avérée = démission équivoque
Dans une affaire récente, un salarié avait démissionné de son emploi d’administrateur réseau qu’il exerçait auprès de son employeur depuis plus de 20 ans. Quelques mois plus tard, il avait demandé à la justice de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, autrement dit de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif qu’il avait été exposé à une charge de travail excessive, à laquelle son employeur n’avait pas remédié, le poussant ainsi à démissionner.
Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné tort au salarié. Ils avaient notamment estimé que la surcharge de travail du salarié, qui existait depuis de nombreuses années, ne pouvait pas être considérée comme une « circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite de la relation de travail ».
Mais la Cour de cassation, quant à elle, a constaté que le salarié avait, avant de démissionner, alerté sa hiérarchie, son employeur et le service de santé au travail de sa charge de travail excessive devenue pour lui « insupportable ». Une surcharge de travail qui l’empêchait de bénéficier d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et qui générait une charge mentale très élevée et permanente mal vécue personnellement. C’est pourquoi les juges ont considéré la démission du salarié comme étant équivoque, et « invité » les juges d’appel à requalifier la rupture du contrat de travail du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comment protéger vos salariés exposés au froid ?
Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid (gelures, assoupissements, crampes, hypothermie…).
Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier :- d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;- d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;- de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.
Précision :
ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.
Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une double carte nationale de vigilance (l’une pour la journée et l’autre pour le lendemain) et un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France .
Activités sociales et culturelles : ne tardez pas à supprimer la condition d’ancienneté
Les comités sociaux et économiques et les employeurs qui soumettent à une condition d’ancienneté l’accès des salariés aux activités sociales et culturelles ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour la supprimer sans perdre l’exonération de cotisations sociales qui y est associée.
Communiqué de l’Urssaf du 20 novembre 2025
L’Urssaf tolère que les prestations liées à des activités sociales et culturelles (bons d’achat, chèques-vacances, crèches, colonies de vacances, cours de sport, spectacles, etc.) octroyées aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de CSE, par l’employeur soient, sous certaines conditions, exonérées de cotisations et contributions sociales.
Jusqu’à l’année dernière, l’Urssaf considérait que le CSE ou l’employeur pouvaient soumettre l’accès à ces prestations à une condition d’ancienneté (dans la limite de 6 mois) sans que cette exonération soit remise en cause.
Mais, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation d’avril 2024 selon lequel l’accès aux prestations liées à des activités sociales et culturelles ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise, l’Urssaf avait revu sa position et décidé que l’exonération de cotisations sociales ne s’appliquait plus en présence d’une telle condition.
À noter :
dans un arrêt de mars 2025 , la Cour de cassation a précisé qu’une condition d’ancienneté ne pouvait pas non plus être mise en place pour réduire le montant des avantages accordés (dans cette affaire, des bons d’achat de Noël dont le montant différait selon l’ancienneté des salariés).
Une mise en conformité d’ici le 31 décembre 2025
L’Urssaf avait accordé aux CSE et aux employeurs qui appliquaient une condition d’ancienneté un délai de grâce pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Un délai qui se termine à la fin de l’année : les CSE et les employeurs ont donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour supprimer la condition d’ancienneté liée à l’accès aux prestations liées aux activités sociales et culturelles. À défaut, ils ne pourront plus bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
En pratique :
jusqu’à fin 2025, les CSE et employeurs qui appliquent une condition d’ancienneté ne font pas l’objet d’un redressement de cotisations en cas de contrôle Urssaf, mais doivent se mettre en conformité pour l’avenir.
Quelles aides pour les employeurs d’apprentis jusqu’à la fin de l’année ?
Les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2025 ouvrent droit pour les employeurs à une aide exceptionnelle de 2 000 ou 5 000 €. Des aides qui pourraient diminuer en 2026.

Les employeurs qui recrutent des apprentis bénéficient d’aides financières exceptionnelles qui sont régulièrement remaniées. Ainsi, le montant de ces aides, qui a été abaissé pour les contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025, pourrait de nouveau être revu à la baisse en 2026.
Jusqu’au 31 décembre 2025
Les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2025 en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, ouvrent droit pour l’employeur à une aide financière exceptionnelle, pour la première année d’exécution du contrat, de :- 5 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés ;- 2 000 € maximum pour celles d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).
À noter :
le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
Et à compter du 1er janvier 2026 ?
Le montant des aides qui seront octroyées aux employeurs pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2026 n’est pas encore connu.
Pour autant, selon le projet de loi de finances pour 2026, le budget qui leur est consacré devrait diminuer d’1 milliard d’euros par rapport à 2025 pour s’établir à environ 2,4 Md€ l’année prochaine. Il est donc possible que le montant des aides financières à l’apprentissage soit révisé afin, par exemple, de les concentrer sur les petites entreprises et/ou sur les premiers niveaux de diplôme (inférieur ou équivalent au bac).
En complément :
en lieu et place de l’aide exceptionnelle, les employeurs de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’apprentissage de 5 000 € (6 000 € pour un apprenti en situation de handicap) pour les contrats visant à l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat. Cette aide qui, elle, est pérenne sera-t-elle conservée en l’état par les pouvoirs public ? À suivre donc.
Les allègements de cotisations patronales réformés en 2026
La suppression des taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales s’appliqueront à compter du 1erjanvier 2026.
Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, JO du 5
Chose promise, chose due : les différents dispositifs d’allégement des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés fusionneront en 2026. Une réforme qui, selon le niveau de rémunération des salariés, se révèlera avantageuse, neutre ou défavorable pour les employeurs.
Précision :
cette réforme concernera les cotisations sociales patronales dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026.
La fin des taux réduits de cotisations
Actuellement, les employeurs bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) sur les rémunérations n’excédant pas 2,25 Smic (4 054,05 € bruts par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine) et du taux de la cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) sur les rémunérations qui ne dépassent pas 3,3 Smic (5 945,94 € bruts par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine).
À compter du 1er janvier 2026, ces réductions de taux seront purement et simplement supprimées.
Une nouvelle formule de la réduction générale des cotisations patronales
Une nouvelle formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales (RGCP) sera instaurée à compter du 1er janvier 2026, afin, notamment, de prendre en compte la suppression des réductions des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.
Cette nouvelle formule :
- s’appliquera aux rémunérations inférieures à 3 Smic (5 405,40 € bruts par mois en 2025), contre 1,6 Smic (2 882,88 € par mois en 2025) actuellement ;- garantira, pour chaque employeur, une réduction de cotisations minimale de 2 % pour les rémunérations inférieures à ce plafond.
Qui y gagne ?
Selon le niveau de rémunération des salariés, la réforme des allègements des cotisations sociales patronales pourra être avantageuse, neutre ou défavorable pour les employeurs. À ce titre, voici un tableau comparatif des allègements accordés aux employeurs de moins de 50 salariés en 2025 et 2026.
Précision :
le montant des allègements, calculés par nos soins, s’appuie sur la valeur du Smic horaire applicable en 2025, soit 11,88 € de l’heure. La RGCP de l’année 2026 est, elle, calculée en tenant compte de la fraction de la cotisation AT/MP actuellement comprise dans le champ de la réduction générale (soit 0,5 point). Le montant de la RGCP pour 2025 est, lui, calculé en utilisant le simulateur disponible sur le site de l’Urssaf .
Comparatif des allègements des cotisations sociales patronales 2025/2026*Rémunération mensuelle20252026Variation mensuelle 2025/2026Variation annuelle 2025/2026RGCPRéduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familialesTotalRGCP1 Smic1 801,80575,31140,53715,84715,86+0,02+0,241,3 Smic2 342,34287,64182,70470,34467,06-3,28-39,361,6 Smic2 882,880224,86224,86313,66+88,80+1 065,601,8 Smic3 243,240252,97252,97243,89-9,08-108,962 Smic3 603,600281,09281,09192,07-89,02-1 068,242,25 Smic4 054,050316,23316,23147,57-168,66-2 023,922,5 Smic4 504,50081,0881,08120,27+39,19+470,282,8 Smic5 045,04090,8190,81106,45+15,64+187,683 Smic5 405,40097,2997,290-97,29-1 167,483,3 Smic5 945,940107,03107,030-107,03-1 284,36*Comparatif réalisé pour les entreprises comptant moins de 50 salariés. Montants en euros.Attention :
des aménagements à la formule de calcul sont prévues pour certaines catégories de travailleurs comme les salariés affiliés à une caisse de congés payés (dans le bâtiment et les travaux publics ou le spectacle, par exemple) et ceux qui sont soumis à un régime d’heures d’équivalences (chauffeur routier longue distance, notamment).
Les activités associatives sont-elles compatibles avec un arrêt de travail ?
Pour participer à des activités associatives sans perdre le bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit y être autorisé par son médecin traitant.
Cassation civile 2e, 16 octobre 2025, n° 23-18113
Un salarié qui est en arrêt de travail reçoit, en principe, des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Un versement qui est notamment soumis à la condition qu’il s’abstienne de toute activité non autorisée par son médecin.
Aussi, le salarié en arrêt de travail qui participe à des activités associatives, y compris des activités de loisirs, a tout intérêt à obtenir l’autorisation préalable de son médecin s’il veut éviter d’avoir à rembourser les indemnités journalières qu’il perçoit. Illustration de cette situation dans un arrêt récent de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié travaillant comme réparateur de chaudière industrielle avait été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Pendant cet arrêt, il avait assuré la présidence de son club de pétanque et participé à plusieurs compétitions ainsi qu’à des assemblées générales.
Des indemnités journalières à rembourser
Informée de la situation, la Caisse primaire d’assurance maladie lui avait demandé de rembourser les indemnités journalières qu’il avait perçues. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé ce remboursement. En effet, le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale suppose que le salarié en arrêt de travail s’abstienne de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Or, dans cette affaire, le salarié avait poursuivi ses activités associatives sans demander l’autorisation de son médecin traitant.
Le salarié prétendait que son médecin l’avait autorisé à participer à des compétitions de pétanque puisqu’il lui avait délivré un certificat attestant de l’absence de contre-indications à la pratique de ce sport. Un argument qui a été rejeté par les juges car l’autorisation du médecin doit être expressément mentionnée dans l’arrêt de travail.
À noter :
la Cour d’appel de Rouen avait réduit le montant du remboursement de 9 850 € à 2 000 € en raison du faible nombre de manquements (14 en 20 mois), de la bonne foi du salarié et du fait que ses activités n’étaient pas de nature à aggraver son état de santé. Mais l’article du Code de la Sécurité sociale permettant aux tribunaux d’ajuster le montant de ce remboursement à l’importance des manquements commis par le salarié a depuis été supprimé.
Paiement trimestriel des cotisations sociales : optez d’ici fin décembre !
Les employeurs de moins de 11 salariés qui souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement en 2026 doivent en informer l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au plus tard le 30 décembre 2025.

Les employeurs versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, ceux employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.
Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2026, les employeurs doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont ils dépendent au plus tard le 30 décembre 2025.
Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2026, le 15 juillet 2026, le 15 octobre 2026 et le 15 janvier 2027.
Attention :
les employeurs qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.
À l’inverse, les employeurs de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2026, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, ils doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2025. Sinon, ils continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.
Cap sur les jours fériés de fin d’année
Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés de la fin de l’année dans les entreprises.

Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.
À savoir :
le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.
Jours travaillés ou jours chômés ?
Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Attention :
en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.
Quid de la rémunération des salariés ?
Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision :
pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Faire le pont est-il obligatoire ?
Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1er janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.
Exception :
votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.
Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
À savoir :
vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
Et si vos salariés sont en congé ?
Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.
Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…
Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.
Avec ou sans alcool ?
Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…
Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.
Attention :
l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.
En toute sécurité…
Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.
… et convivialité
Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.
En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.
Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?
Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.
Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593
Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.
Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique
Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail.
Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :- si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;- si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien.
C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.
Précision :
la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.
Pénalité pour absence de plan d’action sur l’égalité professionnelle
Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris celles qui ne sont pas dotées d’une section syndicale d’organisation représentative, doivent, sous peine d’une pénalité financière, mettre en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conseil d’État, 1er octobre 2025, n° 495549
Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent, en principe au moins tous les 4 ans, engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord, elles doivent établir un plan d’action annuel sur ce sujet.
Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action sont redevables d’une pénalité dont le montant maximum s’élève à 1 % des rémunérations versées.
Un plan d’action obligatoire en l’absence de section syndicale
Dans une affaire récente, une société n’ayant ni accord, ni plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait contesté en justice la pénalité financière qui lui avait été infligée par l’administration du travail. Elle soutenait, en effet, qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée puisqu’elle n’était pas dotée d’une section syndicale d’organisation représentative et, qu’en conséquence, elle n’était pas contrainte de mettre en place un accord, ni même un plan d’action sur ce sujet.
Mais, pour le Conseil d’État, les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d’engager la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, faute de section syndicale d’organisation représentative, doivent quand même mettre en place un plan d’action sur ce sujet. À défaut d’un tel plan, elles sont redevables d’une pénalité financière.
Barème Macron : les arrêts de travail comptent !
Les périodes d’arrêts de travail ne doivent pas être exclues du décompte de l’ancienneté du salarié servant au calcul du montant de l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-15529
Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit lui verser. Pour ce faire, ils sont tenus de se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Une ancienneté qui doit inclure les périodes d’arrêts maladie du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Les arrêts maladie ne doivent pas être déduits !
Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement avait été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, s’était vue privée d’indemnité par les juges au motif que son ancienneté dans l’entreprise était inférieure à un an. En effet, même si la salariée avait fait partie des effectifs de l’entreprise pendant presque 3 ans, les juges avaient considéré que sa période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, qui avait duré plus de 2 ans, devait être exclue du décompte de son ancienneté pour fixer le montant de l’indemnité due par son employeur.
Amenée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a, quant à elle, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail de l’ancienneté de la salariée. Aussi avait-elle droit à une indemnité qui devait être fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, soit 2 ans et 10 mois (montant de 5 989 €, correspondant à 3,5 mois de salaire).
En complément :
dans une autre affaire, la Cour de cassation a indiqué que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté ont droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d’un mois de salaire.
Nullité des mises en demeure et contraintes de l’Urssaf
Pour les juges, les mises en demeure et contraintes notifiées par l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, préciser la nature exacte des sommes réclamées au cotisant.
Cassation civile 2e, 4 septembre 2025, n° 23-15474
Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier la bonne application des règles de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Et à l’issue de ses vérifications, elle adresse une lettre d’observation au cotisant. Une lettre qui, dès lors qu’elle fait état d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer, doit être suivie d’une mise en demeure « invitant » le cotisant à régulariser sa situation. Cette mise en demeure pouvant elle-même donner lieu à une contrainte, un acte de recouvrement forcé, si le cotisant n’a pas régularisé sa « dette ». À ce titre, les juges ont récemment précisé que la mise en demeure et la contrainte de l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, indiquer la nature exacte des sommes réclamées…
La mention « régime général » ne suffit pas !
Dans cette affaire, une fondation avait reçu de l’Urssaf des mises en demeure, suivies de contraintes, faisant état de sommes à régler. Or, la fondation estimait que ces mises en demeure et contraintes n’étaient pas valables dans la mesure où elles ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, en l’occurrence des sommes correspondant au versement transport, aujourd‘hui rebaptisé « versement mobilité ». Et pour cause, ces documents se contentaient de mentionner « une régularisation annuelle » à titre d’objet et le terme « régime général » concernant la nature des cotisations redressées.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Dijon avait considéré que les mises en demeure et les contraintes étaient valables, dans la mesure où différents courriers, antérieurs et postérieurs, adressés au cotisant justifiaient la nature et le montant des sommes réclamées.
Mais pour la Cour de cassation, les mises en demeure et les contraintes de l’Urssaf doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Autrement dit, elles doivent, sous peine de nullité, préciser la nature des sommes réclamées, en l’occurrence, le versement transport. Peu importe que d’autres courriers mentionnant cet élément aient été adressés à la fondation. L’affaire est donc remise entre les mains des juges d’appel.
Salariés seniors : des entretiens de mi-carrière et de fin de carrière
Les employeurs doivent désormais organiser des entretiens professionnels dédiés à la fin de carrière des salariés seniors.
Art. 3, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25
La récente loi « seniors » a intégré dans le Code du travail les mesures visant à faciliter le maintien dans l’emploi des salariés adoptées par les organisations patronales et les syndicats de salariés dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés.
Un entretien de mi-carrière
Les salariés doivent, en principe durant l’année civile de leur 45e anniversaire, bénéficier d’une visite médicale réalisée par le médecin du travail.
Cette visite de mi-carrière doit désormais être suivie, dans les 2 mois, d’un entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel).
Lors ce temps d’échange entre l’employeur et le salarié, sont abordés, s’il y a lieu, en plus des sujets classiques d’un tel entretien (compétences et qualifications du salarié, parcours professionnel, souhaits d’évolution professionnelle…) :- les éventuelles mesures proposées par le médecin du travail : mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou mesures d’aménagement du temps de travail justifiées notamment par l’âge ou l’état de santé physique et mental du salarié ;- l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail du salarié, la prévention des situations d’usure professionnelle, ses besoins en formation et ses éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle.
L’entretien donne lieu à un compte-rendu récapitulatif dont une copie est remise au salarié.
À noter :
comme pour toutes les visites auprès des services de santé au travail, l’employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
Un entretien de fin de carrière
Afin d’accompagner la fin de carrière des salariés seniors, le premier entretien de parcours professionnel organisé entre les 58 et 60 ans du salarié doit, en plus des sujets classiques d’un tel entretien, aborder :- les conditions de son maintien dans l’emploi ;- et les possibilités d’aménagements de sa fin de carrière (passage à temps partiel, retraite progressive…).
RTT : c’est à l’employeur de prouver qu’ils ont été posés ou payés
Le seul bulletin de paie ne suffit pas à établir que le salarié a bénéficié de ses jours de RTT ou qu’ils lui ont été réglés.
Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 23-18275
Lorsqu’un salarié saisit la justice pour réclamer le paiement d’éléments de rémunération, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses obligations en la matière. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les seules mentions du bulletin de paie ne constituaient pas une preuve suffisante…
La fiche de paie n’a qu’une valeur informative !
Dans cette affaire, un salarié avait, après la rupture de son contrat de travail, réclamé en justice diverses indemnités à son ancien employeur, dont une indemnité liée à 9 jours de RTT dont il disait n’avoir pas bénéficié.
Or, selon les bulletins de paie qui lui avaient été remis, le salarié avait accumulé 42,85 jours de RTT, dont 40 avaient été posés et 2,85 rémunérés. C’est pourquoi les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande.
Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois rappelé que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Autrement dit, il appartenait à l’employeur, qui se prétendait libéré de toute obligation de paiement à l’égard de son salarié, de prouver que ce dernier avait bien bénéficié de ses jours de RTT ou que ceux-ci lui avaient été réglés. Et à ce titre, la Cour de cassation a estimé que la seule production des bulletins de paie remis au salarié, qui n’ont qu’une valeur informative, ne suffisait pas. Car l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Aussi, l’affaire sera-t-elle de nouveau examinée par les juges d’appel.
En pratique :
pour tenter d’établir qu’il a bien rempli ses obligations en la matière, l’employeur peut, par exemple, produire les données relatives aux jours d’absence (congés, RTT…) des salariés enregistrées dans un logiciel dédié au temps de travail.
Emploi des seniors : un sujet à négocier !
Les entreprises d’au moins 300 salariés doivent désormais engager des négociations portant sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés « en considération de leur âge ».
Art. 2, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25
Dans les entreprises ou groupes d’entreprises qui disposent d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur doit engager des négociations périodiques portant, notamment, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ou encore sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et dorénavant, l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, font partie des thèmes de négociations obligatoires dans les entreprises (ou groupes d’entreprises) d’au moins 300 salariés.
Tous les 3 ans…
L’emploi des seniors doit faire l’objet de négociations dans les entreprises (ou groupes d’entreprises) d’au moins 300 salariés, et ce tous les 3 ans. Cette négociation, qui doit préalablement donner lieu à un diagnostic, doit porter sur :- le recrutement des seniors ;- leur maintien dans l’emploi ;- l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;- la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences (missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences).
Bien entendu, d’autres thèmes, considérés comme facultatifs, peuvent être abordés comme l’accès à la formation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels, les modalités d’écoute, d’encadrement et d’accompagnement des seniors, etc.
Précision :
un décret doit encore venir préciser les informations qu’il convient de transmettre aux syndicats avant l’ouverture des négociations.
… ou tous les 4 ans
Mais un accord de méthode conclu au niveau de l’entreprise peut venir encadrer cette nouvelle négociation obligatoire. Un accord qui peut alors :- fixer la périodicité de la négociation, dans la limite de 4 ans ;- définir le contenu de la négociation, autrement dit exclure certains thèmes imposés aux entreprises qui ne disposent pas d’accord de méthode.
En complément :
les branches professionnelles doivent, elles aussi, engager des négociations sur l’emploi des seniors tous les 3 ans ou au moins tous les 4 ans (si un accord de méthode est conclu). Dans ce cadre, elles peuvent définir un plan d’action type applicable dans les entreprises de moins de 300 salariés qui ont engagé volontairement des négociations sur l’emploi des seniors mais n’ont abouti à aucun accord. Ce plan pouvant alors être mis en place au moyen d’un document unilatéral de l’employeur, notamment après consultation du comité social et économique (CSE).
Délégation du pouvoir de licencier au directeur d’une association
Le directeur d’une association, qui n’a pas reçu du président une délégation du pouvoir de licencier, n’est pas compétent pour signer une convention de rupture conventionnelle.
Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 24-15046
Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.
Une rupture conventionnelle sans cause réelle et sérieuse
Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :- le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;- le président exécutait les décisions du conseil.
Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président.
Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier.
Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’aide à l’apprentissage peut maintenant être proratisée
Le montant de l’aide à l’apprentissage est désormais proratisé selon le nombre de jours effectués pour les contrats d’une durée inférieure à un an et pour ceux qui prennent fin de manière anticipée avant leur date anniversaire.
Décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, JO du 1er novembre
Les employeurs qui recourent à l’apprentissage peuvent, au titre de la première année d’exécution du contrat, bénéficier d’une aide financière dont le montant maximal s’élève à 2 000 € (entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global), 5 000 € (entreprises de moins de 250 salariés) ou 6 000 € (recrutement d’un apprenti en situation de handicap).
Conditions :
pour avoir droit à cette aide, le contrat d’apprentissage doit concerner l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5. En outre, il doit être adressé à l’opérateur de compétences dont relève l’employeur dans les 6 mois suivant sa conclusion.
Depuis le 1er novembre 2025, cette aide, qui est versée mensuellement à l’employeur, peut désormais être proratisée selon le nombre de jours effectués.
Pour le premier et/ou le dernier mois du contrat
Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est maintenant proratisée selon le nombre de jours travaillés par l’apprenti. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc plus le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte désormais des jours de ces mois couverts par le contrat.
Précision :
pour les contrats d’apprentissage de moins d’un an déjà en cours au 1er novembre 2025, la proratisation s’applique seulement au montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat.
Une proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue lorsque le contrat prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire. Ainsi, dorénavant, le montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par ce contrat.
Une suspension du versement de l’aide
Dans sa foire aux questions sur « l’aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage » , le ministère du Travail et des Solidarités a précisé que ces nouvelles modalités de proratisation entraînent des suspensions du versement de l’aide financière pour certains contrats.
Ainsi, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er novembre 2025, le versement mensuel de l’aide est « mis en attente » entre le 1er novembre 2025 et février 2026. À partir de mi-février 2026, l’éligibilité à l’aide sera étudiée avec, le cas échéant, l’application d’une proratisation sur les premier et/ou dernier mois incomplet(s) du contrat. Puis, les premiers versements de l’aide due à l’employeur seront effectués courant mars 2026.
Pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à cette date, le versement mensuel de l’aide n’est pas suspendu. Deux situations seront alors possibles pour ces contrats :- le contrat arrive à terme ou est rompu avant mi-février 2026 : l’employeur recevra, pour le dernier mois du contrat, le montant de l’aide correspondant à un mois complet puis, après mi-février 2026, il recevra, si ce mois est incomplet, une demande de remboursement ;- le contrat arrive à terme ou est rompu après mi-février 2026 : l’employeur recevra automatiquement le montant proratisé si le dernier mois du contrat est incomplet.
Un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans
L’entretien professionnel doit désormais être organisé dans la première année suivant l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans.
Art. 3, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25
Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser, avec chacun de leurs salariés, un entretien professionnel portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».
Un entretien que la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social » a rebaptisé « entretien de parcours professionnel », tout en modifiant sa périodicité.
Un entretien tous les 4 ans
Désormais, l’entretien de parcours professionnel doit être organisé au cours de l’année qui suit l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans. Sachant qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une périodicité inférieure.
Précision :
comme avant, l’entretien de parcours professionnel doit être proposé au salarié après une absence prolongée (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt de travail « longue maladie »…). Sauf, et c’est une nouveauté, si le salarié a déjà bénéficié d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.
Comme l’entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. En effet, lors de ce temps d’échange, employeur et salarié discutent :- des compétences du salarié et des qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que de leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;- de sa situation et de son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;- de ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;- de ses souhaits d’évolution professionnelle (le cas échéant, reconversion, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ;- de l’activation de son compte personnel de formation, des abondements versés sur ce compte par l’employeur et du conseil en évolution professionnelle.
En pratique :
l’entretien de parcours professionnel est organisé par l’employeur pendant le temps de travail du salarié et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Il donne lieu à un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.
Autre nouveauté, afin de préparer l’entretien de parcours professionnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle et l’employeur, d’un conseil de proximité assuré par son opérateur de compétences. Si un accord de branche ou d’entreprise le prévoit, l’employeur peut être accompagné par un organisme externe.
Un entretien d’état des lieux tous les 8 ans
Tous les 8 ans, l’entretien de parcours professionnel doit faire un « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » du salarié.
Précision :
ces 8 années correspondent à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Comme avant, cet entretien d’état des lieux vise à s’assurer que le salarié a bénéficié, au cours des 8 dernières années, des entretiens périodiques de parcours professionnels et qu’il a :- suivi au moins une action de formation ;- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;- obtenu une progression salariale ou professionnelle.
Et sans changement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 8 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens périodiques, ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.
Important :
les entreprises et les branches couvertes par un accord relatif à l’entretien professionnel doivent le renégocier pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles. Sachant que celles-ci s’appliqueront à compter du 1er octobre 2026 aux accords portant sur la périodicité des entretiens professionnels.
Membres du CSE : le nombre de mandats n’est plus limité
Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent désormais exercer plus de trois mandats successifs.
Art. 8, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25
En créant, il y a presque 10 ans, le comité social et économique (CSE), lequel a remplacé les anciennes institutions représentatives du personnel dans les entreprises, les pouvoirs publics avaient limité le nombre de mandats successifs pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel. Une limitation que la loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », dite loi « seniors », vient de supprimer.
Rappel :
jusqu’alors, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE ne pouvaient pas effectuer plus de trois mandats successifs. Sachant qu’un protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales pouvait déroger à cette règle mais uniquement dans les entreprises comptant moins de 300 salariés.
Trois mandats et plus !
Afin de permettre le renouvellement du CSE dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire « en préservant l’expérience et les compétences acquises, dans un objectif d’amélioration de la qualité du dialogue social », la loi « seniors » a mis fin à la limitation des mandats pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel au CSE.
Ces derniers peuvent donc dorénavant effectuer plus de trois mandats successifs au sein du CSE, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
En complément :
lorsque, notamment, aucun candidat présenté par un syndicat aux élections du CSE ne remplit les conditions pour pouvoir être désigné comme délégué syndical ou lorsque les élus (qui remplissent ces conditions) renoncent à exercer ce mandat, le syndicat concerné peut désigner un délégué syndical, en particulier, parmi ses anciens élus. Auparavant, seuls les anciens élus qui avaient déjà exercé trois mandats successifs au sein du CSE pouvaient être désignés en tant que délégués syndicaux. Désormais, tous les anciens élus du syndicat peuvent être concernés.
Les associations agricoles employeuses en 2024
Plus de 7 117 associations employant 111 205 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025
En 2024, on comptait 7 117 établissements associatifs agricoles employant 111 205 salariés, pour une masse salariale de 2,67 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,8 % de l’ensemble du personnel associatif.
Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 960 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 330 €, pour une masse salariale de 103 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.
Des cadeaux et bons d’achat de Noël exonérés de cotisations sociales
Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales dans la limite, cette année, de 196 € par personne.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.
Précision :
sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur.
Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (196 € par salarié en 2025), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes.
Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 196 €.
En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).
Attention :
le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).
Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2025) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 196 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.
Important :
dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.
L’emploi progresse encore dans les associations
En 2024, le secteur associatif employait 1,92 million de salariés dans 153 120 établissements, pour une masse salariale de 51,25 Md€.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 23e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.
Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le nombre d’associations employeuses (régimes général et agricole) ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse à compter de 2021. Mais, en 2024, le nombre d’établissements employeurs a légèrement reculé (-0,3 %) pour s’établir à 153 120. Sachant que les associations ont, en moyenne, 1,2 établissement (jusqu’à 2 dans la santé et 3 dans l’hébergement médico-social).
Les effectifs ont, quant à eux, continué à augmenter (+1 %), atteignant ainsi 1,924 million de salariés.
Précision :
sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.
Près d’un dixième des salariés
En 2024, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail (9,3 %) et plus que les secteurs de la construction (7,9 %) ou des transports (7,3 %).
Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées ou l’aide par le travail (90 % des effectifs du secteur privé). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (4 %).
Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :- 68 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;- 67 % dans l’hébergement médico-social ;- 66 % dans le sport ;- près de 53 % dans l’enseignement ;- 25 % dans les activités culturelles ;- 23 % dans la santé.
À noter :
la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 34 % en 2024). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 53 % en 2024).
Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 150 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (22 080 établissements, soit 14,4 %), les activités culturelles (20 010 établissements, soit 13 %), l’enseignement (17 350 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 370 établissements, soit 6,8 %).
Précision :
le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56,4 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,4 %) et les activités humaines pour la santé (7,7 %).
Une majorité de petites associations
L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés (48 % moins de 3 et 15 % entre 3 et 5). 31 % des établissements employaient entre 6 et 49 salariés.
Et ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 124 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 060 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.
Environ 12 salariés par établissement
L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,6 salariés. Ce nombre variait toutefois énormément selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 36 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,5 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,1 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,9 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.
Une masse salariale en milliards
En 2024, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 51,246 Md€. Un montant en hausse de 3,8 % par rapport à 2023.
Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 € (+2,7 %). Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (47 210 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (42 570 €), des organisations politiques (41 420 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 770 €).
Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 870 €), dans les activités liées à l’emploi (20 650 €), dans les associations sportives (18 690 €), dans les associations récréatives et de loisirs (17 730 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 330 €).
Un contrat de travail adapté aux salariés seniors
Les employeurs peuvent désormais recruter des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 60 ans dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience.
Art. 4, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25
Malgré une augmentation ces dernières années, le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 64 ans (soit 42,4 %) reste très en-deçà de la moyenne européenne (de 10,7 points, selon la Dares). En outre, les demandeurs d’emploi seniors sont, plus souvent que les autres, confrontés au chômage de longue durée.
Aussi, afin d’encourager l’embauche de ces travailleurs, l’accord national interprofessionnel « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés » conclu le 14 novembre 2024 par les organisations patronales et les syndicats de salariés a instauré le « contrat de valorisation de l’expérience ».
Intégré dans la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social », dite loi « seniors », ce dispositif est entré en vigueur le 26 octobre 2025.
À noter :
le contrat de valorisation de l’expérience s’applique dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans qui durera jusqu’à fin octobre 2030.
Un contrat à durée indéterminée…
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat de valorisation de l’expérience permet aux employeurs de recruter des demandeurs d’emploi :- inscrits à France Travail ;- âgés d’au moins 60 ans ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’au moins 57 ans ;- et qui n’ont pas encore droit à une pension de retraite à taux plein (sauf notamment pour les militaires et les marins).
Par ailleurs, le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu, dans les 6 mois précédents, aux effectifs de l’entreprise ou d’une autre entreprise du groupe.
À noter :
lors de la signature du contrat, le salarié doit transmettre à son employeur un document, établi par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), précisant la date prévisionnelle à laquelle il pourra bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Si cette date vient à changer, un document mis à jour doit alors être communiqué à l’employeur.
… qui facilite la mise à la retraite
Les employeurs peuvent se montrer frileux à l’idée d’embaucher un salarié senior en contrat à durée indéterminée (CDI) en raison des règles strictes liées à sa mise à la retraite (accord du salarié s’il a moins de 70 ans) et du coût financier de cette rupture. C’est pourquoi le contrat de valorisation de l’expérience permet d’y déroger.
Ainsi, un salarié engagé dans le cadre d’un tel contrat peut être mis à la retraite, sans son accord, dès lors qu’il a atteint :- l’âge légal de départ à la retraite (actuellement, entre 62 ans et 9 mois et 64 ans selon son année de naissance) et qu’il cumule l’intégralité des trimestres exigés pour avoir droit à une pension de retraite à taux plein (actuellement, entre 170 et 172 trimestres selon son année de naissance) ;- l’âge à partir duquel les salariés ont automatiquement droit à une pension de retraite à taux plein, soit 67 ans.
Précision :
l’employeur doit respecter un délai de préavis identique au préavis de licenciement.
Comme dans le cadre d’un CDI « classique », l’employeur doit verser au salarié mis à la retraite une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement. Toutefois, il est exonéré du paiement de la contribution spécifique normalement due, au taux de 30 %, sur la fraction de l’indemnité de mise à la retraite qui n’est pas soumise à cotisations sociales.
Attention :
la mise à la retraite qui ne respecte ni les conditions liées au contrat de valorisation de l’expérience, ni celles liées à un CDI « classique » constitue un licenciement. Une rupture qui devrait être considérée comme invalide par les tribunaux.