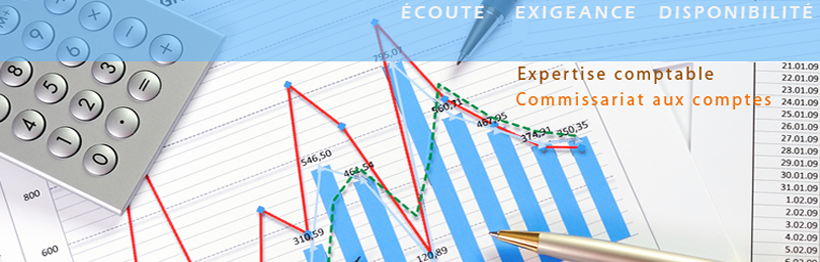Assurance-vie après 70 ans : est-ce toujours un bon placement ?
Fiscalité, transmission, exonérations… Même après les 70 ans du souscripteur, l’assurance-vie conserve de sérieux atouts.
Selon une idée répandue, l’assurance-vie perdrait de son attrait après 70 ans. Certes, la fiscalité qui s’applique à ce placement évolue avec l’âge, mais il est important de savoir que ce contrat d’épargne présente encore de nombreux atouts même après 70 ans. Explications.
Avant 70 ans
Au dénouement du contrat (comprendre au décès du souscripteur), les montants transmis aux bénéficiaires, pour les primes versées avant 70 ans, bénéficient d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Peu important le lien de parenté qui existe entre le défunt et le bénéficiaire. Au-delà de ce montant, les sommes perçues sont taxées à un taux forfaitaire de 20 %, puis de 31,25 % au-delà de 700 000 €.
Précision importante :
en raison d’une taxation forfaitaire, il n’est pas possible de bénéficier des abattements personnels prévus pour le paiement des droits de succession (par exemple, l’abattement parent-enfant de 100 000 €).
Après 70 ans
Lorsque les sommes transmises ont été versées au contrat après les 70 ans du souscripteur, un abattement est également applicable, mais réduit à 30 500 € que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. Et au-delà de ce montant, des droits de succession trouvent à s’appliquer. Le montant de ces derniers étant déterminé selon le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Contrairement à la situation précédente, les abattements prévus en matière de succession opèrent ici. Ainsi, par exemple, pour une transmission entre un parent et un enfant unique, l’exonération peut atteindre 130 500 € (100 000 € + 30 500 €). Intéressant !
Même si elle ne permet de transmettre « que » 30 500 € sans fiscalité, l’assurance-vie après 70 ans présente d’autres avantages. Par exemple, les plus-values générées par les primes versées après 70 ans échappent totalement aux droits de succession. Il en va de même pour les intérêts produits par le contrat.
À noter :
les sommes transmises au conjoint survivant (marié ou pacsé) ou à un frère ou à une sœur (sous conditions) sont totalement exonérées d’impôts.
Ouvrir un second contrat
Pour optimiser sa situation, il peut être intéressant, à compter de 70 ans, de souscrire un second contrat plutôt que de continuer à alimenter le premier. Avec deux contrats, vous pourrez cumuler deux régimes fiscaux et séparer vos versements. Et en cas de besoin de liquidités (rachat), vous pourrez choisir le contrat sur lequel prélever afin d’optimiser la transmission.
Comment payer moins d’impôt sur le revenu ?
Procéder, d’ici la fin de l’année, à certains investissements ou à certains placements vous permettra d’alléger le montant de votre impôt l’année prochaine, voire les suivantes.
Vous avez déclaré récemment vos revenus 2024 et avez donc découvert votre niveau d’imposition. Une facture fiscale que vous aimeriez peut-être réduire l’an prochain, voire les années suivantes. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous pencher sur différents dispositifs qui pourraient vous permettre de bénéficier d’un avantage fiscal en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux d’entre eux.
Investir dans l’immobilier
Vous pouvez d’abord investir dans l’immobilier. Ainsi, par exemple, le dispositif Denormandie vous permet, lorsque vous investissez dans un bien immobilier ancien en vue de le louer et que vous effectuez des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Étant précisé que le logement ancien doit être situé dans une commune :- dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;- ou qui a passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).
Et attention, les travaux doivent être de nature à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Et ils devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
Pour bénéficier du dispositif Denormandie, vous devez vous engager à donner le logement en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de votre foyer fiscal. Cet engagement de location devant être pris pour une durée de 6, 9 ou 12 ans. Des conditions de plafonds de loyers et de ressources du locataire sont également exigées.
Si toutes ces conditions sont remplies, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt, calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par an.
À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % outre-mer).
Investir dans les bois et forêts
Investir dans des parcelles de forêts peut également vous permettre de réaliser des économies d’un point de vue fiscal. À ce titre, le plus simple est d’acquérir des parts de groupements forestiers d’investissement (GFI). Concrètement, il s’agit de sociétés civiles qui ont pour objet de constituer, de gérer et de conserver un ou plusieurs massifs forestiers. Ces parts de GFI vous permettront de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 18 % du prix de leur acquisition, retenu dans la limite annuelle de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple.
Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faudra vous engager à conserver vos parts pendant au moins 5 ans.
Bon à savoir, à certaines conditions, les 3/4 de la valeur des parts de GFI sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. De même, sous conditions, les parts de groupements forestiers transmises par donation ou succession sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des 3/4 de leur valeur.
Investir dans les PME
Acquérir des parts de FCPI ou de FIP
Pour réduire la note fiscale, vous pouvez aussi investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ayant vocation, respectivement, à prendre des participations au capital de PME européennes ou à œuvrer en Corse ou outre-mer.
Les versements réalisés à cette fin ouvrent droit, sous réserve notamment de conserver les parts du fonds pendant 5 ans, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % de leur montant — taux majoré à 25 % (sous réserve de publication d’un décret) pour les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et à 30 % pour les FIP —, plafonné à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Mais attention, ce placement, présentant des risques, doit être envisagé comme un placement à long terme.
Souscrire au capital de PME
Dans le même esprit, une réduction d’impôt peut vous être accordée lorsque vous effectuez des versements au titre de la souscription au capital de certaines PME non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés (dispositif IR-PME), à condition, là encore, de conserver les titres reçus en échange de l’apport pendant 5 ans. Des versements qu’il est possible de réaliser directement ou indirectement, via une société holding.
Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale, en principe, à 18 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à une imposition commune.
À noter que le taux de la réduction est porté, selon les cas, à 30 % ou à 50 % pour les souscriptions en numéraire réalisées entre 2024 et 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI). Dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.
Investir dans le cinéma
En investissant dans une Sofica, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale, en principe, à 30 % des sommes versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % de votre revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts dans la Sofica pendant au moins 5 ans.
Épargner pour sa retraite
Enfin, vous pouvez défiscaliser tout en vous constituant une épargne retraite supplémentaire en souscrivant un Plan d’épargne retraite (PER). Car outre le fait de valoriser un capital, ce produit d’épargne à grand succès bénéficie d’un régime fiscal qui se veut incitatif.
En effet, les sommes versées sur un PER peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS).
Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie.
Mais attention, cette déductibilité à l’entrée est plafonnée. Une limite que chacun peut découvrir en consultant son avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les plafonds d’épargne retraite (le plafond de l’année en cours et ceux des 3 dernières années). Ils correspondent aux sommes maximales qu’il est possible de déduire chaque année de son revenu.
Les dons aux associations
Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, à 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique, soit au profit de fondations reconnues d’utilité publique qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine immobilier religieux.
Des limites à ne pas dépasser
De nombreux dispositifs peuvent vous aider à faire baisser la pression fiscale. Mais attention, la défiscalisation a des limites. En effet, le montant des avantages fiscaux accordés au titre de l’impôt sur le revenu est, en principe, plafonné. Pour les avantages souscrits en 2025 et déclarés en 2026, la diminution d’impôt ne peut, en principe, être supérieure à 10 000 €. En présence de certains dispositifs, ce plafond peut être rehaussé à 18 000 €.
En conclusion
Bien entendu, au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, sachez qu’il existe bien d’autres solutions de défiscalisation, notamment des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer, le dispositif Loc’Avantages ou « Malraux ». Souvent performants, ils doivent cependant être maniés avec précaution. D’autant plus qu’ils ne peuvent pas toujours se cumuler.Aussi, si vous êtes tenté d’aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.
Pourquoi ouvrir une assurance-vie dès le plus jeune âge ?
L’assurance-vie peut permettre de doter un enfant d’un capital qui l’aidera à financer ses projets à sa majorité.
L’assurance-vie est souvent perçue comme un placement réservé aux seniors ou aux personnes disposant d’un patrimoine conséquent. Ces préjugés, associés à la crainte d’une épargne immobilisée, peuvent dissuader les plus jeunes d’y recourir. Pourtant, investir dès le plus jeune âge présente plusieurs avantages. Explications.
Le temps : l’allié de l’épargnant
Se pencher sur la question de l’épargne d’un jeune présente un avantage de taille : le temps. Plus on commence à épargner tôt et plus le potentiel de progression de son capital est évidemment important.
Avoir le temps, c’est aussi pouvoir adopter une stratégie d’investissement plus dynamique. En effet, placer une épargne sur du long terme permet de se positionner sur des actifs plus risqués (donc potentiellement plus rémunérateurs) tout en s’assurant que les soubresauts des marchés financiers pourront être compensés par les périodes haussières.
Un produit souple
L’assurance-vie est un outil pertinent pour se constituer un capital. Un capital qui pourra servir, par exemple, à financer le permis de conduire et l’achat d’un premier véhicule, des études, un voyage, un premier appartement… En pratique, il est possible d’alimenter régulièrement (et à tout moment) le contrat avec quelques dizaines d’euros seulement en procédant à des versements libres. Il est également possible de mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement.
Avec l’aide d’un conseiller, le jeune détermine le montant des versements, la périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et les supports sur lesquels ces sommes seront investies (des fonds en euros ou des supports en unités de compte).
À noter que l’épargnant a toujours la main sur son contrat et peut moduler les versements programmés à la hausse ou à la baisse en fonction de ses capacités d’épargne, mais également les arrêter à tout moment.
Bien qu’il soit conseillé de conserver son épargne sur le long terme, le détenteur d’une assurance-vie peut également retirer (on parle alors de rachat), quand il le souhaite, une partie du capital qu’il a accumulé sur son contrat.
Autre point important, contrairement aux livrets règlementés, l’assurance-vie n’est pas plafonnée !
Quand ouvrir une assurance-vie ?
Il n’y a pas d’âge minimal pour ouvrir une assurance-vie, mais le plus tôt est le mieux ! Elle peut être ouverte directement par un jeune adulte ou par les parents ou les grands-parents au profit d’un enfant mineur. Le contrat pourra être alimenté par ces derniers grâce à des versements libres (par exemple, des dons manuels ou des présents d’usage de sommes d’argent) ou programmés.
Exonération des dons familiaux : des précisions attendues !
Une nouvelle exonération de droits de mutation pour les dons familiaux destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier ou de travaux est instaurée.
Vous souhaitez donner un coup de pouce à vos enfants ou à vos petits-enfants qui ont pour projet d’acquérir leur résidence principale ? Sachez qu’un nouveau dispositif fiscal vous permet de leur donner une importante somme d’argent en franchise d’impôt.
Une aide pour (mieux) se loger
Avec la loi de finances pour 2025, un nouveau dispositif fiscal de don familial a vu le jour. Un dispositif qui permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce. Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif.
Attention toutefois, ces sommes doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
Faire preuve de vigilance
Le dispositif étant très récent, de nombreuses questions sur ses modalités d’application sont en suspens. Par exemple, pour une rénovation énergétique, quels travaux sont éligibles ? Le donataire doit-il réaliser ou non un bouquet de travaux ? Et pour l’acquisition d’un logement, les sommes reçues peuvent-elles financer également l’achat d’un terrain à bâtir ? Peut-on loger le bien acquis dans une SCI ?
Vous l’aurez compris, bien que ce nouveau dispositif soit attractif, mieux vaut, pour l’instant, faire preuve de retenue. Et attendre, pour assurer la sécurité juridique d’une telle donation, que l’administration fiscale apporte des précisions avant de la consentir !
Pas de cumul possible
Pour une rénovation énergétique, il faudra faire un choix entre l’exonération fiscale et MaPrimeRénov’, ces deux dispositifs n’étant pas cumulables ! Un calcul d’opportunité, tenant compte de différents paramètres (ampleur des travaux, revenus du donataire, économies…), devra donc être réalisé !
Déclaration de revenus 2024, mode d’emploi
Vous devrez bientôt déclarer vos revenus de 2024 afin de permettre à l’administration fiscale de calculer votre imposition définitive. Présentation des principales règles et nouveautés à connaître pour remplir votre déclaration dans les règles de l’art.
Les dates limites de dépôt
La date limite pour souscrire la déclaration de revenus varie selon votre lieu de résidence.
Avec le prélèvement à la source, vous payez l’impôt sur la plupart de vos revenus au fur et à mesure de leur encaissement, soit par une retenue, soit par un acompte. Mais les prélèvements qui ont été opérés en 2024 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2025, déduction faite de vos éventuels crédits et réductions d’impôt. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir votre déclaration annuelle. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement, applicable de septembre 2025 à août 2026, et de taxer les revenus exclus du prélèvement à la source (dividendes, intérêts…).
Nouveauté :
le taux individualisé des couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune s’appliquera automatiquement à compter du 1er septembre 2025, sauf option contraire.
La date limite pour souscrire en ligne votre déclaration n° 2042 et ses annexes varie selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au :
- 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;- 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse ;- 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 976.
À savoir :
le patrimoine immobilier dont la valeur taxable au 1er janvier 2025 excède 1,3 M€ doit être déclaré dans l’annexe n° 2042-IFI.
À noter que les personnes qui prennent en location une résidence secondaire doivent désormais le mentionner dans leur déclaration de revenus.
Les revenus à déclarer
Différentes catégories de revenus (résultat de l’entreprise, rémunérations des dirigeants, dividendes, revenus fonciers…) doivent être déclarées.
Différentes catégories de revenus doivent être déclarées.
Les revenus professionnels
Le résultat de l’entreprise
Si vous êtes entrepreneur individuel et que vous êtes soumis à un régime réel en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices agricoles (BA) ou au régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), vous devez souscrire en ligne une déclaration annuelle de résultats, au plus tard le 20 mai 2025, pour déterminer votre bénéfice imposable. Un résultat qui doit être reporté sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.
Précision :
les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont en principe imposables dans la catégorie des BNC, et non plus dans celle des traitements et salaires. Ceux relevant de la déclaration contrôlée doivent donc désormais déposer une déclaration de résultats. À noter que le Conseil d’État vient d’annuler la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de SELARL (et les gérants de SELCA) peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.
Par ailleurs, les travailleurs non-salariés doivent renseigner un volet social dans leur déclaration n° 2042 C-PRO afin que soit calculé le montant définitif de leurs cotisations sociales personnelles.
Les associés de sociétés de personnes
Le bénéfice imposable d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est d’abord déterminé et déclaré au niveau de la société, puis réparti entre ses associés. La quote-part de résultat qui vous revient en tant qu’associé doit être ajoutée sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.
Les rémunérations des dirigeants
Les rémunérations des dirigeants de sociétés de capitaux (président du conseil d’administration, directeur général, gérant de SARL...) sont imposables comme des salaires. Ces derniers peuvent alors déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable, soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 % (plafonnée à 14 426 €), soit par celui des frais réels. En cas d’option pour les frais réels, ils doivent indiquer leur montant global dans la déclaration et être en mesure de les justifier, chaque membre du foyer fiscal pouvant choisir l’option qui lui est le plus favorable.
Les revenus financiers
Les revenus mobiliers (dividendes, intérêts…) et les plus-values mobilières perçus en 2024 sont, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % (12,8 % pour l’impôt sur le revenu et 17,2 % pour les prélèvements sociaux). Vous pouvez toutefois opter pour le barème progressif en cochant la case 2OP de votre déclaration. Mais cette option est irrévocable et globale. Elle s’applique donc, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus et plus-values mobiliers perçus par votre foyer fiscal en 2024. Et attention, si vous avez exercé cette option l’an passé, la case 2OP est précochée. Vérifiez si vous souhaitez la conserver pour 2024 ! Enfin, pensez à bien reporter les montants et/ou les contrôler lorsqu’ils sont préremplis.
À noter :
vous pouvez également opter pour l’imposition au barème progressif de vos plus-values de cession de cryptomonnaies, à la place du PFU. Une option qui est indépendante de celle éventuellement exercée pour vos autres revenus financiers.
Les revenus des biens immobiliers
Les revenus fonciers
Vous devez déclarer les loyers issus des locations non meublées que vous avez perçus en 2024.
Si le total de ces loyers n’excède pas 15 000 €, vous relevez, en principe, du régime micro-foncier (sauf logements exclus) et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Le montant de vos charges déductibles étant calculé de façon forfaitaire avec l’application d’un abattement de 30 %. À noter que ce régime ne permet pas d’imputer un déficit foncier.
Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur la déclaration spécifique n° 2044 (ou n° 2044-S pour les investissements locatifs défiscalisants).
Lorsque vous relevez du micro-foncier, vous pouvez, si vous y avez intérêt, opter pour le régime réel en déposant simplement la déclaration n° 2044. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.
Et les locations meublées saisonnières ?
Pas de changement pour les revenus 2024 : le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé est fixé à 50 %, avec un plafond de chiffre d’affaires de 77 700 €. S’agissant d’un meublé de tourisme classé, cet abattement est de 71 % et le plafond fixé à 188 700 €. En revanche, à compter des revenus 2025, l’abattement sera réduit à 30 % et le plafond ramené à 15 000 € pour un meublé de tourisme non classé, et à 50 % et 77 700 € pour un meublé de tourisme classé.
Les plus-values immobilières
Si vous avez vendu un bien immobilier en 2024, l’impôt sur l’éventuelle plus-value a déjà été prélevé par le notaire lors de la vente. Toutefois, vous devez reporter son montant sur la déclaration n° 2042 C afin qu’elle soit prise en compte, le cas échéant, dans votre revenu fiscal de référence, sauf en principe s’il s’agit d’une plus-value exonérée.
Les charges et avantages fiscaux
De votre revenu brut global peuvent être déduites certaines charges. Et plusieurs dépenses peuvent, par ailleurs, vous ouvrir droit à des réductions ou à des crédits d’impôt.
Les charges déductibles du revenu global
Certaines dépenses payées en 2024 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration de revenus. Tel est le cas, sous certaines conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant ou à un parent, du déficit professionnel ou encore du déficit foncier issu de charges déductibles autres que les intérêts d’emprunt (dans la limite de 10 700 €, éventuellement rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 €, du montant des travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique). Et si vous vous constituez une épargne retraite individuelle volontaire, vous pouvez également déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un PER.
Les avantages fiscaux à déclarer
Vous bénéficierez, à l’été 2025, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses personnelles (frais de garde de jeunes enfants, dons aux associations...) de 2024, à condition, là aussi, de les mentionner dans votre déclaration de revenus.
Sachez que le montant global des avantages fiscaux de votre foyer fiscal pour 2024 ne peut pas excéder, en principe, 10 000 € (18 000 € pour certains dispositifs). Un plafond à surveiller car, sauf exception, en cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt est définitivement perdu.
À noter :
pour bénéficier du crédit d’impôt services à la personne, les contribuables doivent indiquer, dans leur déclaration de revenus, le type d’activité au titre de laquelle les dépenses ont été effectuées et pouvoir présenter, sur demande, certaines pièces justificatives, notamment celles relatives au paiement des salaires et des cotisations sociales. À partir de l’an prochain, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels ont été versées les sommes ouvrant droit au crédit d’impôt devront également être déclarées.
Une nouvelle procédure de contrôle
Une nouvelle procédure simplifiée de contrôle des dépenses ouvrant droit à crédits d’impôt et des montants de prélèvements à la source est instaurée. Ainsi, désormais, l’administration peut demander au contribuable, avant l’établissement de l’imposition, tous les éléments permettant de justifier la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements, dès lors qu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause leur réalité. Le contribuable dispose de 30 jours pour apporter ces justificatifs. À défaut, le fisc peut liquider l’impôt sans tenir compte des crédits d’impôt. Conservez donc bien les pièces justificatives !
Location meublée touristique : de nouvelles règles en 2025
Louer son appartement ou sa maison à une clientèle de passage est tentant financièrement. Mais attention, de nouvelles obligations entrent en vigueur en 2025.
En 2025, de nouvelles réglementations vont durcir le régime de la location meublée touristique de courte durée. En effet, la loi du 19 novembre 2024, communément appelée « loi Le Meur », a été adoptée par le Parlement pour renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Ce texte transpartisan vise à mieux encadrer les locations saisonnières et à limiter leur essor. Tour d’horizon des nouveautés qui s’imposent aux propriétaires.
Une obligation de déclaration
Jusqu’à présent, les communes pouvaient décider de mettre en place ou non une déclaration des meublés de tourisme. Dans celles qui l’avaient décidé, un formulaire papier ou en ligne devait être rempli par tout propriétaire qui souhaitait louer son logement pour de courtes durées. Avec la nouvelle loi, cette faculté devient désormais une obligation. Ainsi, au plus tard le 20 mai 2026, toutes les locations de meublés touristiques sur le territoire national devront faire l’objet d’une déclaration à la mairie. Étant précisé que, lorsqu’il s’agit d’une résidence principale, le propriétaire devra apporter la preuve que le logement proposé à la location est bien sa résidence principale, en fournissant un avis d’imposition établi à son nom avec l’adresse du meublé de tourisme. Une fois la déclaration effectuée, un numéro d’enregistrement sera communiqué au propriétaire qui devra le faire figurer sur chaque annonce de mise en location.
Précision :
pour les communes qui l’ont prévu, il peut être nécessaire, avant de pouvoir louer, d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage du logement. Une demande qui devra être formulée également auprès de la mairie.
Consommation énergétique
Les questions relatives à la consommation énergétique des logements ne se posaient pas pour les meublés de tourisme loués pour de courtes durées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ! En effet, les locations meublées touristiques sont désormais soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, désormais, tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme (excepté les résidences principales) en zone tendue et soumis à autorisation de changement d’usage devront attester d’un DPE classé au moins E.
Et à compter du 1er janvier 2034, toutes les locations meublées touristiques (y compris les résidences principales) présentes et futures devront être classées au moins D. Sur demande de la mairie, les bailleurs pourront être sommés de transmettre le DPE de leurs logements.
Précision :
les locations en meublé de tourisme classées F et G actuellement sur le marché peuvent continuer d’être louées comme telles jusqu’en 2034.
Un contrôle des flux
La loi du 19 novembre 2024 offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. Une interdiction de location peut donc être prévue dans certaines zones. Autre apport de cette loi, les communes peuvent, depuis le 1er janvier 2025, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location des résidences principales de 120 à 90 jours par an. En cas de dépassement du quota annuel, le propriétaire encourra une amende civile de 15 000 €. Les communes pourront également, sur délibération, soumettre à autorisation tous types de locaux qui ne seraient pas à usage d’habitation. Une mesure destinée à réguler les pratiques des investisseurs qui transforment des bureaux en meublés touristiques.
Un durcissement de la fiscalité
Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, la loi de finances pour 2025 prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du 15 février 2025. Toutefois, ne sont pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.
Autre nouveauté, pour les revenus locatifs perçus à partir de 2025, le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé touristique non classé est passé de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant).
SCPI : les critères à scruter pour bien investir
LTV, TOF, VPM… les indicateurs qu’il est intéressant d’utiliser pour juger de la qualité d’une SCPI ne manquent pas !
Ces deux dernières années ont été particulièrement chahutées pour les SCPI. Dans un contexte de remontée des taux, certaines d’entre elles (principalement les SCPI de bureaux) ont dû revoir à la baisse la valorisation de leurs actifs. En parallèle, de nombreuses autres SCPI ont continué à progresser. D’ailleurs, le rendement moyen des SCPI devrait augmenter cette année. Mais dans un marché hétérogène, il convient d’être particulièrement sélectif. Tour d’horizon de quelques critères à analyser avant de s’engager.
Les performances
La vocation première d’une SCPI est de distribuer des revenus à ses investisseurs. Le premier réflexe est donc d’étudier le taux de distribution de la société. Pour cela, il convient de vérifier notamment le rendement actuel (est-il volatil ? constant ? en augmentation ?) et l’historique de performance.
La qualité de la société de gestion ainsi que l’expérience de son équipe sont aussi des points déterminants. Attention toutefois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le patrimoine
Deuxième critère, le patrimoine de la SCPI. Il faut privilégier celles dont le patrimoine est mutualisé sur un nombre suffisant d’immeubles. Des biens immobiliers qui doivent être de bonne qualité (entretien et renouvellement du « parc » régulier), bien placés et répondre aux demandes du marché. Globalement, mieux vaut se diriger vers les SCPI qui ont opté pour une stratégie de diversification. Par exemple, certaines d’entre elles investissent dans des actifs à bon prix situés hors des frontières françaises (Allemagne, Espagne, Belgique…), tandis que d’autres proposent d’opérer une diversification sectorielle (santé, éducation, hôtellerie). Au-delà de l’aspect sélectif, il est également conseillé de diversifier son portefeuille en choisissant des SCPI différentes. Cette diversification permettant de diluer le risque.
Les reports à nouveau
Autre indicateur, les reports à nouveau. Il s’agit de réserves que les SCPI constituent pendant les périodes fastes et qu’elles utilisent dans des périodes économiques moins favorables, pour pouvoir lisser la distribution aux investisseurs au fil du temps. Plus le report à nouveau est élevé, plus la régularité des sommes versées sera assurée.
On estime qu’un report à nouveau confortable doit correspondre à environ 3 mois de distribution de loyers. En deçà de ce montant, il conviendra de se tourner vers une autre SCPI.
Le taux d’occupation financier
Le taux d’occupation financier est le rapport entre le montant des loyers facturés et ce que la SCPI pourrait encaisser si l’ensemble de son patrimoine était loué. Cet indicateur permet de s’assurer de l’attractivité du patrimoine de la SCPI pour les locataires.
Un taux d’occupation élevé signifie que la grande majorité des immeubles sont loués et rapportent des revenus à la SCPI. La stabilité dans le temps du taux d’occupation doit aussi être analysée. Elle indique une gestion équilibrée et sécurisante. Généralement, un taux bas, inférieur à 90 %, peut signifier qu’il existe un potentiel d’amélioration en cas de vacance temporaire ou, au contraire, révéler une vacance structurelle qui n’est pas un bon signe.
La liquidité
En raison de leur nature, la revente de parts de SCPI peut se révéler parfois compliquée, que leur titulaire se charge seul de trouver un acheteur sur un marché secondaire ou qu’il demande à la société de gestion de les vendre pour lui. Dans cette optique, il est essentiel de bien vérifier que le nombre de parts en attente d’être vendues n’est pas trop important, ce qui pourrait entraver la sortie de la SCPI.
Le niveau d’endettement
Avant d’investir dans le patrimoine d’une SCPI, un comparatif du Loan-To-Value ratio (LTV) peut être instructif. Ce dernier est un indicateur financier utilisé pour évaluer le niveau d’endettement d’un investissement immobilier par rapport à la valeur de l’actif immobilier financé (montant du prêt / la valeur de l’actif financé x 100). Plus ce ratio est élevé, plus le risque lié à l’emprunt est important.
La variation du prix moyen (VPM)
Parmi les indicateurs de performance incontournables d’une SCPI, la VPM ou variation du prix moyen d’une part mesure l’évolution du prix de la SCPI.
Elle prend en compte l’écart entre le prix moyen d’acquisition de l’année N et le prix moyen d’acquisition de l’année N-1.
Ce taux de croissance annuel du prix moyen de la part est généralement compris entre 0 et 5 %. Une SCPI qui parvient à maintenir une VPM positive sur une longue période fait preuve d’une bonne gestion.
Les documents d’information
Pour juger de la qualité d’une SCPI, il est nécessaire de se munir au minimum de deux documents. Le rapport annuel de la société de gestion et les bulletins d’informations trimestriels : le premier reprend les principaux évènements intervenus dans la gestion de la SCPI et ses prévisions d’évolution. Le second recouvre les informations relatives à la SCPI durant le trimestre écoulé (capitalisation, nombre d’associés, taux d’occupation, etc.).
En définitive, vous l’avez compris, pour juger de la qualité ou de l’intérêt d’une SCPI, il existe un nombre important de critères à vérifier avant d’investir. Un « travail » qui peut être fastidieux. C’est la raison pour laquelle le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche de véhicules de placement. N’hésitez pas à nous contacter !
Succession : que peuvent faire des héritiers réservataires lésés ?
Lorsque les héritiers ne bénéficient pas pleinement de leur part de réserve sur la succession du défunt, ils peuvent intenter une action en justice pour défendre leurs droits.
Une fraction du patrimoine du défunt, la réserve héréditaire, doit en principe revenir à ses plus proches héritiers (ses enfants). Si ces derniers ne peuvent pas percevoir cette fraction en totalité, cela signifie notamment que des libéralités (dons, legs) trop importantes ont été réalisées. Pour défendre leurs droits, les enfants peuvent, selon les circonstances, engager une action en justice. Explications.
La reconstitution de l’actif successoral
Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession va répertorier la qualité et le nombre des héritiers, mesurer l’importance du patrimoine du défunt et lister les différentes libéralités qu’il a pu consentir. C’est seulement après avoir dressé cet état des lieux que le notaire sera en mesure de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.
Précision :
la quotité disponible est la part du patrimoine qui peut être librement attribuée par une personne à un héritier (réservataire ou non) ou à un tiers.
Puis, le notaire procédera à l’imputation de ces libéralités sur les différentes masses de biens composant la succession en fonction de leur nature et de la qualité des bénéficiaires. Ainsi, par exemple :
- si le défunt a gratifié un héritier réservataire, la donation est présumée constituer une avance sur sa future part successorale (on parle de donation en avancement de part successorale). Elle s’impute logiquement sur la réserve héréditaire. Étant précisé que lorsque la donation excède la part de réserve de l’héritier, le reliquat s’impute sur la quotité disponible ;
- si le défunt a souhaité avantager un héritier réservataire au-delà de ses droits, la donation est considérée comme faite hors part successorale. Cette donation s’impute alors directement sur la quotité disponible ;
- si le défunt a consenti une libéralité au profit d’un tiers, cette dernière s’impute sur la quotité disponible.
Après imputation, lorsque le montant de ces libéralités dépasse celui de la quotité disponible, cela signifie que la réserve héréditaire est entamée. Conséquence : les libéralités excessives devront être réduites.
L’exercice de l’action en réduction
Si un compromis entre les héritiers sur les « efforts » à consentir pour assurer à chacun ses droits successoraux ne peut être trouvé, une action dite « en réduction » pourra être mise en œuvre par les héritiers réservataires (acceptant la succession).
L’action en réduction doit être engagée devant le tribunal judiciaire dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la succession, ou dans les 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. À l’issue de la procédure judiciaire, et si le caractère excessif de la libéralité est constaté, la personne excessivement gratifiée devra, en principe, indemniser les héritiers en leur versant une somme d’argent ou en restituant le bien objet de la libéralité.
L’ordre des réductions
En pratique, ce sont d’abord les legs qui font l’objet d’une réduction avant les donations, quand bien même ils auraient été prévus antérieurement. La raison est simple : un legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur alors qu’une donation s’exécute immédiatement (par exemple, dès la remise d’une somme d’argent ou d’un bien).
Dans le cas de figure où plusieurs legs empiètent sur la réserve, ils sont alors réduits en même temps et proportionnellement à leur montant. Sont ensuite réduites les donations en procédant de la plus récente à la plus ancienne. Et si plusieurs donations ont été consenties au même moment, elles sont réduites proportionnellement à leur montant.
Et l’assurance-vie ?
Bien qu’il y ait de nombreux débats (jurisprudentiels et doctrinaux) autour de cette question, l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour priver les héritiers réservataires de la part minimale de patrimoine à laquelle la loi leur donne droit. Si tel est le cas, ces derniers peuvent mettre en œuvre une action en justice spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Cette action en justice façonnée par la jurisprudence s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger du caractère excessif ou non des primes versées. Les juges appréciant cette notion, au cas par cas, en tenant compte notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale) et de l’utilité du contrat.
Autre voie judiciaire que peuvent emprunter les héritiers : une requalification des versements sur le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Dans ce cadre, l’action vise à faire requalifier le contrat par le tribunal pour défaut d’aléa. Ainsi, par exemple, du fait du risque d’un décès très proche, l’intention libérale l’emporte sur toute autre considération. Le souscripteur n’ayant pas l’intention d’utiliser son contrat et démontrant ainsi sa volonté de se dépouiller de ses actifs.
Optimiser une transmission grâce à l’usufruit successif
Lors d’une donation avec démembrement de propriété, il est possible de mettre en place un usufruit successif. Une modalité qui permet de prolonger ce droit même après le décès du donateur.
Le démembrement de propriété est une pratique courante pour répondre aux besoins d’organisation patrimoniale des familles. L’usufruit qui en résulte est, par nature, temporaire et s’éteint au décès de l’usufruitier. Cependant, pour prolonger cette situation, il est possible de constituer un usufruit dit successif. Explications.
La transmission de l’usufruit
Lorsqu’un bien est démembré, l’usufruit peut appartenir à une ou plusieurs personnes, ce droit s’éteignant au décès de l’usufruitier. L’usufruit peut également être successif, c’est-à-dire constitué au profit de plusieurs personnes appelées à en jouir l’une après l’autre. Par exemple, une grand-mère, propriétaire d’un bien immobilier, souhaite transmettre la nue-propriété à son petit-fils tout en se réservant l’usufruit. Elle souhaite également que son fils puisse bénéficier du droit de jouissance de ce bien à son décès. Elle procédera alors à deux donations : la nue-propriété à son petit-fils et l’usufruit successif à son fils. Ainsi, à son décès, l’usufruit s’éteindra sans rejoindre la nue-propriété et un nouveau droit d’usufruit s’ouvrira au profit du fils. Ce n’est qu’au décès de ce dernier que le petit-fils deviendra plein propriétaire du bien.
La fiscalité liée à l’opération
Dans le cadre d’une transmission avec constitution d’un usufruit successif, des droits d’enregistrement sont dus. D’abord, la donation de la nue-propriété (au petit-fils dans notre exemple) sera taxée au jour de la donation en tenant compte de l’âge du premier usufruitier (la grand-mère). Ensuite, au décès de cette dernière, une nouvelle taxation au titre de l’usufruit successif interviendra, cette fois, en fonction de l’âge de son nouveau titulaire (le fils). Il est important de noter que cette méthode de taxation peut surtaxer le nu-propriétaire. Ainsi, l’administration fiscale lui accorde un droit à restitution partielle d’une somme équivalente à ce qu’il aurait payé en moins si le droit avait été calculé lors de la donation initiale d’après l’âge de l’usufruitier en second. Ce droit à restitution suppose, en pratique, que le nu-propriétaire ait bien réglé les droits de donation. La prise en charge de ces derniers par le donateur ferait obstacle à toute demande de restitution.
Gare au formalisme !
L’usufruit successif doit être expressément prévu dans l’acte de donation. Et attention, la clause doit être rédigée avec soin.
Les décisions patrimoniales à prendre avant la fin de l’année
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour profiter de certains régimes de faveur et pour optimiser votre stratégie patrimoniale.
La fin de l’année approche à grands pas. Et ces quelques semaines qui restent à courir peuvent être mises à profit pour adapter votre stratégie patrimoniale et pour bénéficier de certains avantages fiscaux. Tour d’horizon.
Faire preuve de générosité
Pour faire baisser la pression fiscale en 2025, vous pouvez consentir des dons à des associations d’ici le 31 décembre 2024. Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, de 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de la Fondation du patrimoine pour la conservation du patrimoine immobilier religieux.
Optimiser l’impôt grâce au PER
Autre solution pour profiter d’avantages fiscaux supplémentaires avant la fin de l’année, faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de se constituer un capital pour ses vieux jours, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :- 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 85 780 € maximum au titre de 2024 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 637 €.
Pour les versements effectués par les particuliers (salariés...), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 35 194 € en 2024 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 399 €.
Pour ceux qui sont d’ores et déjà titulaires d’un tel contrat, il peut être intéressant de réaliser des versements avant la fin de l’année de façon à pouvoir profiter à plein des plafonds de déduction fiscale. Des plafonds qu’il est d’ailleurs possible de mutualiser avec son conjoint. Ce qui permet à un membre du couple de profiter du plafond inutilisé de son époux(se) ou partenaire de Pacs.
Réaliser un investissement immobilier
Dernier appel pour le Pinel ! Au-delà du 31 décembre 2024, il ne sera plus possible de profiter de ce dispositif qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Étant précisé qu’aucun autre dispositif de faveur comparable ne viendra le remplacer.
Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer (nus) de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Son taux, revu à la baisse pour 2024, varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).
Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs (on parle alors de Pinel+) si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte des conditions de performance énergétique, d’usage et de confort.
Si vous manquez le coche cette année, sachez que vous avez toujours la possibilité d’actionner d’autres dispositifs immobiliers, comme le Denormandie qui court jusqu’au 31 décembre 2027. Un dispositif qui offre, lui aussi, aux contribuables qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (au taux de 12 % pour un engagement de location de 6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans).
Investir dans les PME
Sous certaines limites annuelles de versements, les souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale (dispositif IR-PME), réalisées en 2024 offrent un taux de réduction d’impôt fixé à 25 % au lieu du taux normal de 18 %.
Purger les plus-values
Lorsque votre assurance-vie a plus de 8 ans d’existence, vous bénéficiez, lors d’une opération de rachat, d’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à une imposition commune) qui s’applique sur les plus-values générées par votre contrat. En clair, en respectant le plafond de cet abattement et en réinvestissant dans la foulée les fonds retirés, vous convertissez les gains de votre contrat, susceptibles d’être fiscalisés, en versements qui ne seront pas imposés lors d’un futur retrait important. Une pratique qui peut vous faire économiser jusqu’à 1 178 € par an (application d’un PFU au taux de 12,8 % pour un contrat de plus de 8 ans dont les primes sont supérieures à 150 000 €). Toutefois, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sont toujours dus.
À cette occasion, pensez à réaliser ce type d’opérations prioritairement sur vos contrats les moins performants, offrant le moins d’options d’investissement ou les plus chargés en frais. Attention, n’oubliez pas que, lors du réinvestissement des sommes retirées, des frais d’entrée peuvent s’appliquer.
Dernier point d’attention, prenez également en compte le délai d’exécution de votre ordre de rachat. Ce dernier devant être réalisé impérativement avant le 31 décembre de l’année concernée.
Investir dans le septième art avec les Sofica
En investissant dans une société de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica), vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €.Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque, notamment, la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.Attention, il faut savoir que ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut ainsi être conscient que les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.
Acquérir un bien immobilier à rénover
Un bien immobilier ancien à rénover peut vous faire profiter d’un rendement attractif et constituer une opportunité de réaliser une belle plus-value.
L’achat d’un bien immobilier ancien nécessitant des travaux importants peut constituer une bonne opportunité pour les investisseurs à la recherche d’un bien à prix contenu et à rentabilité attractive. Explications.
Le charme de l’ancien
En vous tournant vers un bien immobilier ancien qui nécessite des travaux d’ampleur, vous pourrez obtenir des prix intéressants. En effet, ce type de bien se négocie généralement avec une décote allant de 10 à 30 %. Une décote qui, même après travaux, va vous permettre d’obtenir une rentabilité plus élevée qu’un bien neuf ou ancien déjà rénové.
À noter également qu’en rénovant un bien immobilier, vous augmentez vos chances de générer une plus-value au moment de la revente.
Attention toutefois, faites-vous accompagner par un professionnel du bâtiment lors des visites pour déterminer l’enveloppe des travaux.
En moyenne, comptez 1 300 € le m² pour une rénovation d’ampleur. Sachant évidemment que le coût de la rénovation sera fonction de la surface, des éléments à remplacer, de la complexité du chantier et de la qualité des matériaux et équipements choisis. La prestation sera évidemment plus chère si vous souhaitez du sur-mesure plutôt que des matériaux standards.
Si des travaux trop importants doivent être envisagés ou si votre budget ne peut pas suivre, passez votre chemin !
Autre intérêt, les biens anciens « dégradés » sont le plus souvent situés dans les centres-villes. Des emplacements où le marché locatif est généralement tendu et dynamique. Vous vous assurez ainsi d’attirer les candidats et de louer plus facilement votre bien.
Créer du déficit foncier
Afin d’alléger le coût des travaux de rénovation, vous pouvez jouer sur le levier fiscal. En effet, un bailleur qui loue un logement nu déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers.
Lorsqu’il est soumis à un régime réel, il peut déduire certaines charges qu’il a supportées pour la mise en location (travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation). Après imputation de ces charges, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut être imputé sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (21 400 € au titre de travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique).
Et si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes.
Attention :
l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.
Profiter des aides de l’État
Lorsque vous effectuez des travaux destinés à améliorer la performance énergétique d’un logement qui vous appartient, vous pouvez bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide est accessible notamment aux propriétaires occupants et bailleurs. En revanche, les personnes morales (par exemple, les SCI) n’y sont pas éligibles.
Cette aide financière de l’État vous est accordée sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, par exemple, le montant de la prime varie en fonction des ressources du foyer fiscal et des matériaux et équipements éligibles.
Il faut savoir que depuis 2024, l’aide MaPrimeRénov’ est déclinée en trois volets :
- MaPrimeRénov’ Parcours par geste désigne l’aide principale pour réaliser un ou plusieurs travaux d’isolation, changer son système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné ;- MaPrimeRénov’ Parcours accompagné , pour les travaux d’ampleur permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum ;- MaPrimeRénov’ Copropriété , pour la rénovation des parties communes en copropriété et pour les travaux d’intérêt collectif en parties privatives.
Pour connaître le montant de l’aide et déposer une demande, les contribuables doivent se connecter sur www.maprimerenov.gouv.fr.
Différentes pièces seront demandées pour constituer un dossier : devis des travaux envisagés, pièce d’identité, informations fiscales... Une fois la prime accordée, les travaux pourront débuter. Lorsque ces derniers auront été réalisés, les contribuables devront se connecter à nouveau sur le site de MaPrimeRénov’ et transmettre notamment des factures.
Quelques chiffres
11,6 % Selon une étude de SeLoger, un appartement renové fait augmenter en moyenne, le prix de vente de 11,6 %, comparé à un bien avec des caractéristiques équivalentes et dans un état standard. 7 % Ne pas oublier les frais de notaire qui représentent environ 7 % du prix d’achat.
Comment mutualiser ses plafonds d’épargne retraite
Un ordre d’imputation des cotisations retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou partenaires pacsés.
Les titulaires d’un Plan d’épargne retraite (PER) peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple de profiter des plafonds inutilisés de son conjoint. Une mutualisation qui doit respecter certaines règles. Explications.
Déclarer son épargne retraite
Les plafonds de l’épargne retraite sont calculés chaque année par l’administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d’ailleurs indiqués dans l’avis d’imposition.
Dans le détail, sont indiqués le plafond de l’année en cours mais aussi ceux des 3 dernières années. Sachant que si, au bout de 3 ans, l’épargnant n’utilise pas entièrement ses plafonds, ces derniers sont perdus définitivement.
Si l’épargnant souhaite profiter des plafonds de son conjoint, il ne doit pas oublier de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de la déclaration des revenus).
Suivre une méthode
Quelques règles doivent être respectées pour pouvoir utiliser les plafonds de son conjoint. Prenons un exemple. Patrick et Sophie sont mariés et n’ont pas d’enfants à charge. En 2023, Sophie a ouvert un PER individuel sur lequel elle a versé 35 000 €. Patrick n’a pas d’activité professionnelle. Sophie a perçu, entre 2020 et 2023, une rémunération nette de frais professionnels de 100 000 €. Pour imputer les cotisations versées par Sophie, il convient en premier lieu d’imputer les cotisations sur les plafonds de Sophie : sur le plus récent puis sur ceux des 3 années antérieures, du plus ancien au plus récent. Ensuite, le reliquat peut être imputé sur les plafonds de Patrick en suivant la même chronologie.
Au final, les cotisations auront épuisé intégralement les plafonds de Sophie et une partie de ceux de son mari à hauteur de 3 000 €.
À noter que l’année suivante, le reliquat du plafond de 2020 (1 052 €) sera définitivement perdu.
Imposition
| Revenu imposable | 100 000 € |
| Nombre de parts | 2 |
| Quotient familial | 50 000 € |
| Tranche marginale d’imposition | 30 % |
Plafonds de déduction
| Sophie | Patrick | |
| Plafond non utilisé pour les revenus de 2020 | 8 000 (1) | 4 052 (2) |
| Plafond non utilisé pour les revenus de 2021 | 8 000 | 4 114 |
| Plafond non utilisé pour les revenus de 2022 | 8 000 | 4 114 |
| Plafond calculé sur les revenus de 2022 | 8 000 | 4 114 |
| Plafonds non utilisés imputables sur les cotisations versées en 2023 | 32 000 | 16 394 |
(1) 10 % des revenus d’activité dans la limite de 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale.(2) Étant sans activité, le plafond de Patrick correspond à 10 % du plafond de la Sécurité sociale.
Comment réduire le montant de vos impôts
Tour d’horizon des principaux dispositifs et formules de placement qui vous permettront de réduire le montant de votre impôt sur le revenu 2024.
Vous avez déclaré récemment vos revenus 2023 et avez donc découvert votre niveau d’imposition. Une facture fiscale que vous aimeriez bien réduire pour 2024 et les années suivantes. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous pencher sur différents dispositifs qui vous permettront de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux dispositifs que vous pouvez utiliser.
Investir dans l’immobilier
Le dispositif Pinel
Si vous achetez un logement neuf ou assimilé afin de le louer, vous pouvez, sous certaines conditions (plafond de loyers, ressources du locataire...), bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel ». Le taux de cet avantage fiscal, calculé sur le prix de revient du logement (retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 € pour deux logements par an), varie selon la durée de l’engagement de location que vous aurez choisie.
Ce dispositif est réservé aux communes dans lesquelles le manque de logements est le plus important (zones A, A bis et B1) et aux territoires couverts par un contrat de redynamisation de site de défense, quelle que soit la zone géographique (A, A bis, B1, B2 ou C).
Mais attention, ce dispositif vit sa dernière année. En effet, les pouvoirs publics ne l’ont pas prorogé au-delà du 31 décembre 2024. Et aucun dispositif de faveur ne vient le remplacer.
Sans oublier que les taux de cette réduction d’impôt sur le revenu sont revus à la baisse pour 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, il est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).
Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs fixés, respectivement, à 12 %, 18 % et 21 %, si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte des conditions de performance énergétique, d’usage et de confort.
Le dispositif Denormandie
Le dispositif Pinel (rebaptisé ici « Denormandie ») a été élargi aux logements anciens faisant l’objet de travaux de rénovation ou d’amélioration situés dans une commune :- dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ;- ou située dans une zone labellisée Action Cœur de ville ;- ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).
En pratique, pour bénéficier du dispositif Denormandie, l’investisseur doit acquérir, entre le 27 mars 2019 et le 31 décembre 2027, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent notamment répondre à des exigences en matière de performance et de consommation énergétique. Des travaux devant représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.
Investir dans les bois et forêts
Pour défiscaliser, vous pouvez aussi investir dans des parcelles de forêts en souscrivant des parts de groupements forestiers d’investissement (GFI). Contre un apport en capital, les investisseurs reçoivent alors des parts sociales représentatives du patrimoine du GFI. Des parts qui permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 % du prix de leur acquisition, retenu dans la limite annuelle de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple.
Investir dans les entreprises
Acquérir des parts de FCPI ou de FIP
Pour réduire la pression fiscale, vous pouvez également investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations dans le capital de PME européennes.
Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie dans des titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur étant de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts (pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement). Ce type d’investissement permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. En effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des versements, plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié, à condition de conserver les parts du fonds pendant 5 ans.
Souscrire au capital de certaines PME
Une réduction d’impôt peut être accordée au contribuable qui effectue des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Ces versements peuvent être effectués directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding.
Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 18 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et soumis à une imposition commune.
À noter que le taux de la réduction est fixé, selon les cas, à 30 % ou à 50 % pour les souscriptions en numéraire réalisées entre 2024 et 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI). Dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.
Épargner pour sa retraite
Pour vous constituer une épargne retraite supplémentaire, vous pouvez souscrire un Plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de valoriser un capital, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS).
Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à la sortie.
En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :- 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 85 780 € maximum au titre de 2024 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 637 €.
Pour les versements effectués par les particuliers (les salariés notamment), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 35 194 € en 2023 ;- ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 399 €.
Bien entendu, au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, il existe bien d’autres solutions de défiscalisation, et notamment des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer, les Sofica ou encore le dispositif « Malraux ». Souvent performants, ils doivent pourtant être maniés avec précaution. D’autant plus qu’ils ne peuvent pas toujours se cumuler.
Si vous êtes tenté d’aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.
Les dons aux associations
Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, de 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis, soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de la Fondation du patrimoine pour la conservation du patrimoine immobilier religieux.
Comment déduire fiscalement le coût de vos travaux ?
Des travaux réalisés dans un bien locatif peuvent vous permettre de diminuer votre facture fiscale.
Vous possédez des biens immobiliers que vous louez ou que vous allez louer, et vous avez réalisé des travaux. Sachez que ces derniers peuvent être déduits fiscalement. Explications.
Les travaux déductibles
Le coût de la plupart des travaux peut être déduit du montant des loyers encaissés. Il s’agit des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration ainsi que, le cas échéant, des charges de copropriété.
Les travaux de réparation et d’entretien
Il s’agit des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en bon état, afin d’en permettre un usage normal, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement.
À titre d’exemple, on peut citer : le ravalement, le remplacement de la chaudière ou d’éléments de canalisations, la remise en état de la toiture, la réfection d’une installation électrique déjà existante et les dépenses liées à l’établissement des diagnostics. Ces dépenses sont déductibles, quelle que soit l’affectation des locaux (habitation, commerce, etc.).
Les réparations locatives sont, en principe, supportées directement par le locataire et donc non déductibles. Cependant, si elles sont prises en charge par le propriétaire, elles pourront être déduites dans les deux cas suivants :
- elles sont rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure (par exemple, les travaux de peinture effectués à la suite de la remise en état des conduits de fumée) ;
- elles sont engagées, avant l’installation d’un locataire, en vue de faciliter la location.
Les travaux d’amélioration
Les travaux d’amélioration sont ceux qui ont pour objet d’apporter au logement un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier la structure de l’immeuble. Il s’agit par exemple de l’installation d’un ascenseur ou d’un accès collectif à la fibre, de travaux de raccordement au réseau d’assainissement ou bien encore de travaux d’aération des pièces d’eau. Ces travaux sont déductibles s’il s’agit d’un logement.
Les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement
Les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles. Sont considérés comme tels les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et les travaux d’agrandissement qui augmentent le volume ou la surface habitable des locaux existants. De même, les travaux de démolition ne sont pas non plus déductibles.
Les travaux en copropriété
Lorsque le bien loué est situé dans un immeuble en copropriété, les travaux réalisés dans les parties communes peuvent également être déduits des loyers perçus par les copropriétaires bailleurs. Les dépenses déductibles sont les mêmes que pour les parties privatives. Ainsi, s’agissant de locations de logements, sont déductibles les travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration.
En revanche, les modalités de déduction des travaux sur les parties communes sont tout à fait différentes puisque ces dépenses sont incluses dans les charges de copropriété et déduites dans les conditions propres à ce type de charges.
Ainsi, chaque propriétaire bailleur doit, d’une part, déduire l’ensemble des provisions de charges payées l’année précédente (soit, en 2024, les provisions versées en 2023) et, d’autre part, réintégrer les charges non déductibles de 2022 dont l’arrêté est intervenu en 2023.
Comment procéder ?
Lorsque vous louez des locaux nus, vous déclarez vos revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la détermination du revenu imposable, vous ne pouvez déduire que les travaux que vous avez réalisés. Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque vous êtes imposé selon le régime dit du « micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges inhérentes au bien loué, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, vous devez, pour pouvoir imputer ces charges, être au régime réel. Après imputation de ces charges sur vos revenus fonciers, si un résultat négatif apparait, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur vos revenus.
Attention, des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur vos revenus. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition s’imputent en principe sur votre revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 €. Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur vos revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Attention : l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.
Aider ses enfants en leur donnant l’usufruit temporaire d’un bien
Outre ses avantages fiscaux, la donation temporaire d’usufruit permet notamment de procurer des revenus à ses enfants.
Pour aider leurs enfants (ou leurs petits-enfants) à financer leurs études ou se lancer dans la vie active, les parents peuvent leur consentir une donation temporaire d’usufruit d’un de leurs biens. Explications.
Qu’est-ce qu’une donation temporaire d’usufruit ?
La donation temporaire d’usufruit consiste pour une personne à transférer à l’un de ses enfants l’usufruit d’un de ses biens (un portefeuille de valeurs mobilières ou un logement locatif, par exemple) pour une durée limitée (souvent entre 5 et 10 ans). Ce qui permet au bénéficiaire de la donation (l’enfant) de percevoir les revenus générés par ce bien à la place du donateur (le parent) pendant cette période. Intérêt pour le donateur : il conserve la nue-propriété du bien pendant la durée de la donation et demeure certain de recouvrer sa pleine propriété au terme de l’opération. Il pourra donc profiter ultérieurement des revenus procurés par le bien. Mais attention, pour être valable, une donation temporaire d’usufruit doit être conclue devant un notaire et pour une durée minimale de 3 ans.
Comment sont calculés les droits de donation ?
La donation temporaire d’usufruit n’est pas sans incidence sur le plan fiscal, notamment en ce qui concerne les droits de donation. Et ce même si la valeur de la donation est réduite car elle ne porte que sur le seul usufruit et non sur la pleine propriété du bien.
En pratique, l’administration fiscale évalue forfaitairement la donation à 23 % de la valeur des biens dont le donateur a cédé l’usufruit temporaire par tranche de 10 ans. Ainsi, si l’usufruit d’un logement est donné pour 8 ans, et que la valeur de ce logement est estimée à 250 000 €, la valeur de l’usufruit transmis sera évaluée à 57 500 €.
Sachant que dans la majeure partie des cas, la donation se réalise en franchise d’impôt, compte tenu de l’abattement de 100 000 € dont bénéficient les enfants sur les donations consenties par leurs parents.
Un impact sur l’impôt sur le revenu
Consentir une donation temporaire d’usufruit présente aussi l’avantage de diminuer l’impôt sur le revenu du donateur puisque celui-ci ne percevra plus, pendant la durée de la donation, les loyers tirés de la location du logement ou les revenus issus des valeurs mobilières. Et en général, l’enfant qui reçoit l’usufruit ne devient pas imposable pour autant.
Ouvrir un Plan d’épargne retraite en étant déjà retraité
Contrairement aux idées reçues, rien n’interdit à une personne en retraite d’ouvrir un Plan d’épargne retraite.
Vous le savez, le Plan d’épargne retraite (PER) vise à encourager les Français à se constituer, durant leur vie professionnelle, un complément de revenus dont ils pourront jouir durant leurs vieux jours.
Pour autant, ce produit d’épargne peut être souscrit et conservé aussi durant la retraite. En effet, le Plan d’épargne retraite individuel est ouvert à tous. Il n’y a pas de conditions liées à la situation professionnelle (demandeur d’emploi, salarié, travailleur non salarié, gérant, retraité...) ou à l’âge. Ouvrir un PER tout en étant en retraite permet d’ailleurs de profiter de plusieurs avantages.
Optimiser sa fiscalité
L’un des atouts du Plan d’épargne retraite réside dans la faculté de l’épargnant de déduire de son revenu net global une partie des cotisations versées sur le contrat. Et même s’il ne perçoit plus de revenus d’activités, un retraité peut toujours profiter d’une déduction de 4 399 € par an. Un avantage non négligeable, surtout lorsque ses revenus sont importants (pensions, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…).
Par exemple, avec une tranche marginale d’imposition (TMI) à 30 %, le gain fiscal peut atteindre 1 319 € par an (pour une part fiscale). Et plus vous êtes imposé à une tranche élevée du barème de l’impôt sur le revenu, plus l’avantage est important. Ainsi, avec une TMI à 45 %, le gain fiscal monte à 1 803 €.
Préparer sa transmission
Le Plan d’épargne retraite, lorsqu’il est souscrit auprès d’une compagnie d’assurance, permet également de transmettre des capitaux dans un cadre fiscal avantageux.
En effet, si le bénéficiaire du PER est le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, il est exonéré de droits de succession. Pour les autres personnes (notamment les enfants), en cas de décès de l’assuré avant ses 70 ans, chaque bénéficiaire, désigné dans la clause du contrat, peut recevoir jusqu’à 152 500 € en franchise d’impôts. Entre 152 500 € et 700 000 € de capitaux transmis, un prélèvement de 20 % s’applique. Au-delà, son taux passe à 31,25 %.
Et lorsque le décès de l’assuré intervient après 70 ans, des droits de succession, calculés en fonction du degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré, sont appliqués après un abattement de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus).
La gestion de l’épargne
Par défaut, le Plan d’épargne retraite propose une gestion de l’épargne dite « à horizon ». Concrètement, il s’agit d’un mécanisme qui consiste à réaliser des arbitrages automatiques des unités de compte vers des actifs à faible risque (fonds en euros, par exemple), autrement dit à sécuriser la position au fur et à mesure que l’assuré s’approchera de l’âge de départ à la retraite. Pour un retraité qui ouvre un PER, l’idée est de jouer la sécurité d’entrée de jeu. Ainsi, il doit privilégier des supports d’investissement peu risqués comme les fonds en euros. Composés majoritairement d’obligations, ces supports offrent une garantie en capital et les intérêts générés s’ajoutent définitivement au capital investi, augmentant ainsi la valeur de l’épargne constituée.
Il est toutefois possible, pour les personnes souhaitant continuer à valoriser un capital, d’opter pour une gestion libre. Comme son nom l’indique, la gestion libre est une formule qui s’adresse à ceux qui souhaitent piloter librement leur contrat et décider de la répartition de leurs versements entre les fonds en euros et les unités de compte qu’ils auront choisis parmi ceux qui leur sont proposés par l’assureur. Bien évidemment, ce mode de gestion suppose d’avoir les connaissances suffisantes pour comprendre le fonctionnement des produits et des marchés financiers. Il nécessite également de la réactivité pour pouvoir réaliser les arbitrages qui s’imposent afin d’anticiper les baisses ou de profiter des mouvements haussiers.
Rédiger la clause bénéficiaire
Autre point à ne pas négliger pour rendre une transmission efficace : la rédaction de la fameuse clause bénéficiaire. Sachez que cette clause doit faire l’objet de la plus grande attention car si elle reste vierge ou est mal rédigée et ne permet donc pas de désigner un bénéficiaire, les capitaux peuvent réintégrer l’actif successoral de l’assuré. Il est donc recommandé de faire appel aux services d’un professionnel pour la rédaction de cette clause. Pour aider l’assuré dans sa démarche, les assureurs mettent à disposition des clauses dites standards. Des clauses qui répondent aux attentes les plus fréquentes des assurés souhaitant faire de leurs proches leurs bénéficiaires. Généralement, cette clause bénéficiaire standard est rédigée de la façon suivante et désigne comme bénéficiaire(s) : « mon conjoint, à défaut, mes enfants vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers ». En présence de cette clause standard, les capitaux seront entièrement attribués au bénéficiaire de 1er rang (à savoir le conjoint survivant). Les bénéficiaires de 2nd rang (les enfants…) n’ayant vocation à recueillir les sommes d’argent que si le conjoint survivant refuse le contrat ou décède avant la clôture du PER.
Cibler son contrat
Globalement, les assureurs acceptent que les retraités souscrivent un PER. Attention toutefois, certains d’entre eux peuvent appliquer des restrictions en fixant un âge maximal à la souscription, un âge maximal pour les versements et/ou une échéance pour la sortie en rente ou en capital. Avant de souscrire, pensez à vérifier l’ensemble des conditions du contrat qui vous est proposé.
Fonds en euros : bilan 2023 et stratégie 2024
Les fonds en euros retrouvent des couleurs. Des supports qui ont toute leur place dans une stratégie d’investissement.
Comme chaque année à la même période, les assureurs publient les performances 2023 de leurs fonds en euros. Malgré un contexte inflationniste et une économie au ralenti, les résultats sont plutôt réjouissants. En effet, en moyenne, les fonds en euros ont affiché un rendement de 2,50 %. Un rendement qui a fortement progressé puisque, selon l’ACPR, le taux moyen 2022 ressortait à 1,91 %. Un retour gagnant qui redonne aux fonds en euros leur rôle défensif dans une stratégie d’investissement.
Des résultats en hausse
Les établissements bancaires et les compagnies d’assurance qui proposent des fonds en euros mettent en avant leur principal avantage, à savoir la garantie du capital. En effet, au terme du contrat, ils sont tenus de rembourser l’épargnant d’une somme égale au montant des versements qu’il a effectués, augmentée des intérêts et après déduction des différents frais (de gestion, de sortie...). Pour être en mesure d’assurer cette garantie, les assureurs investissent majoritairement les primes des contrats dans des placements dits sans risques, comme les obligations : des titres de créances, émises généralement par les sociétés et les États pour emprunter sur les marchés. L’épargnant reçoit en contrepartie un intérêt annuel (le coupon) avant d’être remboursé au terme de l’emprunt.
En raison de la remontée des taux d’intérêt en 2023, nombre d’assureurs ont fait le plein d’obligations plus rémunératrices. Ce renouvellement d’actifs leur a permis d’obtenir des performances plus élevées et de proposer des rémunérations plus importantes qu’en 2022. Autre phénomène, pour booster le taux servi aux assurés, les établissements financiers ont pioché dans leurs réserves (de participations aux bénéfices). Rappelons que ces dernières sont des fonds dans lesquels chaque assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion de son fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps ou un bonus de rendement.
Des bons et des mauvais élèves
Contre toute attente, certains assureurs et mutuelles ont réalisé de très belles performances l’année dernière, s’approchant même du taux de l’inflation en 2023 (+4,9 %). C’est le cas de Corum Life, qui a créé la surprise en servant un rendement de 4,45 %. Suivi de la France mutualiste avec un taux de 3,70 % ou encore Garance avec un fonds en euros affichant 3,50 %. Le rendement délivré par la MACSF est également à souligner : 3,10 %, soit 0,6 point de plus qu’en 2022. D’autres ont également obtenu de bons résultats, comme Neuflize, qui a assuré à ses adhérents un taux d’intérêt de 3 % (1,60 % en 2022). Quant aux contrats de la MAAF et GMF (2,80 %), de Milleis (2,75 %), de la MIF (2,55 %) et de SMAvie (2,50 %), ils ont délivré des rendements plus modestes mais en progression entre 2020 et 2023. En bas du classement, on trouve les contrats de la CNP (2,30 %), d’Asac-Fapes (2,10 %), d’AG2R La Mondiale (2 %) et du Conservateur (1,10 %).
Intégrer des unités de compte à son contrat
Face à cette hausse des rendements, les fonds en euros ont de nouveau la cote. La collecte sur ces supports est, elle aussi, en nette progression. D’ailleurs, après avoir adapté leur stratégie aux conditions de marché, les établissements financiers se remettent à faire la promotion des fonds en euros. Certains commercialisent même de nouveaux fonds. D’autres ont levé la barrière à l’entrée qui imposait aux épargnants d’investir dans une quotité minimale d’unités de compte pour pouvoir accéder aux fonds en euros.
Bien que les rendements soient en hausse, il y a une ombre au tableau : les taux délivrés en 2023 restent insuffisants pour absorber l’inflation et éviter une perte de « pouvoir d’achat » pour les épargnants. Il faut donc continuer à aller chercher davantage de performance. Ce qui est possible en ajoutant une dose d’unités de compte au sein de son contrat.
À ce titre, contrairement à certaines idées reçues, les unités de compte ne sont pas exclusivement tournées vers les actions. En réalité, il est possible d’accéder à un très large choix d’investissements. Les UC pouvant, par exemple, comprendre des obligations, des actifs monétaires, des fonds flexibles ou encore de l’immobilier. Cette diversité peut être également géographique (Europe, États-Unis...) ou sectorielle (industrie, santé, énergie, télécommunication…).
Mais attention, la recherche de performance suppose une prise de risque. En effet, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Ainsi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut fortement diminuer. C’est la raison pour laquelle il convient de les conserver sur une longue période afin de lisser la performance dans le temps.
Quelles unités de compte choisir ?
L’offre en matière d’unités de compte est très étendue. Et grâce à cette diversité, chaque épargnant des supports d’investissement qui vont répondre au mieux à ses objectifs et au niveau de risques qu’il ne souhaite pas dépasser. Voici quelques exemples d’unités de compte qui ont tenu leurs promesses et ont performé ces dernières années.
Commençons par les produits structurés. Ces derniers sont des supports d’investissement dont la durée est connue à l’avance (4 ans, 6 ans…) et qui sont généralement constitués de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital et une composante optionnelle reposant sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement des fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent. Globalement, le rendement de ce type d’UC oscille entre 4 et 6 %.
Il n’est pas inintéressant non plus de se pencher sur les fonds thématiques. Des fonds qui investissent dans des sociétés développant leur activité dans des filières à fort potentiel (la santé, l’intelligence artificielle, l’accès à l’eau…) mais qui nécessitent un investissement important, à moyen ou long terme, afin de pouvoir générer des résultats durables. On pense, par exemple, aux sommes investies dans la thématique environnementale. Des sommes qui sont employées pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’adaptation au changement climatique.
L’intérêt de renoncer à une succession
Même si cela peut paraître contre-intuitif, la renonciation à succession peut avoir des vertus, à savoir se protéger ou protéger ses proches.
Dans le cadre d’une succession, trois options s’offrent aux héritiers. Accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. Cette dernière option peut, parfois, être la plus intéressante... Explications.
Pourquoi renoncer ?
Hériter d’un proche n’est pas toujours une bonne affaire. En effet, le défunt peut être criblé de dettes (créanciers, récupération d’aides sociales…). Le risque, en acceptant la succession, étant de devoir faire face à ce passif. Pour éviter cette issue, la renonciation peut être une bonne solution.
Autre raison qui peut pousser à renoncer à une succession : la volonté de gratifier la génération suivante. En effet, en renonçant, par exemple, à la succession de vos parents, vos propres enfants viendront hériter à votre place.
Une renonciation qui présente un double avantage. D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans devoir trouver les liquidités nécessaires dans son propre patrimoine.
D’autre part, fiscalement, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel très favorable du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.
Comment renoncer ?
L’héritier qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession d’un parent dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour se décider. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à choisir d’accepter ou de refuser la succession. Il doit ensuite faire connaître sa décision de refus.
Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*05) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Ce formulaire doit être accompagné de certaines pièces : une copie recto-verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.
Tout ou rien
La renonciation est un acte lourd de conséquences. En effet, le renonçant ne peut pas renoncer à une partie de ses droits seulement. Il renonce donc à tout. Et il ne peut pas non plus décider de la manière dont seront transmis les biens auxquels il renonce.
Préparer sa retraite avec le PER
Si vous souhaitez vous assurer un complément de revenu à la retraite, le PER est tout indiqué. Il vous offre de nombreux avantages tels que sa flexibilité et sa fiscalité très avantageuse.
Adoptée dans la douleur, la réforme des retraites a changé les règles du jeu, notamment celles du régime général : relèvement de l’âge légal de départ, allongement à 43 ans de la durée de cotisation requise pour pouvoir partir avec une pension à taux plein. Des mesures qui auront un impact sur votre agenda de départ à la retraite et peut-être aussi sur le montant de votre future pension. De ce fait, vous avez tout intérêt à anticiper et à vous constituer un complément de revenus afin de profiter au mieux de votre retraite. Pour ce faire, vous pouvez faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Présentation.
Le Plan d’épargne retraite : un produit dédié
Le Plan d’épargne retraite permet à toute personne, quels que soient son parcours et son statut professionnel, de se constituer, tout au long de sa vie active, une retraite complémentaire.
Concrètement, les épargnants peuvent, pendant leur activité, alimenter leur PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité qu’ils auront choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne est investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. Le souscripteur peut, de son côté, constituer son portefeuille avec des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte...). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat. Au moment de la retraite, l’assuré choisit alors la formule de sortie qui lui convient : le versement d’un capital pour utiliser ses fonds à son rythme ou le versement d’une rente viagère.
Pour aider les épargnants à atteindre leur objectif, banques et assureurs proposent une optimisation de la gestion de l’épargne retraite en tirant le meilleur parti de l’horizon de placement de long terme. Une allocation de gestion pilotée est ainsi proposée par défaut à chaque épargnant. Dans ce cadre, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne sera orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée.
Un régime fiscal attractif
Le PER offre un régime fiscal avantageux. En effet, les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles fiscalement du revenu de l’épargnant ou de son bénéfice imposable avec la possibilité de choisir son mode de déduction selon sa situation professionnelle (si on est travailleur non salarié, par exemple). Une option intéressante, notamment pour les foyers fortement imposés.
À la sortie, pour peu que l’assuré diffère son retrait d’au moins une année après la retraite, une partie du capital perçu sera imposée sur la base de ses revenus perçus à la retraite, généralement inférieurs au revenu d’activité.
Les intérêts, quant à eux, seront soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 %.
Enfin, pour simplifier la gestion de son épargne retraite, le PER permet de regrouper différents types d’épargne retraite, comme les PERCO, sur un seul et même contrat. Une possibilité intéressante à ne pas oublier.
Les plafonds d’épargne retraite déductibles
L’un des atouts majeurs du PER est d’offrir la possibilité de déduire ses cotisations de son revenu imposable. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que chacun peut découvrir en lisant son avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne ces plafonds d’épargne retraite. Ils correspondent aux sommes maximales qu’il est possible de déduire. Pour les calculer, une formule spécifique est appliquée au produit d’épargne choisi. Par exemple, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites de son revenu global ou de son revenu professionnel lorsque l’on est travailleur non salarié (TNS).
Il s’agit toutefois d’une option puisque chacun peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
- 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 81 384 € maximum au titre de 2023 ;
- ou 10 % du Pass, soit 4 399 €.
Pour les versements effectués par les particuliers (salariés...), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 32 909 € en 2023 ;
- ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 114 €.
Calculés automatiquement chaque année et pour chaque membre du foyer fiscal, les plafonds sont utilisables pendant 3 ans. C’est la raison pour laquelle l’avis d’imposition indique le plafond de l’année en cours, mais aussi ceux des trois dernières années. Et si, au bout de 3 ans, les plafonds ne sont pas utilisés, sachez que ces derniers sont définitivement perdus.
Comment utiliser ces plafonds ?
Si vous êtes déjà titulaire d’un PER et dans la mesure où la fin de l’année arrive à grands pas, il ne vous reste plus que quelques semaines pour procéder, si vous le pouvez, à des versements complémentaires sur votre produit d’épargne retraite pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles.
D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre contrat de retraite, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez la possibilité d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. Mais attention, n’oubliez pas, dans ce cas, de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de votre déclaration de revenus). Car cette mutualisation des plafonds entre conjoints n’est pas automatique.
Investir dans l’économie réelle avec le private equity
De nombreuses formules existent pour les particuliers qui souhaitent contribuer au financement des PME.
En France, le financement des PME et des ETI passe presque exclusivement par le système bancaire. Pourtant, les épargnants peuvent aussi apporter leur concours au financement de ces entreprises (on parle de « private equity » ou de capital-investissement). Voici quelques dispositifs qui peuvent être choisis dans ce but.
Les fonds de capital-investissement
Premier dispositif : les parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations en capital de PME européennes. Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie en titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales.
L’objectif pour l’investisseur est de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts. Sachant que, le plus souvent, il n’y a pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement. Avantage de ces fonds, lorsque les parts sont détenues depuis au moins 5 ans, les produits et les plus-values réalisés lors de la cession ou du rachat sont exonérés d’impôt sur le revenu. De plus, les souscriptions aux FCPI et FIP ouvrent droit chacune à une réduction d’impôt sur le revenu.
À noter :
il est possible d’acquérir des parts de fonds de capital-investissement via un compte-titres ou un PEA mais également sous forme d’unités de compte logées au sein d’une assurance-vie ou d’un Plan d’épargne retraite.
Le crowdfunding
En butte à des modèles de financement traditionnels trop rigides, de plus en plus d’entreprises se tournent vers le crowdfunding. Cette technique consiste à mettre en relation, via une plate-forme internet, un entrepreneur à la recherche des fonds nécessaires au démarrage de son activité ou au lancement d’un projet et un épargnant souhaitant investir en direct. En choisissant le « crowdequity » (crowdfunding en fonds propres), l’épargnant devient copropriétaire de l’entreprise dans laquelle il investit. En échange de sa contribution pécuniaire, il reçoit des actions ou des parts de la société. Il perçoit ainsi des dividendes et, le cas échéant, le produit des plus-values réalisées lors de la vente de ses titres. Pour encourager ce type d’initiative, ces opérations sont également éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu.
Devenir « business angel »
Le business angel est un particulier qui investit une partie de son patrimoine (dans l’espoir de réaliser une plus-value) dans le capital d’entreprises dites innovantes présentant un fort potentiel de croissance. Mais pas seulement ! Il met également ses compétences, son expérience, son carnet d’adresses ainsi qu’une partie de son temps à la disposition des entrepreneurs qu’il soutient. Il agit donc comme un véritable accompagnateur de l’entreprise à chaque étape du projet.
Le business angel peut apporter son aide dans tous les secteurs d’activités, pour peu qu’il développe certaines affinités avec l’entrepreneur et ait une bonne impression générale du projet. À noter d’ailleurs qu’il se gardera bien de devenir majoritaire au capital de la société pour laisser une plus grande autonomie au dirigeant.
Un business angel investit généralement de 5 000 € à 200 000 € (en moyenne 40 000 € par an) par entreprise, sachant qu’il lui est possible d’être « à la tête » de plusieurs projets simultanément. Sous certaines conditions, il peut, là encore, profiter d’avantages fiscaux venant réduire son impôt sur le revenu.
En France, de nombreux réseaux de business angels se sont développés. Ils permettent notamment de guider et de conseiller les nouveaux arrivants et de leur proposer des projets à soutenir.
Les incitations fiscales
Pour attirer les investisseurs, les pouvoirs publics ont mis en place des avantages fiscaux. Ainsi, le dispositif « Madelin » permet aux personnes qui investissent au capital de PME ou qui souscrivent des parts de FCPI ou de FIP de bénéficier, dans la limite d’un certain plafond (50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune), d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction étant fixé à 25 % pour les versements effectués du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023, et de 18 % pour les versements de début d’année.
Les frais à budgéter avant une acquisition immobilière
L’achat d’un bien immobilier engendre différents frais. Des frais souvent sous-estimés par les acquéreurs.
Lorsque vous prévoyez d’acquérir un bien immobilier, vous risquez de vous focaliser sur le seul prix affiché sur la vitrine de l’agence immobilière. Or, d’autres frais doivent être pris en compte pour se faire une idée plus ou moins précise du budget que vous devrez allouer à cette opération…
Les frais d’agence
Lorsque le vendeur fait appel aux services d’un agent immobilier pour promouvoir la vente de son logement, il s’engage à verser à ce dernier des frais d’agence.
En pratique, c’est l’acquéreur qui devra mettre la main à la poche. Le plus souvent, les frais d’agence sont intégrés dans le prix de vente (on parle de prix de vente FAI). Si ce n’est pas le cas, le montant des frais d’agence est indiqué dans l’annonce immobilière, en pourcentage du prix de vente. Prévoyez de rallonger votre budget de 3 à 7 % du prix de vente.
Les frais liés au dossier de financement
Le plus souvent, l’acquéreur doit obtenir un crédit immobilier auprès d’une banque pour financer son opération. Dans ce cadre, des frais sont, là encore, à prévoir.
Outre le remboursement du capital, des intérêts et de l’assurance-emprunteur, il faut aussi prendre en compte les frais de dossier. Ces derniers, représentant jusqu’à 1 % du montant total du prêt, sont facturés par l’établissement bancaire pour le temps passé à constituer et à étudier le dossier de prêt.
Autres frais liés au crédit immobilier : la constitution d’une garantie. Pour pouvoir faire face à d’éventuels impayés, les banques prennent des garanties sur les biens financés. Différents types de sûretés peuvent être mises en œuvre : l’hypothèque, le privilège de prêteur de deniers et le contrat de cautionnement.
Selon la garantie choisie, des frais peuvent être dus. En effet, pour qu’elles soient pleinement efficaces, ces garanties de prêt immobilier doivent être instrumentées dans un acte notarié puis enregistrées auprès de l’administration fiscale (au service de la publicité foncière). Le coût de ces formalités peut être estimé en moyenne à 2 % de la somme empruntée.
Sans oublier que si vous faites appel à un courtier pour obtenir un prêt (ce qui peut être très utile pour obtenir un bon taux d’intérêt), ses services ont un prix.
Comptez environ un forfait de 1 000 € ou 1 % du montant emprunté.
Les frais de notaire
Au moment de la signature de l’acte de vente définitif, vous serez redevable des fameux « frais de notaire ». Sachez que la plus grande part de ces frais correspond aux « droits de mutation ». Des taxes qui sont collectées par le notaire chargé de la vente et reversées aux pouvoirs publics. Le reliquat correspondant à la rémunération du notaire.
Comptez entre 2 et 3 % du prix du logement pour une construction neuve et 7 à 8 % pour un bien ancien.
Les impôts locaux
Avant d’acquérir un bien immobilier, il peut être opportun de se renseigner sur la fiscalité locale. Bien que la taxe d’habitation sur les résidences principales ait disparu, la taxe foncière subsiste.
En fonction de la situation géographique, la note peut être plus ou moins salée. Et tout laisse présager que le montant de cette taxe va continuer à progresser dans les années à venir. Par exemple, selon les derniers chiffres de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), le montant de la taxe foncière a bondi de 4,7 % en 2022 dans les 200 villes les plus peuplées de France.
À noter qu’au moment de la signature définitive de l’acte de vente, le notaire va opérer une répartition de la taxe foncière de l’année entre le vendeur et l’acquéreur. C’est donc le vendeur qui supportera le montant de la taxe foncière dû entre le 1er janvier et le jour de la vente et l’acquéreur le montant dû entre le jour de la vente et le 31 décembre.
Les charges de copropriété
En tant que nouveau propriétaire d’un appartement, vous devrez vous acquitter des charges dites de copropriété. Ces charges servent à financer, par exemple, l’entretien et la gestion des parties communes de l’immeuble (espaces verts, gardiennage, ménage, ascenseur…). Leur montant est calculé selon les tantièmes que le propriétaire détient dans la copropriété (eux-mêmes calculés notamment en fonction de la superficie du lot de copropriété).
Avant de s’engager à acheter un appartement, il est également conseillé de s’informer sur les éventuels gros travaux (typiquement un ravalement de façade, un remplacement de toiture…) votés ou programmés. Ce genre de travaux peut représenter des sommes importantes. Et chaque copropriétaire doit contribuer. Pour connaître l’état de la copropriété et des dépenses à venir, il convient de consulter les trois derniers PV de l’assemblée générale des copropriétaires.
Mariage : comment préserver ses fonds propres ?
Pour éviter que la présomption de communauté s’applique à une donation de somme d’argent, pensez à la déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres !
Vous avez reçu des donations de sommes de la part de vos parents ? Si vous ne souhaitez pas que cet argent « tombe » dans le patrimoine commun que vous avez constitué avec votre époux, vous devez prendre certaines précautions. Explications.
Une présomption de communauté
Lorsqu’un couple se marie sans avoir fait rédiger un contrat de mariage par un notaire, il se place, par défaut, sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Dans ce cadre, on distingue trois masses de biens : les biens communs et les biens propres de chacun des époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage, et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage (maison, voiture, somme d’argent…). Mais attention, si un époux n’est pas en mesure de prouver le caractère propre d’un bien, notamment dans le cadre d’une opération patrimoniale, une présomption de communauté s’applique. En clair, la loi considère alors que ce bien fait partie de la masse commune des époux.
Conserver le caractère propre d’un bien
Pour conserver le caractère propre des sommes d’argent reçues par donation, il convient de réaliser une déclaration d’emploi. Une déclaration à souscrire lorsqu’un époux utilise des fonds propres pour les investir dans l’acquisition d’un bien. Elle lui permet d’attester qu’il en est le seul propriétaire.
Pour que cette déclaration soit effective, le notaire doit indiquer, dans l’acte d’acquisition du bien, l’origine des fonds utilisés (deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre – dans ce dernier cas, on parle de « remploi ») et mentionner la volonté de l’époux de faire du bien acquis un bien propre. À noter que le conjoint ne peut pas s’opposer à cette déclaration. Toutefois, il peut en contester la validité en démontrant, par exemple, que les fonds employés appartenaient à la communauté.
Il faut savoir également qu’à défaut de déclaration d’emploi dans un acte d’acquisition, l’époux peut, avec l’accord de l’autre, en souscrire une a posteriori. Une déclaration qui peut être réalisée jusqu’à la dissolution de la communauté.
Précision :
en l’absence d’une clause d’emploi ou de remploi, le bien acquis est donc considéré comme un bien commun. Mais à la dissolution du régime matrimonial (par divorce ou par décès), l’époux qui a accru la masse commune grâce à des fonds propres peut demander une récompense. Cette dernière, due par la communauté, vient « l’indemniser » .
Crédit immobilier : s’assurer après 50 ans
Les banques sont souvent réticentes à octroyer un prêt immobilier aux emprunteurs d’un certain âge. Il existe toutefois des solutions pour tenter de les rassurer.
Quel que soit son âge, chacun peut avoir des projets à financer. Mais passé 50 ans, l’obtention d’un prêt immobilier peut être plus compliquée, notamment en raison de l’assurance-emprunteur. Explications.
La barrière de l’âge
Lorsqu’un particulier approche de l’âge de la retraite, il est plus difficile d’obtenir un prêt immobilier. En effet, la retraite signifie le plus souvent une baisse de revenus. Or, le niveau de revenus est évidemment un élément regardé de près par les banques. À noter également que l’âge de l’emprunteur va avoir une incidence sur la durée de remboursement. Un établissement bancaire considère qu’il est plus risqué d’accorder un crédit de longue durée à un senior aux revenus fixes qu’à un jeune actif dont la rémunération est amenée à évoluer.
Autre difficulté, en prenant de l’âge, les risques de santé vont croissant. Effet immédiat, lorsqu’un « senior » demande un financement auprès d’une banque, cette dernière peut lui opposer un refus ou, dans le cas où elle accepte, proposer un coût d’assurance très élevé (avec d’éventuelles exclusions de garanties). Une situation qui conduit, dans le contexte actuel (remontée des taux d’intérêts et niveau bas des taux d’usure), à exclure les seniors.
Pour tenter de contourner ces problématiques, une solution peut consister à améliorer son dossier en se tournant vers une assurance-emprunteur sur-mesure. En effet, un emprunteur n’est en rien obligé de souscrire l’assurance de la banque. Il peut s’adresser à un assureur qui lui proposera un contrat avec des garanties au moins équivalentes et à un tarif qui pourra être plus faible. Une assurance-emprunteur que le banquier ne pourra pas refuser.
S’assurer avec des risques de santé
La convention Aeras
Pour les personnes dont l’état de santé ne permet pas d’obtenir une assurance-emprunteur aux conditions standard du contrat (sans majoration de tarif ou exclusion de garanties), les pouvoirs publics et les professionnels du secteur ont mis en place la convention Aeras. Cette dernière vise à faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt aux personnes présentant un risque aggravé de santé du fait d’une maladie ou d’un handicap.
Dans le cadre de cette convention (qui s’applique automatiquement), l’assureur doit notamment appliquer le droit à l’oubli et une grille de référence. Cette dernière liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Elle liste également les maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.
Droit à l’oubli renforcé
Grâce à la loi « Lemoine » du 28 février 2022, le questionnaire médical est supprimé depuis le 1er juin 2022. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. Ainsi, depuis cette date, ce questionnaire n’est plus à fournir dès lors que le montant du crédit immobilier est inférieur à 200 000 € par emprunteur et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur.
Autre apport de cette loi, le droit à l’oubli est renforcé. Rappelons que le droit à l’oubli est un dispositif qui permet aux anciens malades atteints notamment de certains cancers de ne plus avoir à indiquer à une compagnie d’assurance leurs antécédents médicaux lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi « Lemoine », pour bénéficier du droit à l’oubli, le protocole thérapeutique des anciens malades du cancer devait avoir pris fin (et sans rechute constatée) depuis plus de :- 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 21 ans ;- 10 ans pour les cancers diagnostiqués après l’âge de 21 ans.
Désormais, le droit à l’oubli est fixé à 5 ans pour tous les cancers. Et il n’y a plus de distinction selon l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué. Une mesure qui s’applique depuis le 1er mars 2022.
Cryptomonnaies : des actifs volatils à manier avec précaution
Créées pour concurrencer les monnaies nationales, les cryptomonnaies sont rapidement devenues des actifs de placement très spéculatifs. La faillite de FTX, une des plus grandes plates-formes d’échange de cryptomonnaies, a mis un coup de projecteur sur le marché de ces actifs numériques. Pour leurs détracteurs, ce scandale montre le danger des cryptomonnaies ; pour les autres, il ne fait que rappeler qu’il existe des escrocs partout. Dans tous les cas, cette affaire représente une occasion de revenir sur les cryptomonnaies et sur les idées reçues qu’elles véhiculent.
1re idée reçue : le bitcoin est l’ancêtre des cryptomonnaies
Le bitcoin a été la première cryptomonnaie à être créée, ce qui lui a donné un avantage considérable en termes de notoriété et de reconnaissance.
Même si d’autres projets avaient été initiés avant le lancement du bitcoin, en 2008, c’est cette monnaie électronique qui a concrètement donné naissance aux cryptomonnaies. Créé par Satoshi Nakamoto (on ignore toujours qui se cache derrière ce pseudonyme), le bitcoin est une monnaie électronique émise et contrôlée non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme sécurisé, baptisé « blockchain », présent sur un réseau informatique décentralisé (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur). Pour ses créateurs, cette décentralisation fait du bitcoin une monnaie qui ne peut être instrumentalisée par les États. Sa valeur n’est donc définie que par l’offre et la demande. Le principe de fonctionnement du bitcoin a été repris par les cryptomonnaies créées par la suite.
2e idée reçue : il existe très peu de cryptomonnaies
Il existe actuellement des milliers de cryptomonnaies différentes en circulation. Cependant, il est vrai que certaines d’entre elles sont beaucoup plus populaires et répandues que d’autres.
Depuis la création du bitcoin, beaucoup d’autres monnaies électroniques ont vu le jour. CoinMarketCap, le site de suivi des prix des cryptoactifs, en recensait, le 4 janvier 2023, pas moins de 8 848 pour une capitalisation globale de 818 Md$. Près de 40 % de ce total était détenu en bitcoin et 19 % en ethereum.
3e idée reçue : la blockchain est inviolable
La blockchain est souvent considérée comme étant inviolable, mais elle peut être sujette à des vulnérabilités et à des attaques.
Il est vrai que la blockchain offre une protection très robuste aux cryptomonnaies en enregistrant, de manière indélébile, toutes les opérations (transactions, création de monnaie). En revanche, ce seul dispositif technique ne peut garantir ni l’inviolabilité ni l’intégrité des intermédiaires, les fameuses plates-formes telles que Coinbase et Binance, les plus connues. Des plates-formes que chaque acheteur/vendeur de cryptomonnaie va devoir utiliser. Par le passé, certaines d’entre elles ont été victimes de piratage : Poly Network s’est fait « aspirer » 600 M$ en 2021 et Bitfinex, 120 000 bitcoins en 2016 (1,8 Md€ au cours actuel). Sans parler de l’escroquerie dont ont été victimes les clients de FTX fin 2022.
Une escroquerie à l’ancienne
Sam Bankman-Fried, le créateur de FTX, est poursuivi pour avoir utilisé des fonds déposés par ses clients sur sa plate-forme d’échange de cryptomonnaies pour réaliser des opérations financières avec son autre société, le fonds de placements Alameda Research. Une escroquerie classique pour laquelle il encourt plus de 110 ans de prison.
4e idée reçue : les cryptomonnaies polluent
Les cryptomonnaies peuvent avoir un impact environnemental négatif en raison de leur consommation énergétique élevée.
Le processus de validation des transactions nécessite, pour garantir leur inviolabilité, des calculs très lourds qui mobilisent de nombreux ordinateurs reliés à la blockchain. Selon l’université de Cambridge, en 2022, la consommation électrique pour le seul bitcoin est estimée à 85 TWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la Finlande !
Heureusement, de plus en plus de cryptomonnaies abandonnent ce modèle de validation pour un système moins énergivore. L’ethereum a sauté le pas en octobre 2022. Selon ses porte-parole, sa consommation électrique (qui était de plus de 90 TWh en 2021) devrait baisser de plus de 99 %.
5e idée reçue : c’est un placement sûr et rentable
Les cryptomonnaies ne sont pas des placements sans risques. Elles sont particulièrement volatiles.
En janvier 2010, pour 10 €, vous auriez pu acheter plus de 3 000 bitcoins. Si vous les aviez oubliés au fond de votre disque dur, puis vendus en octobre 2021 (au plus haut de leur cote : 56 000 €), vous seriez à la tête de 168 M€ (avant impôts)… et si vous les aviez gardés, votre portefeuille de bitcoins ne pèserait plus que 47,5 M€ (cours du 04/01/2023).
L’ethereum a suivi le même parcours chahuté : 2 € en janvier 2016, 4 000 € en novembre 2021, 1 180 € en janvier 2023. Il faut donc avoir le cœur bien accroché et ne pas avoir besoin de son argent si l’on veut prendre position sur les cryptomonnaies. Sans parler du fait que leur cours n’étant fondé que sur l’offre et la demande, il est impossible de prévoir la moindre tendance. Et même lorsqu’elles sont adossées à des devises comme l’euro ou le dollar (on parle de stablecoin), leur stabilité n’est pas toujours assurée, à l’image de la cryptomonnaie Terra qui, le jeudi 12 mai 2022, a chuté de 99,8 % en quelques minutes, emportant dans sa chute 30 Md€. Vous l’aurez compris, s’il ne faut pas exclure par principe les cryptomonnaies de sa stratégie d’épargne, il faut rester très prudent comme avec tous les actifs volatils.
L’intérêt de passer de la location nue à la location meublée
La location meublée présente un certain nombre d’avantages. Son régime fiscal notamment mérite qu’on s’y intéresse.
Si vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez vide, la question de basculer vers la location meublée vous a peut-être déjà traversé l’esprit. Voici quelques éléments qui peuvent vous aider à nourrir votre réflexion.
Une fiscalité avantageuse
En raison des abattements et des amortissements dont il bénéficie, le régime meublé est plus intéressant que celui du foncier ou du micro-foncier. Ainsi, si vos recettes annuelles issues de la location meublée sont inférieures à 77 700 €, votre revenu imposable est déterminé par application aux recettes d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 % (régime dit « micro-bénéfices industriels et commerciaux » ou « micro-BIC »). Vous n’êtes donc imposé que sur 50 % de vos recettes. Mais corrélativement, vous ne pouvez déduire aucune charge.
Si votre activité de location dépasse 77 700 €, vous relevez du régime réel. Sachant que vous pouvez aussi opter pour le régime réel même si vos recettes n’excèdent pas ce montant. Dans ce cadre, vous pouvez alors imputer vos déficits d’exploitation sur vos bénéfices réalisés au cours de l’année et des 10 années suivantes (régime LMNP). Autre avantage, vous pouvez pratiquer l’amortissement du bien immobilier, c’est-à-dire déduire du résultat de chaque année, mais dans certaines limites, une annuité d’amortissement équivalente à la dépréciation théorique de l’immeuble. Ce régime permet aussi de déduire certaines charges pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, frais de gestion…).
Une rentabilité accrue
Du point de vue de la rentabilité, on observe généralement qu’un meublé affiche, en moyenne, un loyer supérieur de 15 à 30 % à celui d’une location nue pour un appartement comparable et à surface égale. Sachant que le rendement brut du bien loué meublé doit être, comme en location nue, minoré de l’ensemble des charges que supporte le bailleur (taxe foncière, charges de copropriété, travaux de remise en état, remplacement du mobilier…) et, le cas échéant, des frais de gestion et du coût de l’assurance contre les loyers impayés. Un rendement meilleur, certes, à condition toutefois que le logement soit occupé régulièrement. Car le taux de vacance locative en meublé est plus important qu’en location nue. Aussi, pour tenter de faire diminuer le risque de vacance, privilégiez autant que possible l’investissement dans un bien immobilier en centre-ville (ou proche du centre-ville) et dans une grande ville. En effet, les locataires recourant à la location meublée sont le plus souvent des étudiants ou des cadres en mission. Et sachez que plus vous équiperez votre logement convenablement et plus vous attirerez l’intérêt des candidats à la location. Sans compter qu’un loyer fixé au-dessus du prix du marché sera, dans ce cas, plus facilement justifiable.
Précision :
le bailleur d’un logement meublé doit prévoir au minimum onze éléments de mobilier : de la literie, comprenant couette ou couverture, un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambres à coucher, des plaques de cuisson, un four ou un four à micro-ondes, un réfrigérateur avec freezer, de la vaisselle nécessaire à la prise des repas, des ustensiles de cuisine, une table et des sièges, des étagères de rangement, des luminaires et du matériel d’entretien ménager.
L’intérêt des versements programmés sur un contrat d’assurance-vie
Les versements programmés sur un contrat d’assurance-vie permettent de se constituer un capital à son rythme.
Vous détenez un contrat d’assurance-vie et vous souhaitez vous constituer, sans vous en soucier, une épargne qui vous permettra de financer de futurs projets ? La mise en place de versements programmés peut être une bonne solution.
Une formule simple et souple
Outre le fait de pouvoir alimenter une assurance-vie par des versements libres, vous pouvez mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement et régulièrement. Avec l’aide du cabinet, vous déterminez le montant des versements, les supports sur lesquels seront investies ces sommes (fonds en euros et/ou unités de compte) et la périodicité des versements (mensuelle, trimestrielle...). À noter que cette solution est souple puisque vous avez la possibilité de moduler ces versements à la hausse ou à la baisse en fonction de votre capacité d’épargne mais également de les arrêter à tout moment.
Les avantages des versements programmés
Recourir aux versements programmés limite les risques lorsque l’on souhaite investir dans des unités de compte. D’abord, leur régularité permet d’accompagner les variations du marché et non de les subir. Étalés dans le temps, les achats d’unités de compte s’effectueront ainsi au prix moyen du marché sans risque de se positionner au plus haut de la cote comme avec un versement unique ou des versements très décalés. Ensuite, le montant de chaque versement étant, en principe, relativement faible, l’exposition au contexte du marché sera moindre que lors d’un gros versement.En définitive, les versements programmés sont un gage de tranquillité d’esprit pour qui souhaite investir en douceur dans les unités de compte.
Ce qui ne vous interdit pas, à l’occasion d’une rentrée d’argent, d’effectuer un versement libre plus important. Mais dans cette hypothèse, il est conseillé de vous faire accompagner par le cabinet pour investir dans des supports correspondant à vos objectifs patrimoniaux, à votre horizon de placement et à votre appétence au risque.
Une épargne pour votre retraite
Les versements programmés peuvent vous aider à vous constituer une épargne en vue de votre retraite. En épargnant régulièrement, votre effort d’épargne sera allégé. Et plus vous commencerez à épargner tôt, plus votre épargne aura le temps de fructifier. À l’arrivée de la retraite, vous pourrez bénéficier d’un complément de revenu sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital.
Comment investir de façon durable ?
La finance durable prend de plus en plus d’ampleur. Selon les derniers chiffres publiés par Novethic, un des principaux médias de référence de l’économie responsable, elle représentait, au 31 décembre 2021, environ 737,5 Md€ d’encours (encours sous gestion englobant ceux des labels ISR, Greenfin et Finansol), soit une progression d’environ 92 Md€ par rapport à 2020. Une tendance qui montre que les Français sont de plus en plus soucieux des impacts que peuvent avoir leurs comportements, y compris en matière d’épargne. Zoom sur ce type d’investissement.
Un univers de pratiques
La finance durable recouvre plusieurs pratiques d’investissement qui peuvent avoir des objectifs différents.
Selon la Banque de France, la finance durable désigne l’ensemble des pratiques financières visant à favoriser l’intérêt de la collectivité sur le long terme. L’expression « finance durable » recouvre trois concepts : la finance socialement responsable, la finance verte et la finance solidaire.
La finance socialement responsable
Plus connue sous l’acronyme ISR, la finance socialement responsable est une approche qui consiste à sélectionner des produits financiers (actions, obligations, supports d’investissement…) en s’appuyant principalement sur trois critères liés au développement durable :1- un critère environnemental, qui mesure l’impact « écologique » de l’activité de l’entreprise ;
2- un critère social ou sociétal, qui évalue le comportement de l’entreprise en termes de valeurs humaines vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients, de ses fournisseurs ;
3- un critère de gouvernance, qui identifie la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Globalement, l’ISR vise à favoriser le financement des entreprises et des entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d’activité.
À côté de ces critères « éthiques ou sociétaux », bien entendu, les sociétés de gestion qui proposent des produits d’investissement ISR ne négligent pas, comme pour un investissement traditionnel, les critères financiers. Il s’agit d’identifier les points forts et les points faibles de l’entreprise en s’appuyant sur l’analyse de ses comptes, de son secteur d’activité, de sa performance économique, de son niveau de valorisation ou de ses perspectives de développement, et de ses choix stratégiques.
La finance verte
La finance verte recouvre, quant à elle, les initiatives et réglementations qui visent à faciliter les investissements avec impact positif sur l’environnement (milieux, écosystèmes) en favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Il s’agit de pratiques financières ayant une thématique plus ciblée car concentrées exclusivement sur le pilier environnemental. Pour atteindre ces objectifs, la finance verte repose sur plusieurs instruments et mécanismes, tels que les obligations vertes, les fonds verts ou environnementaux, la régulation ainsi que la politique monétaire et financière. La rentabilité financière est également un élément pris en compte au sein d’un fonds d’investissement dédié à la finance verte.
La finance solidaire
La finance solidaire a pour objectif de faciliter le financement de projets destinés à lutter contre l’exclusion et à améliorer la cohésion sociale. L’épargne récoltée via des véhicules d’investissement solidaire est ensuite orientée vers des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale. L’objectif recherché, qui n’est pas financier, est, par exemple, de favoriser la réinsertion ou la solidarité internationale, de lutter contre le chômage ou contre le mal-logement. Un investisseur (entreprise ou particulier) peut également décider d’investir directement sous forme d’actions dans le capital d’entreprises solidaires. Enfin, des prêts peuvent également être attribués aux particuliers sous forme de microcrédits ou de prêts solidaires. On parle alors de financements solidaires.
Différentes pratiques
Dans l’univers de la finance durable, toutes les sociétés de gestion n’ont pas la même approche. Certaines vont sélectionner dans leurs fonds des valeurs dites « best in class » (les entreprises les plus vertueuses dans un secteur d’activité donné) ou des valeurs « best in universe » (les entreprises présentant les meilleurs résultats en général) ou encore des valeurs « best effort » (les entreprises reconnues pour leurs efforts). D’autres peuvent également pratiquer la sélection par l’exclusion (exclusion des secteurs de l’armement, du tabac, des jeux d’argent, des énergies fossiles…).
Comment investir ?
Investir de façon durable est à la portée de tous. De nombreuses enveloppes d’investissement proposent ce type d’actifs.
Longtemps réservés aux investisseurs institutionnels, les particuliers peuvent désormais profiter de fonds dédiés à la finance durable. Par exemple, certaines compagnies d’assurance ont développé des offres à thématique environnementale pour soutenir l’économie bas carbone et améliorer la qualité de l’air ou encore optimiser les consommations d’eau et limiter la pollution d’une ressource fragile. Pour la finance solidaire, certains établissements proposent des livrets dédiés. La collecte venant aider à financer divers projets liés au développement durable, au logement social, au commerce équitable, à l’environnement, au micro-crédit pour les TPE.
En réalité, il est très simple d’investir dans la finance durable. Ces supports d’investissement sont accessibles via l’assurance-vie (unités de compte), le Plan d’épargne retraite, le compte-titres ou encore le Plan d’épargne en actions.
D’ailleurs, pour aider les investisseurs dans leurs démarches, les pouvoirs publics ont mis en place des labels qui permettent d’identifier facilement les fonds pratiquant une forme de la finance durable et de leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité.
Au nombre de trois, ces labels sont : le label ISR pour la finance socialement responsable, Greenfin pour la finance verte et Finansol pour la finance solidaire.
Pour aller plus loin, la législation a même imposé, depuis le 1er janvier 2022, à tous les établissements financiers (banque, assurance, mutuelle…) de proposer au moins une unité de compte affichant le label ISR, une autre le label Greenfin et une autre encore le label Finansol.
Et la performance ?
Contrairement aux idées reçues, la finance durable produit des résultats positifs en termes de rendement.
Dans la 13e édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’investissement responsable (FIR) confirme l’intérêt des Français pour l’investissement responsable dans leurs décisions de placement auprès des établissements financiers ou d’assurance. 60 % d’entre eux accordent prioritairement de l’importance aux sujets liés aux pollutions et aux droits humains, au changement climatique et au bien-être au travail. Toutefois, certains d’entre eux hésitent à sauter le pas de peur d’obtenir des rendements en deçà de leurs espérances. Un risque à relativiser. Selon une étude du FIR et de l’École polytechnique, en 2020, 62 % des fonds labellisés ISR se sont révélés plus performants que les fonds dits « classiques » :- les actions dans 59 % des cas ;- les obligations dans 52 % des cas ;- les produits diversifiés dans 82 % des cas ;- les fonds monétaires dans 85 % des cas.
Inflation : comment amortir le choc ?
Les forts niveaux d’inflation peuvent menacer la valeur et le rendement de votre épargne. Toutefois, certains dispositifs peuvent vous aider à tirer votre épingle du jeu.
L’inflation galopante pèse sur le pouvoir d’achat et le moral des ménages. La flambée du coût de la vie renforce aussi les inquiétudes concernant leur épargne alors que la tempête continue de souffler sur les marchés financiers. Dans ce contexte anxiogène, certaines solutions peuvent être mises en œuvre afin d’amortir le choc. Explications.
Diversifier son contrat d’assurance-vie
Les fonds en euros de l’assurance-vie risquent aussi de souffrir du contexte économique ambiant. En effet, avec une remontée des taux d’intérêt, les obligations composant majoritairement ces fonds ne vont pas pouvoir délivrer un rendement suffisant pour contrer l’inflation. Le rendement moyen 2022 est ainsi attendu en baisse de 0,1 à 0,2 point par rapport à l’année dernière, soit à 1,1 %. Trop peu avec une inflation record. Toutefois, certains professionnels s’accordent à dire que certains assureurs pourraient utiliser leurs réserves (les provisions pour participation aux bénéfices) afin de soutenir la performance et annoncer des taux de l’ordre de 2,10 %. Un taux qui dépasserait symboliquement celui du Livret A.
Afin de contrer cette perte de rendement, il peut être intéressant de diversifier son contrat en investissant dans des produits qui résistent mieux à l’inflation comme, notamment, les unités de compte en immobilier.
Le rempart de la pierre
Les dispositifs d’investissement locatif
Pour faire face à l’inflation, l’investissement dans l’immobilier est une solution de choix. En effet, avec la hausse des prix, sa valeur a plutôt tendance à s’apprécier. Et son rendement suit cette tendance grâce à une indexation des loyers sur l’inflation, même si cette dernière est temporairement plafonnée à 3,5 %.
En outre, pour vous permettre de vous constituer un patrimoine immobilier dans un cadre fiscal avantageux, les pouvoirs publics proposent différents dispositifs. On pense notamment au fameux dispositif Pinel. Si vous faites construire ou si vous achetez un logement neuf ou ancien à réhabiliter afin de le louer, vous pouvez, sous certaines conditions (plafond de loyer, ressources du locataire...), bénéficier de ce dispositif. Ce dernier ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement, varie selon la durée de l’engagement de location que vous aurez choisie (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).
La pierre-papier
Autre solution pour les investisseurs qui ne veulent pas subir les contraintes liées à la location immobilière (gestion locative, entretien…), faire appel aux SCPI. Ces dernières permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement ou une maison. L’investissement porte, en effet, sur l’acquisition de parts de capital de sociétés (les SCPI) qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent. Autre intérêt, le ticket d’entrée est généralement fixé à quelques centaines d’euros.
À noter que la pierre-papier est un produit d’épargne performant. En 2021, les SCPI ont délivré un taux de distribution moyen de 4,45 % (chiffres IEIF et ASPIM). Un rendement en progression par rapport à 2019 (4,40 %) et 2020 (4,18 %). Des chiffres qui montrent que les SCPI, en plus d’être rémunératrices, ont été résilientes depuis le début de la crise du Covid-19. Un placement « anti-crise » pour plusieurs raisons. D’une part, avec une collecte importante ces dernières années, elles disposent de réserves de liquidités qu’elles pourront utiliser pour combler un éventuel manque à gagner dans les mois à venir. D’autre part, bon nombre de SCPI ont accumulé des plus-values qui constituent un autre matelas de sécurité en cas de baisse de la valeur de leur patrimoine.
Pour vous aider à trouver les solutions adaptées à votre profil, n’hésitez pas à contacter votre conseil.
Des produits opportunistes
Autre moyen d’action, sélectionner au sein de son portefeuille de titres (PEA, compte-titres…) des valeurs qui vont profiter du contexte inflationniste. Il peut s’agir de valeurs liées au secteur de l’eau, de l’énergie, de la grande consommation ou de la santé. À l’inverse, on évitera les secteurs durablement touchés par l’inflation, comme l’automobile, l’informatique ou encore les loisirs.
Éviter l’épargne réglementée
Les produits d’épargne réglementée représentent une part importante dans le patrimoine financier des Français. Le plus connu, le fameux Livret A, est détenu par plus de 55 millions de personnes. Il dispose d’encours de l’ordre de 489 milliards d’euros à fin juin 2022 (encours comprenant ceux du LDDS). Plusieurs arguments plaident en sa faveur : liquidité, garantie et absence de fiscalité. Mais il ne protège plus de l’inflation depuis quelque temps déjà. Le Livret A, dont le taux est passé à 2 % au 1er août 2022, reste peu rémunérateur si l’on tient compte de l’inflation. Cette dernière s’est élevée à 6,2 % sur un an en octobre 2022. Résultat, le rendement réel du Livret A est négatif de plus de quatre points. Le Plan d’épargne logement et le Compte épargne logement sont également à la peine avec des taux respectifs de 1 % et de 1,25 %.
En clair, en période inflationniste, l’épargne réglementée ne permet pas de protéger l’épargnant contre l’érosion monétaire. À éviter donc, sauf pour se constituer une petite épargne de précaution !
Comment réduire le montant de votre IFI ?
Après avoir reçu votre avis d’impôt durant l’été, vous avez peut-être pris la décision de réduire votre facture fiscale. Et si vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), il vous reste encore quelques semaines pour agir. Tour d’horizon des principaux dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Réaliser des dons
Faciles à mettre en œuvre, les dons permettent de réduire l’impôt rapidement.
Il s’agit d’une des solutions les plus simples et rapides pour réduire le montant de son IFI, surtout lorsque l’on s’approche de la date fatidique de dépôt de la déclaration, les versements ouvrant droit à une réduction d’IFI pouvant être effectués jusqu’à cette date. En effet, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général permettent une réduction d’impôt égale à 75 % des versements, retenus dans la limite de 50 000 € par an.
Réduire sa base taxable
Certains outils juridiques permettent d’exclure des actifs immobiliers de la base taxable à l’IFI.
Vendre des biens immobiliers
Afin de réduire sa base taxable à l’IFI, une solution radicale existe : vendre une partie de ses actifs immobiliers. On privilégiera d’ailleurs les biens immobiliers peu rentables ou non utilisés. Attention toutefois, la vente de biens immobiliers peut déclencher l’imposition des plus-values. À moins que vous ne déteniez votre bien immobilier depuis suffisamment longtemps pour être exonéré de cet impôt par le jeu des abattements pour durée de détention. Pour rappel, vous êtes exonéré d’impôt sur la plus-value au bout de 22 ans de détention, et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention.
Recourir à la donation temporaire d’usufruit
Cette stratégie est souvent mise en place dès lors que le redevable de l’IFI a des enfants majeurs qui suivent des études supérieures (souvent longues et de plus en plus coûteuses). Elle consiste à effectuer une donation temporaire d’usufruit (pour une durée comprise généralement entre 5 et 10 ans) par un acte authentique reçu par un notaire, le contribuable conservant la nue-propriété du bien immobilier et ses enfants recevant l’usufruit.
Ainsi, ces derniers pourront librement recueillir tous les loyers durant la période de démembrement afin de financer leurs études et dépenses de la vie courante. En contrepartie, le donateur n’aura pas à déclarer la valeur du bien immobilier à l’IFI jusqu’à la reconstitution de la pleine propriété, qui interviendra au terme de la donation.
Toutefois, cette opération ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où les enfants majeurs ne sont pas rattachés au foyer fiscal du ou des parents donateurs, car la valeur de la pleine propriété du bien doit être déclarée par les usufruitiers.
Il faut savoir aussi qu’elle n’est pas neutre fiscalement car l’administration fiscale perçoit à ce titre des droits de mutation à titre gratuit qui peuvent toutefois être réduits par le jeu de l’abattement en ligne directe. Mais attention, la réalisation d’une donation temporaire d’usufruit doit être justifiée, c’est-à-dire répondre à un réel besoin du bénéficiaire (comme l’obligation alimentaire en faveur du descendant ou de l’ascendant). Étant suspicieuse sur ce type d’acte, l’administration fiscale n’hésite généralement pas à remettre en cause l’opération via la notion de l’abus de droit.
L’acquisition d’un bien en nue-propriété
Autre solution, l’achat en nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit est cédé de manière temporaire (au minimum 15 ans), le plus souvent à un organisme locatif social. Concrètement, l’investisseur conserve la nue-propriété du bien et dispose, à ce titre, de la propriété des murs mais pas du droit d’occuper le bien, de le louer et d’en percevoir les revenus.
L’avantage au regard de l’IFI est important dans la mesure où, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, la valeur du bien n’entre pas dans le patrimoine taxable du nu-propriétaire.
Investir dans des actifs exonérés
Certains types de biens ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’IFI.
Investir dans les bois et forêts
Les biens professionnels ne sont pas imposables à l’IFI. Et lorsque les bois et forêts ne constituent pas de tels biens, ils bénéficient d’une exonération partielle d’IFI à concurrence des ¾ de leur valeur, sous réserve de respecter deux conditions :- le propriétaire doit s’engager à les exploiter pendant 30 ans ;- le propriétaire doit produire un certificat du directeur départemental de l’agriculture attestant que les biens présentent une garantie de gestion durable et un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable (à renouveler tous les 10 ans). Les parts de groupements forestiers, fonciers agricoles ou viticoles bénéficient, sous conditions, de la même exonération de 75 %.
Souscrire des actions de foncières cotées
La cotisation d’IFI n’est pas impactée en cas de placements dans les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC). Ces dernières sont des sociétés foncières, le plus souvent des sociétés anonymes, cotées sur un marché réglementé français ou étranger. Leur objet consiste à donner en location des immeubles qu’elles acquièrent ou qu’elles font construire. Ces opérations leur permettent ainsi de percevoir des loyers et, le cas échéant, des plus-values lors de la cession d‘éléments d’actifs. À noter que les SIIC ne sont pas une spécificité française. Il en existe partout en Europe et également outre-Atlantique, où elles sont connues sous le nom de REIT. Concrètement, ces titres de sociétés foncières permettent d’investir, via un compte-titres, à la fois en bourse et dans l’immobilier. Et ce sans avoir à gérer les inconvénients de la détention d’un bien en direct (gestion administrative, sélection des locataires…).
Et surtout, ces actifs immobiliers sont exclus formellement de l’assiette de l’IFI (contrairement aux SCPI et OPCI). À condition toutefois que l’investisseur détienne, directement ou indirectement, seul ou conjointement, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.
Plafonnement de l’IFI
Comme pour l’impôt de solidarité sur la fortune en son temps, un système de plafonnement s’applique. Ainsi, le total formé par l’impôt sur la fortune immobilière et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 75 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’IFI à payer.
Bien évaluer vos actifs
Pour optimiser votre déclaration d’IFI, pensez à vérifier si les valeurs retenues pour vos actifs immobiliers sont justes. Pour vous aider, l’administration fiscale met à votre disposition sa base de données « Patrim ». À partir de critères que vous sélectionnez, Patrim vous restitue une liste des ventes immobilières intervenues durant la période recherchée et sur le périmètre géographique choisi.
Comment mettre de l’immobilier dans un contrat d’assurance-vie
Pour diversifier leur contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent faire appel à la pierre-papier.
En faisant le choix de l’assurance-vie multisupports, les épargnants peuvent répartir leur investissement sur une grande variété de supports en unités de compte (UC). Présentation d’un de ces supports : les unités de compte en immobilier.
Différentes façons d’investir
Il est possible de mettre de l’immobilier dans son assurance-vie en investissant dans des unités de compte particulières : les SCPI, les OPCI et les SCI. Ces supports ayant vocation à acquérir et à gérer des biens immobiliers (immeubles de bureaux, commerces, établissements de santé, logements…). Particularité, les OPCI et les SCI peuvent, contrairement aux SCPI, investir une quotité plus ou moins importante de leur patrimoine dans d’autres actifs financiers cotés ou non (actions immobilières, SCPI, OPPCI, OPCI grand public...). Pour les SCPI et les OPCI, les loyers issus de la location de biens sont, le plus souvent, redistribués à l’épargnant sous forme de dividendes. Pour les SCI, les revenus générés sont capitalisés et viennent augmenter la valeur de la part.
L’intérêt de ces UC
Investir dans ce type d’unités de compte présente plusieurs avantages. D’abord, cela vous donne accès à des actifs immobiliers sans avoir à gérer les contraintes liées au financement d’un bien ou à sa détention en direct (gestion et recherche de locataires, sélection et vérification des dossiers, encaissement des loyers, réalisation de travaux et d’aménagements…). Sans parler du fait que le ticket d’entrée n’est que de quelques centaines d’euros.
Ensuite, vous diversifiez votre contrat et ainsi vous maximisez vos chances d’améliorer son rendement. Une démarche opportune puisque la performance des fonds en euros s’érode d’année en année. Par exemple, en 2021, le rendement délivré par les UC SCPI, OPCI et SCI était respectivement de 4,45 %, 4,4 % et 3,8 %.
Enfin, la fiscalité qui est appliquée est celle de l’assurance-vie. Un cadre fiscal bien plus avantageux que celui qui pèse sur la détention en direct d’un bien immobilier ou de parts de SCPI (imposition, en principe, au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers).
Quelques points de vigilance
Contrairement aux fonds en euros, les unités de compte n’offrent pas de garantie en capital. Ainsi, en cas de dégradation du marché immobilier, leur valeur peut fortement diminuer. Autre inconvénient, des frais d’entrée et de gestion sont, le plus souvent, prélevés par l’assureur. Ce qui vient grever la performance de ces supports. Enfin, l’épargnant n’a accès qu’aux unités de compte sélectionnées par son assureur. Selon les contrats, le choix peut donc être plus ou moins limité.
Les charmes du Plan d’épargne retraite
Issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER), qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Un produit d’épargne qui connaît un succès grandissant depuis son lancement en octobre 2019. Selon France Assureurs, à fin mars 2022, le seuil des 3 millions d’assurés détenteurs d’un PER a été dépassé, pour un encours total de 37,8 Md€. Un succès qui peut s’expliquer par le fait que le PER possède des atouts non négligeables. Explications.
Un produit performant
À l’instar de l’assurance-vie, le Plan d’épargne retraite permet d’investir dans différents supports : fonds en euros et unités de compte.
Pour préparer leur retraite, les épargnants peuvent, pendant leur activité, alimenter leur PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne est investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. Le souscripteur peut, de son côté, choisir entre des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte...). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat et espérer un rendement dynamique.
Pour aider les épargnants à atteindre leur objectif, les établissements financiers proposent une optimisation de la gestion de l’épargne retraite en tirant le meilleur parti de l’horizon de placement de long terme. Une allocation de gestion pilotée est ainsi proposée par défaut à chaque épargnant. Dans ce cadre, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne sera orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions d’entreprise. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée.
Cette gestion pilotée (ou à horizon) doit aussi proposer trois profils d’investissement avec des niveaux de risque différents : un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Sachant que, sans action de la part de l’épargnant, les versements sont affectés selon une allocation correspondant à un profil équilibré. Mais s’il le souhaite, le souscripteur peut choisir de piloter seul son contrat et de réaliser sa propre allocation d’actifs.
Un produit souple
Bien que l’épargne versée soit bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré, ce dernier peut, dans certains cas définis par la loi, profiter d’un déblocage anticipé.
En tant que dispositif de retraite, le capital accumulé dans un PER est bloqué jusqu’au départ en retraite du titulaire. Toutefois, le déblocage anticipé des sommes épargnées est possible, mais seulement dans certaines situations exceptionnelles, comme le décès du conjoint de l’épargnant (époux ou partenaire de Pacs) est l’une d’elles. Si la situation l’exige, cette possibilité permettra au conjoint survivant, outre l’épargne que lui laissera le défunt, d’accéder également à celle qui est logée sur son propre PER.
Autre cas de déblocage anticipé intéressant : l’achat d’une résidence principale. Là, il n’est plus question de protéger son conjoint mais d’assurer un départ dans la vie plus facile de ses enfants. Comment ? En ouvrant à leurs noms, dès leur plus jeune âge, un PER et en l’alimentant régulièrement. Contrairement à un produit d’épargne classique, ils ne pourront pas en disposer librement dès leurs 18 ans, mais devront attendre d’avoir un projet immobilier à financer.
Précision :
l’épargnant peut, au moment de son départ en retraite, choisir la façon dont se dénouera son contrat. Il peut opter soit pour une sortie en capital, soit en rente viagère. Étant précisé que la sortie en capital peut se faire en une ou plusieurs fois et que la rente viagère est souvent proposée avec une option de réversion en faveur du conjoint survivant. À noter qu’il est possible également de panacher rente et capital. Ce qui permet à la fois de se garantir un revenu à vie et de disposer librement d’une partie de son argent pour financer ses projets ou donner un coup de pouce à ses proches.
Un outil pour protéger ses proches
Le Plan d’épargne retraite contient une clause bénéficiaire. Une clause qui permet d’indiquer à l’assureur les personnes qui pourront bénéficier des capitaux présents sur le contrat au décès de l’assuré.
Intégrer le PER dans une stratégie de protection de ses proches oblige à s’intéresser au fonctionnement de ce dispositif dans les situations les plus critiques comme le décès du souscripteur avant sa retraite. Une situation qui entraîne de facto la clôture du PER. L’épargne accumulée est alors transmise aux bénéficiaires désignés dans le contrat quand il a été ouvert dans une compagnie d’assurance. Désigner son conjoint en tant que bénéficiaire de son PER, c’est lui permettre de percevoir, en cas de décès prématuré, l’ensemble de l’épargne accumulée. Cette désignation va s’opérer dans ce que l’on appelle la clause bénéficiaire. Associé au Plan d’épargne retraite, c’est elle qui va indiquer à la compagnie d’assurance la ou les personnes qui percevront les sommes épargnées au dénouement du contrat. N’importe qui pouvant être désigné qu’il soit on non héritier de l’assuré.
Une fiscalité avantageuse
Le Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal particulier et avantageux. Un régime qui permet notamment de déduire les cotisations versées des revenus de l’assuré.
Pour inciter les Français à se pencher sur la question de l’épargne retraite supplémentaire, le PER offre un régime fiscal favorable. À la sortie, la fiscalité applicable dépend de l’option choisie à l’entrée (déductibilité ou non des versements) et de l’origine des versements.
Pour mieux comprendre, le régime fiscal du Plan d’épargne retraite est présenté dans le tableau synthétique ci-dessous.
Fiscalité du Plan d’épargne retraite individuel
| Fiscalité des versements | Fiscalité à la sortie (hors décès et cas de sortie anticipée) | ||
| Sortie en rente | Sortie en capital(hors cas de sortie anticipée pour accidents de la vie) | ||
| Compartiment des versements volontaires | Deux options au choix :Option 1 : versements déductibles des revenus déclarés à l’impôt sur le revenu dans les limites légales en vigueur en fonction de l’activité (TNS, TNS AGRI, salarié) | Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge | Capitaux soumis à l’impôt sur le revenu + plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % |
| Option 2 : pas de déduction fiscale des sommes versées au contrat | Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge | Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises au PFU au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % | |
| Compartiment de l’épargne salariale | Alimentation par transfert uniquement | Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge | Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 % |
| Compartiment des versements obligatoires | Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 10,1 % sur le montant total de la rente | Sortie en capital non autorisée(sauf rente de faible montant) |
La fiscalité en cas de décès de l’assuré peut aussi être qualifiée d’avantageuse puisqu’elle reprend pour partie le régime fiscal attaché à l’assurance-vie. Ainsi, en cas de décès, lorsque le bénéficiaire désigné est, par exemple, le conjoint (marié ou pacsé), le transfert des sommes présentes sur le PER du défunt vers le conjoint survivant est totalement exonéré d’impôt.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un concubinage, ou lorsque ce sont les enfants, petits-enfants ou toutes autres personnes qui ont été désignés comme bénéficiaires, des impôts devront être acquittés. Concrètement, lorsque le décès de l’assuré survient :- avant ses 70 ans, aucun impôt n’est dû jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. Entre 152 500 € et 700 000 € un prélèvement de 20 % s’applique et, au-delà, son taux passe à 31,25 % ;- après ses 70 ans, des droits de succession, calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, sont appliqués après un abattement de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus).
Immobilier côtier : anticiper la montée des eaux
Avec la montée des eaux, le marché immobilier côtier va devoir s’ajuster au cours des prochaines décennies.
Le doute n’est désormais plus permis : le changement climatique est bien là. Et les conséquences de ce phénomène sont déjà visibles. L’une d’elles a été récemment mise en lumière par les pouvoirs publics et les scientifiques : la montée des eaux. Sur le plan patrimonial, cette montée des eaux devrait, à moyen terme, avoir des répercussions sur l’immobilier côtier.
Les scientifiques sont unanimes
En début d’année, le Giec a rendu un rapport détaillant les conséquences du dérèglement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Ce rapport met en avant notamment le fait que l’élévation du niveau de la mer s’est accélérée au cours du XXe siècle et pourrait atteindre un mètre d’ici 2100 dans un scénario où les émissions de gaz à effet de serre seraient fortes. Et que les dégâts provoqués par les inondations côtières vont être multipliés par 10 à la fin du XXIe siècle. Quant à la montée du niveau de la mer, elle représente une menace existentielle pour les villes côtières, notamment après 2100. Alertés par ce comité de scientifiques, les pouvoirs publics ont publié récemment une liste de 126 communes (majoritairement situées sur la façade atlantique) qui auront l’obligation notamment d’établir des cartes du risque de recul du littoral à 30 ans et 100 ans. Ces cartes servant à édicter des règles plus contraignantes en matière d’aménagement du territoire (interdiction de construire, destruction de biens…).
Quelles conséquences sur l’immobilier côtier ?
Avec la montée des eaux, certains biens risquent de perdre de la valeur. À ce propos, le cabinet Callendar, spécialisé dans l’évaluation des risques climatiques, a estimé, après avoir analysé 16 millions de transactions immobilières conclues entre mi-2016 et mi-2021, que 15 000 biens deviendront inondables avant le milieu du siècle. Dans ces conditions, les propriétaires actuels surévaluent probablement la valeur qu’ils pourront tirer de leur bien d’ici 20 ou 30 ans, quand les risques seront mieux connus et les acheteurs mieux informés. Ce qui veut dire que le marché immobilier côtier va sûrement s’ajuster même si, pour le moment, l’appréciation du risque d’érosion du littoral reste encore sans effet sur les ventes, estimait Jean-Marc Torrolion, le président de la Fédération national des agants immobiliers (FNAIM) interrogé par Les Echos en août dernier.
En attendant de mieux connaître l’étendue des changements à venir, la prudence est de mise pour les candidats à l’acquisition. L’achat de biens situés en deuxième ou en troisième rideau pouvant ainsi être privilégié dans le cadre d’une stratégie prudente.
À noter :
outil en ligneLa fiscalité appliquée aux résidences secondaires
La fiscalité qui s’applique aux résidences secondaires est plus élevée que celle qui pèse sur les résidences principales.
Selon les derniers chiffres de l’Insee, la France compte 3,6 millions de résidences secondaires. Un chiffre qui a augmenté d’un million en l’espace de 35 ans. Ces logements de villégiature sont, eux aussi, évidemment soumis à la fiscalité. Tour d’horizon des principaux impôts qui s’appliquent sur ces biens.
Une taxe d’habitation modulable
Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires ne sont pas concernées par la réforme qui vise à supprimer la taxe d’habitation. Ainsi, leurs propriétaires restent redevables de cet impôt chaque année, en fonction de leur situation au 1erjanvier, quand bien même en seraient-ils exonérés au titre de leur résidence principale. Rappelons que la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative cadastrale de la résidence et de ses dépendances, en appliquant les taux votés par les collectivités locales.
Et attention, dans les communes où la taxe sur les logements vacants s’applique, la municipalité peut voter une majoration de la part de la cotisation de taxe d’habitation qui leur revient pour les résidences secondaires. Cette majoration pouvant être comprise entre 5 et 60 %. Des cas d’exonération de cette majoration sont toutefois prévus, notamment l’obligation de résider dans un autre logement pour raisons professionnelles ou l’hébergement durable dans un établissement de soins.
Une plus-value imposée en cas de vente
Au moment de la vente d’une résidence principale, la plus-value résultant de cette vente est exonérée d’impôt. Une exonération qui ne s’applique pas lorsque la vente porte sur une résidence secondaire. Ainsi, la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux aux taux respectifs de 19 % et 17,2 %. Toutefois, lorsque la résidence est détenue depuis plus de 5 ans, la plus-value est diminuée d’un abattement dont le pourcentage varie en fonction du nombre d’années de détention. Ainsi, la plus-value est totalement exonérée au bout de 22 ans de détention (30 ans pour les prélèvements sociaux).
Dernière précision : dans certains cas, le vendeur peut être redevable d’une surtaxe sur les plus-values lorsque ces dernières sont supérieures à 50 000 €.
Une taxe sur les logements vacants
Si vous êtes propriétaire d’un logement inoccupé, vous pouvez être redevable d’une taxe sur les logements vacants (TLV). Celle-ci n’étant applicable que dans les zones dites « tendues » ou dans les communes l’ayant prévue.
L’impact de l’inflation sur vos investissements
Dans un contexte inflationniste, certains actifs financiers ont tendance à se dévaloriser. Mais, en général, le temps joue en faveur des épargnants…
L’inflation est bel et bien de retour. Selon les derniers chiffres communiqués par l’Insee, les prix à la consommation ont progressé de 4,8 % en moyenne sur un an en avril 2022. Un record depuis les années 1980. Un contexte particulier qui peut susciter de nombreuses interrogations de la part des investisseurs quant aux conséquences de ce phénomène sur les marchés financiers. Tentons de dissiper leurs inquiétudes.
Qu’est-ce que l’inflation ?
L’inflation désigne une hausse durable des prix des biens et services. En France, cette inflation est évaluée par l’indice des prix à la consommation (IPC). Le calcul de l’inflation consistant à mesurer la variation de cet indice. Concrètement, pour calculer l’IPC, l’Insee se base sur un certain nombre de produits que l’on juge représentatifs de la consommation des ménages. Grâce à des relevés nombreux et réguliers réalisés notamment par les enquêteurs de l’Insee, il est possible de calculer les variations des prix de ces différents postes.
À noter que certains biens et services ne sont pas pris en compte du fait de leur utilisation ou de la difficulté d’observation de l’évolution des prix : vente de véhicules d’occasion entre particuliers, vente de meubles anciens, œuvres d’art et tapis anciens, services hospitaliers privés, activités liées à la bijouterie…
Les conséquences de l’inflation
En pratique, l’inflation correspond à une diminution du pouvoir d’achat de la monnaie. Comme le pouvoir d’achat désigne la quantité de biens et services qu’un certain revenu permet d’obtenir, la hausse des prix va mécaniquement conduire à une diminution de cette quantité de biens. À titre d’exemple, on peut mesurer l’évolution du pouvoir d’achat d’une somme d’argent (10 000 €) entre deux dates (d1 et d2). Durant cette période, l’inflation a progressé de 3 %. En d2, cette somme de 10 000 € ne permet plus d’acheter la même quantité de biens qu’en d1, car les prix ont augmenté de 3 % et l’indice des prix est ainsi passé de 100 à 103. Le pouvoir d’achat de 10 000 € est devenu : 10 000/103 x 100 = 9 708,70 €.
D’un point de vue plus global, l’inflation peut aussi avoir des aspects positifs. Ainsi, une hausse régulière et contenue du niveau général des prix va entraîner une hausse des salaires. Cette hausse peut être un facteur de croissance économique. Ce qui va avoir pour conséquence de pousser les entreprises à anticiper et à investir. Et les ménages vont avoir tendance à placer leurs liquidités.
Quels impacts sur votre épargne ?
L’érosion de la valeur de la monnaie va conduire à ce qu’un placement dont le rendement est inférieur au taux de l’inflation ne rapporte plus rien, voire entraîne une perte d’argent pour son détenteur. Pour contrecarrer cet effet, il faut donc placer ses liquidités dans des actifs plus dynamiques, le plus souvent plus risqués. Un risque de perte en capital étant possible. Dans un contexte inflationniste, les épargnants qui vont avoir un comportement proactif sur ce sujet vont donc devoir se poser la question du dosage du risque.
Globalement, les produits d’épargne qui vont le plus souffrir de l’inflation sont les produits dits de taux (livrets réglementés, obligations et assimilés…). Des investissements qui représentent plus des 2/3 de l’épargne financière des Français. Le marché actions a tendance, lui, à mieux résister que ces produits de taux puisque certaines entreprises ont les capacités d’augmenter leurs prix pour amortir l’inflation de leurs propres charges.
Garder son sang-froid
Dans un contexte particulier comme celui dans lequel nous vivons, il est important de ne jamais réagir à chaud et de garder en point de mire ses objectifs patrimoniaux. Et il ne faut pas oublier que le facteur temps joue en votre faveur. Aussi est-il recommandé de conserver ses investissements sur le long terme afin de réduire le risque et de lisser les pertes. En clair, ce n’est jamais une bonne idée de modifier l’orientation de vos placements « au son du canon ». Quand la crise est là, il est généralement trop tard pour désinvestir ou réaliser des arbitrages. Et pendant ou après des évènements importants (guerre en Ukraine, hausse de l’énergie et des matières premières…), les rebonds des marchés financiers peuvent être forts. En réagissant, vous risqueriez de passer à côté de ces reprises.
Globalement, la gestion de ses actifs financiers en période de crise est un sujet délicat. À ce stade, il est difficile d’anticiper ce qui se passera dans les prochains mois. Toutefois, dans ce contexte incertain, certaines options ou solutions d’investissement peuvent vous permettre de rester en ligne avec vos objectifs patrimoniaux.
N’hésitez pas à contacter votre conseil habituel pour que faire le point ensemble et déterminer, le cas échéant, les arbitrages à opérer.
Les valeurs refuges
Bien souvent, en période inflationniste, certains placements sont mis en avant pour protéger son épargne. On pense tout d’abord à l’or. Valeur refuge par excellence, le métal jaune se veut rassurant par son côté tangible et par le fait qu’il peut être revendu ou échangé presque partout dans le monde. Autre actif à privilégier : l’immobilier. Qu’il soit détenu en direct ou par le biais d’une SCPI, l’immobilier fait, lui aussi, figure de valeur refuge. Cet actif a tendance à se valoriser en cas d’inflation. Et en présence d’immobilier locatif, le rendement varie peu en raison de son indexation sur l’indice de référence des loyers.
Impôt sur le revenu : faut-il rattacher ses enfants majeurs au foyer fiscal ?
Les parents peuvent détacher leurs enfants majeurs et déduire une pension alimentaire ou bien les conserver dans le foyer fiscal et continuer à bénéficier de parts supplémentaires.
Lorsque les enfants deviennent majeurs, les parents doivent se poser la question de l’opportunité de les rattacher au foyer fiscal. Une question dont la réponse varie en fonction de la situation des contribuables concernés. Explications.
Un avantage plafonné
Le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents permet de continuer à bénéficier d’une majoration du nombre de parts de quotient familial. Pour être rattaché au foyer fiscal, l’enfant majeur doit, au 1er janvier de l’année de perception des revenus, avoir moins de 21 ans (ou moins de 25 ans s’il poursuit des études). Mais attention, l’économie d’impôt résultant du rattachement est plafonnée à 1 592 € par enfant pour les deux premiers à charge et à 3 184 € à partir du troisième enfant.
Par ailleurs, si l’enfant est scolarisé, le rattachement permet aux parents de profiter d’une réduction d’impôt de 153 € (lycée) ou de 183 € (université). Autre avantage, les revenus que l’enfant perçoit dans le cadre notamment d’un « job étudiant » sont exonérés d’impôt dans la limite de trois fois le montant du Smic mensuel (4 770 € en 2021). Pour les gratifications résultant de stages, l’exonération s’applique dans la limite du montant annuel du Smic (18 760 € en 2021).
La déduction d’une pension alimentaire
Si l’enfant n’est pas rattaché au foyer fiscal, les parents peuvent déduire, dans certaines limites, la pension alimentaire qu’ils lui versent. Des limites différentes selon que l’enfant vit ou non chez ses parents.
Dans le premier cas, il est possible de déduire forfaitairement 3 592 € par enfant au titre du logement et de la nourriture. Ce montant étant doublé si l’enfant est marié ou pacsé. Et aucun justificatif n’est nécessaire.
D’autres dépenses, comme les frais de scolarité, peuvent être déduites pour leur montant réel et justifié. La déduction totale ne devant pas dépasser 6 042 € par enfant.
Si l’enfant ne vit pas chez ses parents, les dépenses réellement engagées (argent ou avantages en nature) et justifiées peuvent être déduites dans la limite de 6 042 € par enfant, qu’il soit célibataire ou non. Sachant que ce plafond de déduction peut être doublé, soit 12 084 € par enfant, dans certains cas : enfant marié ou pacsé, enfant chargé de famille... Cette pension devra bien évidemment être déclarée comme revenu par l’enfant aidé.
Un calcul d’opportunité
Avant de prendre une décision, il faut aussi tenir compte des incidences du rattachement ou du détachement. Par exemple, l’enfant étudiant détaché sera le plus souvent non imposable. Il aura ainsi droit à diverses allocations, bourses d’études... En étant rattaché, il pourrait en perdre le bénéfice lorsqu’elles sont calculées en fonction du revenu fiscal de référence des parents.
Régime matrimonial : comment mieux protéger le conjoint survivant
Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes clauses peuvent être mises en œuvre.
Offrir la meilleure protection possible à son conjoint en cas de décès intéresse tous les couples mariés. Optimiser son régime matrimonial, voire en changer, permet d’atteindre cet objectif. Explications.
Les limites du régime légal
Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial organise les biens du couple en 3 masses : les biens communs (la communauté) et les biens propres de chaque époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage. Et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage.
Mais ce régime matrimonial n’est pas le plus protecteur pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès d’un des membres du couple, comme lors d’un divorce, le mariage prend fin et le régime matrimonial est liquidé. Les biens propres sont alors « repris » par les époux et la communauté est, en principe, partagée par moitié. Puis ce sont les règles successorales qui vont venir s’appliquer sur le patrimoine du défunt (constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté). Et c’est cette dernière masse de biens qui sera partagée, le plus souvent, entre le conjoint survivant et les enfants (héritiers réservataires).
La radicalité de la communauté universelle
Afin de protéger davantage le conjoint survivant, certains couples peuvent être tentés de changer de régime matrimonial pour adopter un régime encore plus protecteur : le régime de la communauté universelle. Ce dernier prévoit d’intégrer dans la masse commune tous les biens « tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ». Ce qui signifie que les biens reçus par un époux par succession ou libéralité deviennent, en principe, communs. Lorsqu’il est combiné avec une clause d’attribution intégrale, le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la totalité de la communauté universelle, en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime « radical » présente des inconvénients pour les enfants mais également pour le conjoint survivant.
Outre le fait d’être temporairement écartés de la succession du premier parent décédé, les enfants se verront pénalisés fiscalement. En effet, les abattements fiscaux parents/enfants dont ils auraient pu bénéficier au décès de chaque parent ne joueront qu’une seule fois, sur l’intégralité du patrimoine lors du règlement de la succession du dernier parent. Pour le conjoint survivant, la transmission intégrale peut également être contre-productive. En effet, à un âge avancé, il n’aura peut-être pas l’utilité de l’ensemble des biens. Certains d’entre eux pouvant même représenter une contrainte pour lui (plusieurs appartements à gérer, par exemple).
Le recours à des clauses spécifiques
Afin d’améliorer le sort du conjoint survivant, il est possible d’optimiser le régime de la communauté réduite aux acquêts par l’adjonction de certaines clauses.
La clause de partage inégal de la communauté
La clause de partage inégal de la communauté offre la possibilité d’attribuer à l’époux survivant une proportion des biens communs différente de celle prévue par la loi (la moitié). Cette technique permet, par exemple, d’attribuer à ce dernier les deux tiers, les trois quarts, voire la totalité des biens communs. Leur attribution pouvant se réaliser soit en pleine propriété, soit en usufruit. Étant précisé que si cet avantage matrimonial peut être prévu dans le contrat signé au moment du mariage, il peut également être introduit ultérieurement.
La clause de préciput
La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Le préciput peut s’exercer sur des liquidités, un bien particulier ou une catégorie de biens. Il peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.
La clause de prélèvement moyennant indemnité
Cette clause peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté. En contrepartie, l’époux doit indemniser la communauté (la valeur des biens prélevés est imputée sur sa part de communauté). Concrètement, le prélèvement s’exerce nécessairement sur un ou plusieurs biens communs, présents ou futurs. Il peut, par exemple, concerner le fonds de commerce, la résidence principale ou secondaire, etc. Le bien prélevé sort de l’indivision et le conjoint est censé en avoir été propriétaire dès la dissolution du régime matrimonial. Il peut en disposer à sa guise sans devoir attendre le partage définitif de la communauté.
Louer un logement avec Loc’Avantages
Revu et corrigé, « Loc’Avantages » permet de bénéficier d’avantages fiscaux en contrepartie d’une réduction du montant du loyer.
Afin de développer l’offre locative et de faire diminuer le nombre de logements vacants en France, les pouvoirs publics ont corrigé le dispositif « Louer abordable ». La nouvelle mouture, baptisée « Loc’Avantages », se veut plus simple et plus avantageuse pour les propriétaires bailleurs.
De quoi parle-t-on ?
Retouché par la dernière loi de finances, le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Précisons que le dispositif s’applique aux logements neufs ou anciens, loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. Un logement qui doit être loué pendant toute la durée de la convention (6 ans au moins).
Quel avantage fiscal ?
En contrepartie d’un loyer modéré, le propriétaire peut bénéficier d’une réduction d’impôt calculée sur le montant des revenus bruts générés par le logement. Ainsi, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.
Taux de réduction du dispositif Loc’Avantages
| Niveau de loyers | Droit commun | Location « solidaire » |
| Secteur intermédiaire | 15 % | 20 % |
| Secteur social | 35 % | 40 % |
| Secteur très social | - | 65 % |
En outre, le propriétaire doit notamment s’engager à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Les plafonds de loyers et de ressources devant être communiqués dans les prochaines semaines.
Enfin, au terme de la convention conclue avec l’Anah, le propriétaire d’un logement situé dans une zone tendue peut fixer librement le loyer en cas de relocation. En clair, il n’est pas tenu par les règles d’encadrement des loyers.
À noter que la réduction d’impôt issue du dispositif Loc’Avantages est prise en compte pour la détermination du plafonnement global des avantages fiscaux.
Dépôt des dossiers
Pour pouvoir bénéficier du dispositif Loc’Avantages, les propriétaires pourront déposer leurs dossiers sur le à partir du 1er avril 2022. Un dépôt qui devra être réalisé avant le 1er mai 2022 pour les baux d’habitation signés avant le 1er mars 2022 et dans un délai de 2 mois pour les baux signés après le 1er mars 2022.
Fonds en euros : bilan 2021 et stratégie 2022
Comment pallier la baisse de la rémunération des contrats d’assurance-vie en euros en choisissant des formules plus dynamiques mais plus risquées.
Les performances 2021 des différents fonds en euros ont été dévoilées. Et force est de constater que malgré la crise sanitaire et les taux d’intérêts négatifs, ces fonds, sans faire de miracles, ont plutôt bien résisté. Ils devraient ainsi rapporter 1,1 % en moyenne. Un rendement faible mais qui correspond peu ou prou à celui servi en 2020 (1,3 %). Face à ce repli des rendements, la question se pose de savoir si et dans quelle proportion il convient de conserver ces actifs au sein de son contrat et vers quels autres actifs se tourner pour dynamiser ses performances.
Un rendement en baisse
Les établissements bancaires et les compagnies d’assurance qui proposent des fonds en euros mettent en avant leur principal avantage, à savoir la garantie du capital. En effet, au terme du contrat, ils sont tenus de rembourser l’épargnant d’une somme égale au montant des versements qu’il a effectués, augmentée des intérêts et après déduction des différents frais (de gestion, de sortie...). Pour être en mesure d’assurer cette garantie, les assureurs investissent majoritairement les primes des contrats dans des placements dits sans risques, comme les obligations, des titres de créances émis généralement par les sociétés et les États pour emprunter sur les marchés. L’épargnant reçoit en contrepartie un intérêt annuel (le coupon) avant d’être remboursé au terme de l’emprunt.
L’ensemble des obligations ayant subi la baisse prolongée des taux d’intérêt, leur rémunération n’est plus assez élevée pour permettre aux fonds en euros d’offrir des performances intéressantes. L’OAT 10 ans, qui est l’indice de référence du marché, reste sous la barre de 1 % depuis quelques années. Toutefois, malgré cette baisse de rendement, une assurance-vie investie en fonds en euros demeure une formule de placement intéressante pour les épargnants dont l’aversion au risque est importante et qui souhaitent pouvoir mobiliser leur épargne à tout moment.
Intégrer des unités de compte à son contrat
En dépit de cette baisse de rendement, il n’est pas question de bannir totalement les fonds en euros de son assurance-vie mais plutôt d’envisager de revoir sa stratégie d’investissement en ajoutant une dose d’unités de compte au sein de son contrat. Rappelons que les unités de compte (UC) désignent les supports d’investissement (autres que les fonds en euros) qui composent les contrats d’assurance-vie multi-support. Concrètement, l’épargnant qui investit dans des UC acquiert des parts de produits financiers placés en Bourse.
Contrairement à certaines idées reçues, les unités de compte ne sont pas exclusivement tournées vers les actions. En réalité, il est possible d’accéder à un panel d’investissements. Les UC pouvant, par exemple, comprendre des obligations, des actifs monétaires, des fonds flexibles ou encore de l’immobilier. Cette diversité peut être également géographique (Europe, États-Unis...) ou sectorielle (industrie, santé, énergie, télécommunication…). Mais attention, la recherche de performance suppose une prise de risque. En effet, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Ainsi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut fortement diminuer. C’est la raison pour laquelle il convient de les conserver sur une longue période afin de lisser les risques dans le temps.
Quelles unités de compte choisir ?
L’offre en matière d’unités de compte est très étendue. Et grâce à cette diversité, chaque épargnant peut sélectionner des supports d’investissement qui vont répondre à ses objectifs et au niveau de risques qu’il souhaite ne pas dépasser. Voici quelques exemples d’unités de compte qui ont tenu leurs promesses et ont performé ces dernières années.
Commençons par les fonds patrimoniaux. Il s’agit d’enveloppes qui ont pour objectif de capter les hausses de marchés tout en limitant au maximum l’impact des baisses. Une méthode permettant ainsi de dégager de la performance sur un horizon de temps raisonnable (3 à 5 ans minimum) tout en protégeant le capital investi par l’épargnant. Pour parvenir à ces objectifs, les gérants de ces fonds n’hésitent pas à adapter régulièrement leur composition pour tenir compte de l’évolution des marchés. Ils peuvent ainsi recourir à différentes classes d’actifs comme les actions, les obligations, les devises ou encore les matières premières. De la même manière, les gérants peuvent également « ouvrir » leurs fonds à différents secteurs d’activité, tailles d’entreprise ou encore zones géographiques. Une diversification des actifs destinée à faire baisser la volatilité du portefeuille.
Autre famille d’unités de compte qui a tenu ses promesses l’année dernière : les fonds en immobilier (OPCI, SCPI…). Ces derniers permettent d’investir dans l’immobilier professionnel (bureaux, commerces…) et de percevoir des revenus réguliers. Le marché de l’immobilier du secteur tertiaire résiste plutôt bien et offre donc un rendement convenable grâce à la sécurité des loyers et à leur indexation sur l’inflation. En 2021, le rendement moyen des UC placées dans des parts de SCPI a atteint un peu plus de 4 %. Il n’est pas inintéressant non plus de se pencher sur les fonds thématiques. Des fonds qui investissent dans des sociétés développant leur activité dans des filières à fort potentiel (la santé, l’intelligence artificielle, l’accès à l’eau…) mais qui nécessitent un investissement important, à moyen ou long terme, afin de pouvoir générer des résultats durables. On pense, par exemple, aux sommes investies dans la thématique environnementale. Des sommes qui sont employées pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’adaptation au changement climatique.
À noter :
par manque de temps ou de connaissances, il peut parfois être difficile de composer et de gérer soi-même un contrat d’assurance-vie. C’est la raison pour laquelle certains établissements proposent aux épargnants un service de gestion profilée. Concrètement, l’assureur définit plusieurs profils d’allocation d’actifs établis en fonction de différents niveaux de risques. Libre alors à l’investisseur de choisir celui qui correspond le mieux à ses attentes. Une fois la formule choisie, la compagnie d’assurance se charge de répartir les capitaux entre les différents supports d’investissement. Généralement, trois profils de risques sont proposés : prudent, équilibré et dynamique.
Les éléments à vérifier avant d’acheter un bien immobilier
Ce sont les petits détails qui peuvent faire la différence… Voici une petite check-list à suivre pour pouvoir juger de la qualité d’un bien immobilier.
Vous vous lancez dans la recherche de votre résidence principale ou d’un bien locatif. Mais avant de faire une offre sur un logement, il convient de récolter certaines informations pour éviter les mauvaises surprises. Voici quelques points à vérifier avant d’acheter.
1- L’état général du bien
Se faire une idée précise de l’état général d’un logement peut être une tâche ardue, surtout lors de la première visite et en présence des éléments de décoration du propriétaire ou du locataire. Pour avoir une vision d’ensemble, il faut donc se rendre sur les lieux à plusieurs reprises. Idéalement, à des moments différents de la journée, notamment pour juger de sa luminosité et de son exposition aux bruits de la circulation et des voisins. N’hésitez pas, lors des visites, à demander à pouvoir ouvrir les placards et à regarder dans le vide-ordures pour vérifier l’absence de nuisibles. Observez l’état des revêtements de sol, des portes, des fenêtres et des volets. Testez la robinetterie, actionnez les radiateurs, informez-vous sur le mode de chauffage, la production d’eau chaude, la plomberie (branchement du lave-linge et du lave-vaisselle), l’isolation, l’électricité (normes, mise à la terre, tableau électrique). Pensez également à demander au vendeur de vous préciser quel est le type d’assainissement de la maison : dispositif individuel ou raccordement au tout-à-l’égout. Si la maison dispose de son propre dispositif, demandez-lui de vous indiquer comment il est entretenu. Pour un bien ancien, n’hésitez pas à venir avec un « homme de l’art » pour l’évaluer et chiffrer le montant des éventuels travaux à réaliser pour mettre le logement à votre goût.
2- L’état du bâti
Aucun diagnostic sur l’état du bâti n’existe. De ce fait, il faut être très vigilant lors des visites du bien immobilier visé. Certains défauts ne sont pas forcément visibles au premier coup d’œil, comme les fissures, les traces de fuites d’eau ou les tâches d’humidité. Exigez de voir toutes les pièces du logement, cave et grenier compris. N’hésitez pas à inspecter les combles afin d’avoir une idée de l’état de la charpente, de la couverture et de l’isolation du toit. Vous pourrez ainsi voir si le bâti est en bon état ou au contraire si vous devez prévoir, par exemple, des travaux de couverture qui peuvent représenter plusieurs milliers d’euros. Au rang des équipements de confort, demandez au vendeur si le bien est équipé d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Un équipement qui, selon sa catégorie (simple ou double flux), permet d’éliminer l’humidité présente dans les pièces.
3- L’environnement
Que ce soit pour une résidence principale ou pour un bien locatif, la situation géographique revêt de l’importance. D’une part, pour jouir d’un environnement agréable correspondant à vos attentes. D’autre part, pour espérer réaliser une plus-value au moment de la revente. Pour éviter les mauvaises surprises, il convient de se renseigner sur l’environnement du bien immobilier. Est-il proche des commerces et des écoles ? Y a-t-il des axes routiers et ferroviaires importants à proximité pour rallier les principaux pôles urbains ? Le bien est-il situé dans une rue passante (ce qui peut générer des nuisances sonores) ? Il conviendra également de se poser la question de savoir si les bruits environnants et les potentielles odeurs peuvent être un frein à l’achat : trafic important, présence d’une école, d’un aéroport, d’une exploitation agricole, d’une déchetterie, etc. Avec l’importance du numérique, il est également essentiel de s’intéresser au débit de la connexion internet et au niveau de la couverture mobile. Faites des tests de ligne via une plate-forme internet ou in situ avec votre mobile.
4- Un point juridique et fiscal
Avoir une idée précise de ce que l’on achète est primordial. Et pour avoir une complète information, il est recommandé de s’intéresser de près à l’environnement juridique du bien immobilier visé. Tout d’abord, il est conseillé de se pencher sur les documents liés au cadastre. Si le vendeur a réalisé des travaux (extension, piscine, terrasse, véranda), il faut être sûr que ces aménagements ont fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation administrative. En cas de construction récente, vérifiez l’existence d’une attestation de garantie décennale. Une attestation qui pourrait vous rendre service en cas de défauts ou de malfaçons constatés après la signature.
S’agissant d’une maison individuelle, il faut également s’enquérir de la propriété des murs (de clôture). Sont-ils mitoyens ou la propriété exclusive d’un fonds ? Dans le même ordre d’idées, existe-t-il une servitude qui pourrait engendrer des nuisances ? Par exemple, on pense à une servitude liée à une conduite d’eau, un égout, une vue, un droit de passage, etc. Prenez également le temps d’interroger le vendeur ou l’agent immobilier sur le montant des impôts locaux. Un élément qui n’est pas forcément de nature à freiner un achat immobilier, mais qui permet d’avoir une idée précise des charges annuelles liées au bien.
Investir dans les bois et forêts avec les GFI
À l’instar des parts de SCPI, les parts de GFI permettent d’investir dans des actifs forestiers sans avoir la contrainte de la gestion en direct.
Les investissements dans les bois et forêts font partie des outils qui permettent de répondre à un objectif de diversification patrimoniale. Des investissements qu’il est possible de réaliser par l’intermédiaire d’une société : le groupement forestier d’investissement (GFI). Une bonne formule pour se constituer un patrimoine tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt.
Qu’est-ce qu’un GFI ?
Les groupements forestiers d’investissement sont des sociétés civiles qui ont pour objet de constituer, de gérer et de conserver un ou plusieurs massifs forestiers. Contre un apport en capital, les investisseurs reçoivent des parts sociales représentatives du patrimoine du GFI. La valeur d’une part, quelques dizaines d’euros, tient compte de deux facteurs : la qualité intrinsèque de l’actif forestier (situation géographique, climat, surface, nature du sol, âge, qualité des arbres…) et l’actif financier net du GFI (liquidités, trésorerie disponible).
Mais attention, compte tenu de la nature des actifs, il faut envisager ce placement de capitalisation sur le long terme (12 ans au minimum).
En fonction des conditions du marché et de la valorisation des actifs, les GFI peuvent servir des revenus (issus notamment de la vente de bois) pendant la période de détention des parts. On estime à environ 2 % nets de frais de gestion leur rendement annuel.
À noter :
l’investisseur a toujours la possibilité de revendre ses parts de GFI. Généralement, la société de gestion du GFI organise un marché secondaire qui permet la rencontre entre vendeurs et acquéreurs. Ce qui ne signifie pas pour autant que l’investisseur pourra, lors de la cession, récupérer l’intégralité de sa « mise de départ ».
Des avantages fiscaux à la clé
Investir dans des parts de GFI permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 % du prix de leur acquisition, retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne seule et de 11 400 € pour un couple. Attention toutefois, pour bénéficier de ces avantages fiscaux, il faut s’engager à conserver ses parts pendant au moins 8 ans.
En outre, sous conditions, leur valeur est exclue de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Avantage supplémentaire, certaines parts de groupements forestiers d’investissement sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des 3/4 de leur valeur. Condition sine qua non, elles doivent avoir été détenues pendant au moins 2 ans avant leur transmission par donation ou succession.
Quelques chiffres
Selon une étude de la Société forestière et de la FNSafer, le prix moyen des forêts non bâties en 2019 a atteint 4 190 € /ha. Étant précisé que 90 % des transactions ont été conclues à des prix s’échelonnant entre 620 et 12 470 €/ha. Cette diversité des prix reflète la qualité des biens mis en vente et le degré de concurrence entre candidats à l’acquisition. Autre donnée, en hausse de 16 %, les acquisitions des personnes morales privées (agricoles, forestières ou institutionnelles) se sont élevées à 54 000 ha et ont représenté 39 % du total de la surface du marché en 2019. Cette hausse traduisant peut-être le recours croissant des particuliers aux groupements forestiers pour réaliser leur acquisition.
Les bonnes décisions patrimoniales à prendre avant la fin de l’année
La fin de l’année approche à grand pas. Et les quelques semaines qui restent peuvent être mises à profit pour adapter votre stratégie patrimoniale et pour bénéficier de certains avantages. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour profiter de certains régimes de faveur ou pour vous préparer à la nouvelle donne fiscale de 2022. Tour d’horizon des changements à venir et des arbitrages qui s’imposent.
Faire preuve de générosité
En effectuant des dons avant la fin de l’année, il est possible de réduire votre facture fiscale de 2022.
Pour faire baisser la pression fiscale en 2022, une solution simple consiste à consentir des dons à des associations. Des dons qui ouvrent droit, selon les cas, à une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 50 € ouvre droit à une réduction d’impôt de 33 €.
Lorsque le don est réalisé en faveur d’un organisme d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques, la réduction d’impôt est de 75 % pour un don d’un montant inférieur ou égal à 1 000 €. La fraction au-delà de 1 000 € ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant donné. Cette réduction d’impôt ne peut être supérieure à 20 % du revenu imposable.
Précision :
cette réduction d’impôt de 75 % pour un don d’un montant inférieur ou égal à 1 000 € a été appliquée, à titre exceptionnel en 2020 et 2021. Un amendement du projet de loi de finances pour 2022 prévoit de prolonger ce dispositif exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2023.
Alimenter ses produits retraite
Si vous disposez d’un surplus de liquidités, pensez à réaliser des versements sur vos produits retraite.
Durant les semaines de confinement, vous avez peut-être, comme de nombreux Français, eu l’occasion d’épargner plus fortement.
Si vous n’avez pas besoin, à court terme, de cette épargne, vous avez tout intérêt à l’investir sur vos supports d’épargne retraite afin de bénéficier de revenus plus importants au moment de la liquidation de votre retraite. Vous pouvez, par exemple, alimenter soit votre Plan d’épargne retraite populaire (Perp), soit votre contrat Madelin, soit encore votre nouveau Plan d’épargne retraite (PER).
Gros avantage, vous pouvez déduire de votre revenu imposable, dans la limite d’un plafond global, les cotisations que vous versez sur votre Perp. Ce plafond étant égal au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels de l’année précédente, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) de l’année en cause, soit une déduction maximale de 32 904 € pour les versements effectués en 2021 ;
- ou 10 % du Pass de l’année précédente, soit une déduction maximale de 4 114 € pour les versements effectués en 2021.
Même logique pour le contrat Madelin : la déduction de vos cotisations sur vos revenus professionnels (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux) s’effectue à hauteur de 10 % du Pass, auxquels s’ajoutent 15 % du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois ce même plafond, soit une déduction maximale de 76 102 € pour 2021.
Pour le Plan d’épargne retraite (PER), le plafond de déduction dépend de votre statut social. Si vous êtes travailleur non salarié, vous appliquez le plafond alloué au contrat Madelin. Dans les autres cas, c’est le plafond du Perp qui doit être appliqué.
Penser aux emprunts immobiliers
Les taux des crédits immobiliers continuent de baisser. Vous avez peut-être tout intérêt à vous rapprocher de votre banque.
Depuis le début de l’année, les taux des crédits immobiliers affichent une tendance à la baisse. Et cette fin d’année semble confirmer cette tendance. Les banques ont encore révisé leurs barèmes pour soutenir la demande de crédits sur des marchés toujours à la peine. Pour un emprunt sur 20 ans, le taux moyen oscille autour de 1,15 %. Toutefois, suite aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), les conditions d’accès à l’emprunt vont se durcir les prochaines semaines (taux d’endettement maximal de 35 % notamment). Résultat, les banques sont à la recherche d’emprunteurs aux reins solides pour limiter au maximum le risque d’impayés. Dans ce contexte, elles n’hésiteront pas à accorder aux bons profils des conditions de financement avantageuses. Une occasion qu’il est peut-être bon de saisir pour pouvoir financer vos acquisitions à moindre coût. D’autant plus que le recours à l’emprunt va vous permettre de réduire la facture de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI). En effet, les charges d’emprunt liées à un bien immobilier constituent un passif déductible, ce qui va mécaniquement réduire votre base taxable à l’IFI. Par ailleurs, si vous avez déjà des prêts en cours, nous ne pouvons que vous inciter à profiter de cette période pour vous rapprocher de votre banque afin de renégocier vos conditions d’emprunt ou de faire racheter votre emprunt par une banque concurrente.
Dans la continuité, vous avez également intérêt à vous pencher sur votre assurance-emprunteur. Vous avez, là encore, un moyen de réaliser des économies. Pourquoi ? Parce que l’assurance proposée par la banque lors de la souscription d’un emprunt n’est généralement pas la meilleure du marché (niveau de garanties limité, cotisations élevées…). Depuis une loi du 21 février 2017, vous avez la possibilité de résilier votre contrat chaque année à la date anniversaire. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous fassions ensemble le point sur votre situation !
Tout savoir sur les plafonds de l’épargne retraite
Pour profiter pleinement des avantages fiscaux attachés aux produits d’épargne retraite, il convient de s’intéresser de près aux plafonds de déduction.
À la lecture de votre avis d’imposition, vous avez peut-être remarqué qu’il comporte une rubrique mentionnant des plafonds d’épargne retraite. Une information particulièrement utile pour les personnes qui préparent ou veulent préparer leur retraite. Explications.
À quoi servent ces plafonds ?
Ces plafonds servent aux épargnants qui disposent d’un contrat d’épargne retraite comme un contrat Madelin, un Perp ou un Plan d’épargne retraite. En effet, les cotisations qu’ils versent dans l’un de ces produits peuvent être déduites fiscalement de leurs revenus, dans la limite d’un plafond. Les plafonds mentionnés dans leur avis d’imposition correspondent ainsi aux sommes maximales qu’ils peuvent déduire. Pour les calculer, il est fait application d’une formule spécifique au produit d’épargne choisi. Par exemple, pour le Plan d’épargne retraite, les cotisations versées en 2021 peuvent être déduites des revenus perçus en 2021 dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % des revenus professionnels de 2020, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (PASS) de 2020 (329 088 € x 10 %), soit 32 908 € de déduction maximum ;
- 10 % du PASS de 2020 (41 136 € x 10 %), soit 4 113 €.
Calculés automatiquement chaque année et pour chaque membre du foyer fiscal, les plafonds sont utilisables pendant 3 ans. C’est la raison pour laquelle l’avis d’imposition indique le plafond de l’année en cours, mais aussi ceux des trois dernières années. Et si, au bout de 3 ans, vous n’utilisez pas vos plafonds, sachez que ces derniers sont définitivement perdus.
Comment les utiliser ?
Dans la mesure où la fin de l’année arrive à grands pas, il ne vous reste plus que quelques semaines pour procéder, si vous le pouvez, à des versements complémentaires sur votre produit d’épargne retraite pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre contrat de retraite, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien au plafond le plus récent.
D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez la possibilité d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. Mais attention, n’oubliez pas, dans ce cas, de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de votre déclaration de revenus). Car cette mutualisation des plafonds entre conjoints n’est pas automatique.
Déclarer son épargne retraite
Chaque année, dans votre déclaration de revenus, vous devez, pour profiter de la déduction fiscale, indiquer le montant des cotisations que vous avez versées l’année précédente sur un Perp (cases 6RS, 6RT et 6RU) ou sur un Plan d’épargne retraite (cases 6NS, 6NT et 6NU). Ces montants vous sont transmis (imprimé n° 2561 ter) par l’établissement qui gère votre épargne.
Immobilier : pourquoi ne pas investir dans les villes moyennes ?
Avec le niveau de prix de certaines grandes agglomérations françaises, il peut être intéressant de regarder du côté des villes moyennes pour investir dans l’immobilier. Des biens moins chers et dont le rendement locatif est attractif.
La pierre a toujours autant de succès en France. Pour preuve, selon les professionnels de l’immobilier, les investissements locatifs ont doublé en 8 ans, passant de 17 % des transactions globales en 2013 à 30 % au premier semestre 2021. Des transactions qui portent surtout sur les logements situés dans les grandes agglomérations. Mais avec la forte flambée des prix de l’immobilier constatée ces dernières années dans les métropoles, les villes moyennes ont des arguments à faire valoir. Explications.
Un marché saturé dans les grandes métropoles
Les appartements situés dans les grandes agglomérations sont la cible privilégiée des investisseurs en immobilier. Des villes où les locataires sont nombreux et la vacance locative mécaniquement peu élevée. Problème, face à une demande qui explose, les prix de l’immobilier ont fortement grimpé. Selon Meilleuragents.com, en l’espace de 5 ans, les prix ont progressé de 53 % à Rennes, de 44 % à Lyon, de 39 % à Nantes, de 34 % à Strasbourg, de 30 % à Toulouse et de 29 % à Bordeaux, Lille et Paris. Et comme le niveau des loyers n’a pas particulièrement progressé, la rentabilité de l’opération s’érode. On considère aujourd’hui que le rendement d’un appartement dans l’hypercentre d’une métropole oscille entre 1 et 3,5 %.
Pour tenter de renouer avec un rendement attractif, une solution peut consister à investir dans l’immobilier situé dans les villes de taille moyenne. On pense, par exemple, à Orléans, où un appartement T2 loué nu en plein centre-ville laisse espérer un rendement brut moyen de 5 %. On atteint les 7,5 à 8,5 % pour un logement comparable du côté de Saint-Nazaire. Même chose pour Libourne, qui offre un rendement de 6 %.
Sonder le marché avant d’acheter
Attention toutefois, investir dans l’immobilier dans des villes moyennes nécessite de prendre certaines précautions. Avant de faire une offre, il faut, au préalable, s’intéresser au marché local. Tout d’abord, il convient d’examiner l’évolution démographique de la ville ciblée. Si vous observez une baisse de sa population depuis une dizaine d’années, changez de cible. Pour maximiser vos chances de louer dans de bonnes conditions, privilégiez les villes qui disposent d’une université, d’une grande école et d’un complexe hospitalier (CHU ou CHR). Des installations qui attirent une population étudiante ou des fonctionnaires. Par ailleurs, ne perdez pas de vue qu’avec la crise du Covid-19, la pratique du télétravail s’est répandue dans les entreprises. De ce fait, de nombreux actifs ont quitté les grandes villes pour gagner en qualité de vie et en espace. Si vous voulez séduire cette catégorie de « travailleurs », veillez à ce que l’appartement visé soit proche d’infrastructures routières et ferroviaires permettant de rejoindre facilement les pôles urbains. Autre point d’attention, investissez dans un bien immobilier en parfait état et proposant un confort et des prestations élevés. Car si, dans les grandes villes, les locataires acceptent de louer de petites surfaces, ce n’est pas le cas dans les villes moyennes. Votre logement doit faire au moins 50 m² (sauf si vous visez une clientèle étudiante). Et la présence d’un balcon ou d’un petit jardin est un atout non négligeable, tout comme une cuisine et une salle de bains bien équipées, mais aussi une ou plusieurs places de parking.
En proposant un logement confortable, vous êtes susceptible de faire baisser la vacance locative. La vacance locative est, en général, un peu plus élevée dans les villes moyennes. Toujours dans cet objectif d’efficacité, ne soyez pas trop gourmand en ce qui concerne le montant du loyer. Essayez de fixer un loyer inférieur de 5 % à la moyenne du marché local.
Des dispositifs d’aide à la rénovation
Si vous entreprenez une démarche d’achat, sachez qu’il existe des dispositifs pour vous aider à investir dans des logements à rénover.
Par exemple, le dispositif Denormandie a pour objectif d’encourager les investisseurs à acquérir et à rénover des logements anciens dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué. En contrepartie, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel « classique »), à condition, notamment, que les travaux de rénovation représentent au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.
D’ailleurs, selon une étude de Meilleursagents.com, le dispositif Denormandie permet d’atteindre une rentabilité nette moyenne de 3,7 %. Ce résultat étant obtenu en prenant en compte l’ensemble des charges liées à l’achat et à la détention du bien et l’avantage fiscal attaché au dispositif.
Assurance-vie : les idées reçues sur les unités de compte
Les titulaires d’une assurance-vie sont de plus en plus nombreux à investir en unités de compte. Certains hésitent encore… Pour les convaincre, tordons le cou à certaines idées reçues.
Placement préféré des Français, l’assurance-vie est un produit d’épargne qui ne manque pas d’atouts : souplesse, outil de transmission et fiscalité avantageuse. Bien qu’elle soit populaire, l’assurance-vie véhicule quelques idées reçues, et notamment à propos des unités de compte. Une bonne occasion de s’y intéresser.
1- Les unités de compte sont plus risquées que les fonds en euros
Vrai. Les unités de compte, qui représentent des parts d’organismes de placement collectif (OPC), ne bénéficient pas de la même garantie en capital que les fonds en euros. Mais attention, le niveau de risque varie fortement d’une unité de compte à une autre. Par exemple, une unité de compte adossée à un fonds actions sera plus volatil qu’une unité de compte adossée à un fonds obligataire. Pour réduire le risque, il faut sélectionner, avec l’aide de son conseil habituel, et avec le plus grand soin, ses unités de compte. Toutefois, si vous n’avez pas d’appétence au risque, sachez que vous avez la possibilité de panacher votre contrat en ajoutant une dose d’unités de compte à votre fonds en euros.
2- Mon argent est bloqué
Faux. Qu’il soit investi en fonds en euros ou en unités de compte, votre capital est disponible à tout moment. Pour récupérer une partie de votre épargne, vous pouvez réaliser un rachat (retrait). Attention toutefois, cette opération est soumise à taxation et aux prélèvements sociaux. Par ailleurs, il faut savoir que l’assurance-vie est un produit qui répond aux problématiques liées à l’épargne de long terme (préparation de la retraite, valorisation d’un capital, transmission familiale...). Pour pouvoir financer ces projets, cette épargne doit être potentiellement plus rémunératrice, donc plus exposée aux risques. Et pour absorber ces risques ainsi que les soubresauts des marchés, un investissement en assurance-vie doit s’inscrire sur un temps long.
3- J’ai peu de connaissances en la matière, les unités de compte ne sont pas pour moi
Faux. Les épargnants qui veulent entrer sur les marchés financiers via des unités de compte mais qui, par manque de temps ou de connaissances, ne souhaitent pas se soucier de la gestion de leur contrat, peuvent se diriger vers des solutions clé en main : les fonds profilés. Il s’agit de fonds d’investissement diversifiés gérés directement par l’assureur. Des fonds établis en fonction de différents niveaux de risques (équilibré, dynamique, offensif). Le choix du niveau de risques étant laissé à l’investisseur.
4- Qui dit unités de compte dit forcément actions
Faux. L’offre d’unités de compte au sein d’un contrat d’assurance-vie peut être très variée. Différents types d’actifs peuvent vous être proposés, notamment :- des unités de compte monétaires, peu rémunératrices mais aussi peu risquées ;- des unités de compte obligataires. Des supports investis principalement en obligations souveraines (dettes d’État) ou corporate (d’entreprises). Des supports d’investissement réputés solides ;- des unités de compte actions. Ces dernières offrent de nombreuses thématiques d’investissement. Il est, par exemple, possible de privilégier des fonds qui concentrent leurs investissements sur des entreprises œuvrant dans un secteur d’activité spécifique (l’agro-alimentaire, l’énergie…) ;- des unités de compte immobilières qui permettent d’investir notamment dans l’immobilier professionnel (bureaux, commerces…) et de percevoir des revenus réguliers.
À noter qu’il est possible de choisir la zone géographique de ses unités de compte. Certains assureurs proposent d’investir en Europe, en Amérique ou en Asie. Vous pouvez également allouer vos investissements à différents secteurs d’activité (industrie, santé, matières premières…).
5- Les unités de compte sont opaques
Faux. Avant de souscrire des unités de compte, l’assureur vous remet différents documents d’information. Parmi ces documents, on trouve le DIC (document d’informations clés). Ce document, standardisé au niveau européen, doit fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur le produit concerné.
Il est obligatoirement remis avant toute souscription afin de permettre à l’épargnant de prendre une décision d’investissement en connaissant les principales caractéristiques du produit. Une fois l’investissement réalisé, sachez que les sociétés de gestion mettent régulièrement à la disposition de leurs investisseurs des « reportings » (le plus souvent mensuels). Il s’agit de fiches regroupant des informations qui permettent de suivre votre placement.
En somme, le reporting est une sorte de photographie du fonds d’investissement en fin de mois. Ce document contient diverses informations : la valeur liquidative, l’échelle de risques, la valorisation, les performances brutes du fonds, la volatilité du fonds, la répartition des encours par classes d’actifs... Des documents qu’il convient de lire régulièrement pour avoir une vision objective de la santé du fonds et de ses performances.
Présents d’usage : les limites à ne pas dépasser
Quand sa valeur est jugée trop élevée, un présent d’usage peut être requalifié en don, et donc être taxé.
Des parents peuvent consentir à leurs enfants (ou à un autre membre de la famille) un don par la remise matérielle d’un bien, par exemple une voiture, un tableau, un bijou, de la monnaie, le paiement d’une dette, un droit réel immobilier d’une faible valeur, une rente viagère, un meuble ou une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.
Présent d’usage : des critères à respecter
Pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, le présent doit être remis à l’occasion de certains évènements marquants (naissance, anniversaire, Noël, promotion, fiançailles, remise de diplôme…). D’autre part, il doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle il est remis. Caractéristique du présent d’usage : il n’est pas, contrairement au don, soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.
L’appréciation de ces critères
Comme il n’existe pas de règles particulières pour définir les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le montant des présents d’usage, appréciés à la date où ils sont consentis, ne doivent pas excéder 2 % du patrimoine du donateur et 2,5 % de ses revenus annuels. En cas d’excès, le présent d’usage peut être requalifié par les juges et l’administration fiscale en donation classique. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opérant au cas par cas.
Du côté des tribunaux...
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que les revenus nets imposables (166 220 francs par an) du mari lui permettaient de faire un tel cadeau, celui-ci ne revêtant aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.
À l’inverse, dans une autre affaire, la cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion du litige en la matière, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.
Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.
Comment doper le rendement de votre assurance-vie ?
Bien qu’ils affichent des performances honorables compte tenu du contexte actuel, les fonds en euros présents dans les contrats d’assurance-vie voient leur rendement progressivement s’effriter. Pour l’année 2020, le rendement moyen a ainsi atteint 1,08 %, soit 0,32 point de moins qu’en 2019. Cette baisse de rémunération s’explique par le fait que les taux des obligations d’État, qui composent majoritairement les fonds en euros, sont passés en territoire négatif. Pour parer à cette situation et doper le rendement de votre contrat d’assurance-vie, il est possible de mettre en place différentes stratégies. Explications.
Le recours aux unités de compte
Afin de gagner en performance, il est recommandé d’investir en partie dans des unités de compte.
Dans le cadre de l’assurance-vie multisupport, une unité de compte représente une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Investir dans des unités de compte, c’est accéder à un panel de supports d’investissement important. En effet, les unités de compte ne se résument pas qu’aux actions. Il est également possible de se positionner, par exemple, sur des obligations, de l’immobilier, des actifs monétaires… Mais attention, contrairement aux fonds en euros, les unités de compte ne bénéficient pas d’une garantie. Ce qui peut entraîner un risque de perte en capital. Toutefois, cette prise de risques peut permettre de bénéficier de meilleurs rendements. Pour preuve, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l’assurance (FFA), les supports en unités de compte ont délivré un rendement annuel moyen de 4,6 % sur la période 2013-2017. Comparativement, les fonds en euros, sur la même période, ont affiché un taux d’intérêt annuel moyen de 2,23 %.
Et que les épargnants prudents se rassurent, il est possible d’ajuster le niveau de risque lié à ces investissements. Ce niveau de risque peut être plus ou moins important en fonction du type de supports d’investissement choisi, de leur proportion (panachage entre fonds en euros et unités de compte) ou encore du type de marché. Pour réduire une partie de ces risques, l’assuré a tout intérêt à diversifier son contrat.
Tendre vers la diversification
Diversifier son contrat d’assurance-vie permet de diluer le risque et d’obtenir un rendement dynamique.
La diversification consiste à répartir une enveloppe d’investissement entre différentes classes d’actifs choisies en fonction de leur exposition au risque et du rendement qu’elles peuvent laisser espérer. Diversifier, c’est, autant que possible, détenir un contrat contenant des actifs décorrélés entre eux, c’est-à-dire des actifs qui n’évoluent pas toujours dans le même sens au même moment. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’intégrer différentes classes d’actifs, mais aussi d’allouer ses investissements à différents secteurs d’activité (industrie, santé, matières premières…) ou zones géographiques (Amérique, Europe, Japon, pays émergents…). Une diversification peut également s’obtenir par le jeu des différentes monnaies (euro, dollar, yen…). Mais attention, la diversification ne doit pas pour autant vous faire perdre de vue certaines règles de base. D’une part, votre allocation d’actifs doit prendre en compte vos objectifs patrimoniaux ou vos besoins futurs de liquidités. D’autre part, il faut savoir que les unités de compte nécessitent un laps de temps minimal (1 an, 3 ans, 5 ans…) pour délivrer un certain niveau de rendement et pour diminuer le niveau de risque. En investissant dans des unités de compte, il faut laisser du temps au temps !
Réaliser des versements programmés
Les versements programmés permettent d’alimenter régulièrement son contrat d’assurance-vie et de multiplier les points d’entrée sur les marchés financiers.
Outre le fait de pouvoir alimenter votre contrat d’assurance-vie par des versements libres, vous pouvez mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement et régulièrement. C’est vous qui déterminez le montant des versements, les supports sur lesquels seront investies ces sommes et la périodicité des versements : mensuelle, trimestrielle, voire semestrielle ou annuelle. Ainsi, à chaque échéance, votre assureur prélèvera le montant déterminé sur le compte bancaire que vous aurez indiqué, puis le versera sur le ou les support(s) d’investissement que vous aurez choisi(s). L’intérêt de cette mécanique est de vous permettre, lorsque vous investissez en unités de compte, de réduire les risques. En effet, en multipliant les points d’entrée, vous vous affranchissez des orientations des marchés financiers puisque vous allez lisser la valeur d’achat moyenne de vos actifs. Concrètement, lorsque la tendance boursière s’inscrit en hausse, la valeur de vos investissements va s’apprécier. À l’inverse, en cas de tendance baissière, la valeur de vos supports va diminuer, mais en contrepartie, vos versements vous permettront d’acquérir plus d’actifs. Une stratégie qui a déjà fait ses preuves et qui permet, sur le long terme, de faire progresser la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie.
Déléguer la gestion de votre épargne à des experts
La gestion sous mandat consiste à confier son épargne à une équipe de professionnels. Un bon moyen de se délester de la gestion, parfois contraignante, d’un produit d’épargne et de profiter des opportunités d’investissement.
Pour vous aider à faire fructifier votre épargne, les assureurs proposent aujourd’hui de nombreuses options, parmi lesquelles se trouve la gestion pilotée. Longtemps réservée à certains contrats d’assurance-vie, la gestion pilotée (appelée encore la gestion sous mandat) est de plus en plus accessible. Elle consiste à confier l’épargne investie à une équipe de gestionnaires professionnels. Ces derniers suivent, pour le compte de l’épargnant, l’évolution des marchés. Concrètement, ce type de gestion donne pouvoir aux gestionnaires d’investir les sommes épargnées dans différents supports d’investissement (actions, obligations, monétaires…) et de modifier l’allocation des actifs du contrat en fonction, notamment, de l’orientation des marchés. Avant la mise en place d’une gestion pilotée, vous devrez remplir un questionnaire qui permettra de définir votre profil d’investisseur. Profil qui va dépendre, notamment, de votre aversion ou non au risque et de votre horizon de placement. Généralement, les assureurs définissent 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique.
Rente viagère : utiliser l’option des annuités garanties
Certains contrats retraite proposent des options liées au versement d’une rente viagère. L’une d’elles, les annuités garanties, permet notamment d’améliorer le sort du conjoint survivant.
La préparation de la retraite est depuis plusieurs années un sujet de préoccupation majeur pour l’ensemble des Français. Et compte tenu des difficultés rencontrées par notre système de retraite par répartition pour assurer des pensions de retraite convenables, on trouve sur le marché des produits d’épargne destinés à compenser la baisse des revenus lors de la retraite. Ces produits retraite proposent de nombreuses options portant sur les modalités de versement de l’épargne au moment de la fin de l’activité de l’épargnant. Les annuités garanties en font partie en permettant de limiter le risque de perdre le bénéfice d’une rente viagère en cas de décès prématuré. Explications.
Une rente viagère ?
Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer » son capital en un revenu régulier qui lui sera servi jusqu’à sa mort. Le contrat de rente viagère est signé avec l’assureur. C’est lui qui, en contrepartie du capital versé par l’assuré et des intérêts capitalisés, garantit à ce dernier le versement des arrérages. Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital placé par l’épargnant. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital aliéné un taux de conversion qui est défini en fonction de son âge et de son espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité établies par l’Insee) au moment de l’entrée en jouissance de la rente viagère. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ».
La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité, dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère.
Ensuite, elle dégage le crédirentier de toute obligation de gestion de patrimoine, ce qui, lorsque l’heure de la retraite a sonné, est très confortable. Enfin, elle est un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur (appelé également le débirentier) jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.
Faire appel aux annuités garanties
Mais associer le versement de la rente à la durée de vie du crédirentier ne présente pas que des avantages. En effet, en cas de décès prématuré de ce dernier, le capital restant (capital initial – total des rentes versées) est perdu et n’entre pas dans sa succession. C’est la raison pour laquelle la sortie en rente viagère est déconseillée aux personnes dont la santé est fragile ou qui ont pour objectif de transmettre leur épargne à leurs héritiers.
Toutefois, les contrats retraite offrent au souscripteur la possibilité d’opter pour la mise en place d’annuités garanties. En pratique, lors de la liquidation de la rente, le souscripteur désigne un bénéficiaire (sa désignation est irrévocable) et détermine le nombre d’annuités garanties en fonction de son âge : ce nombre est limité à son espérance de vie théorique au jour de la liquidation de sa rente, diminué de cinq ans. S’il est toujours en vie au terme des annuités garanties, il continuera à percevoir sa rente normalement, sa vie durant. S’il décède avant le terme des annuités garanties, le bénéficiaire désigné continuera à percevoir la totalité de la rente pendant le nombre d’années restant à courir. Une option qui permet donc de protéger davantage, par exemple, le conjoint survivant.
À noter que, comme pour la rente viagère « classique », la rente à annuités garanties est revalorisée périodiquement selon les résultats techniques et financiers de la compagnie d’assurance, ce qui garantit un taux minimal de progression des revenus.
Quelle fiscalité ?
Les rentes viagères sont toutes soumises à l’impôt. Mais leurs modalités d’imposition diffèrent selon le produit d’épargne dont elles sont issues.
Dans le cadre de l’assurance-vie, du Perco ou du PER (sans option pour la déduction des cotisations à l’entrée), les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement d’après l’âge du crédirentier lors du premier versement de la rente, est de 70 % avant l’âge de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà de 69 ans.
Dans celui des contrats retraite Perp et Madelin, les arrérages sont soumis, chaque année, à l’impôt sur le revenu, comme les pensions de retraite. S’applique ainsi le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 10 %. Les prélèvements sociaux sont également dus. Enfin, les rentes dégagées d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que le contrat ait été détenu par le crédirentier plus de 8 ans. Dans le cas contraire, une fraction des arrérages est soumise à l’impôt sur le revenu. Là encore, le crédirentier doit s’acquitter des prélèvements sociaux, peu importe que le PEA ait ou non plus de 8 ans.
Réduire ses impôts en utilisant le levier du déficit foncier
Lorsque les charges sont plus importantes que les recettes locatives, un déficit foncier est constaté. Un déficit qu’il est possible d’imputer sur ses revenus imposables.
Vous possédez des biens immobiliers et vous souhaitez faire baisser la pression fiscale qui s’exerce sur eux. Pourquoi ne pas réaliser des travaux dans le but de créer du déficit foncier ? Une stratégie qui présente certains avantages.
Un déficit foncier ?
Les bailleurs qui louent des locaux nus déclarent leurs revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la détermination du revenu imposable, ils peuvent déduire certaines charges qu’ils ont supportées pour la location de leurs biens immobiliers.
Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque le bailleur est imposé selon le régime dit « du micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, pour pouvoir imputer ses charges, le propriétaire doit bailleur relever du régime réel.
Après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur ses revenus imposables.
L’imputation des déficits fonciers
Des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur les revenus des contribuables. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent, en principe, sur le revenu global du propriétaire, dans la limite annuelle de 10 700 €.
Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Et attention, l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.
Autre point de vigilance, pour pouvoir déduire ses dépenses, le bailleur doit être en mesure de les justifier auprès de l’administration fiscale. Il convient donc de conserver tous les documents correspondants (factures...).
Des SCPI de déficit foncier !
Pour réduire votre imposition, vous pouvez également faire appel aux SCPI « de déficit foncier ». Il s’agit de SCPI investies dans des locaux d’habitation à rénover. Généralement, les sociétés de gestion de ces SCPI se donnent pour objectif de réaliser une quote-part de travaux de 40 à 60 % du montant de la souscription. Une quote-part que le souscripteur pourra déduire de ses revenus.
Investir en bourse grâce aux Exchange Traded Funds
Les ETF sont des fonds cotés en bourse qui permettent de diversifier ses placements. Des fonds d’investissement facile d’accès qui présentent certains avantages.
L’engouement des investisseurs pour les ETF (Exchange Traded Funds) ne faiblit pas. En effet, en 2020, ces fonds indiciels cotés en bourse ont collecté, au niveau européen, près de 79 milliards d’euros, plus forte collecte jamais enregistrée. Au total, les encours des ETF ont progressé de 116 milliards d’euros en l’espace d’un an. Des chiffres qui interpellent et qui incitent à se poser la question de savoir ce qui attire les investisseurs vers ce type d’actifs.
Un ETF, c’est quoi ?
Produits à gestion passive, les Exchange Traded Funds (appelés également trackers) sont des supports d’investissement cotés en bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisés » dans certains pays, certains secteurs d’activité, mais aussi investis en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires. En outre, les ETF peuvent répliquer les performances monétaires d’une devise ou permettre de miser sur l’évolution du prix des matières premières telles que l’or, le pétrole ou le blé.
L’intérêt des ETF
Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention toutefois, comme de nombreux placements, il comporte des risques. En effet, si les cours du sous-jacent s’effondrent, l’ETF subira dans les mêmes proportions une baisse de ses performances. En termes de fonctionnement, les ETF se négocient de la même façon qu’une action et permettent d’investir, en une seule opération, sur un indice ou un panier d’actions. Outre leur grande diversité, les ETF présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 à 0,5 % sont prélevés.
Une fiscalité empruntée aux actions
La fiscalité des ETF est la même que celle qui pèse sur les actions. Ainsi, dans le cadre d’un compte-titres, par exemple, les dividendes versés sont ajoutés aux revenus de l’investisseur et imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Sur option, ce dernier peut préférer le barème progressif de l’impôt sur le revenu (sous réserve de l’application d’un abattement de 40 %). Quant aux plus-values réalisées lors de la cession d’ETF, elles sont, là encore, imposées au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, et pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les plus-values peuvent être réduites d’un abattement lié à la durée de détention.
Lorsque les ETF sont détenus au sein d’un PEA, les produits (dividendes, plus-values de cession…) sont fiscalisés au moment de leur retrait. En cas de retrait avant l’expiration de la 5e année suivant l’ouverture du PEA, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique et aux prélèvements sociaux, sauf option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour un retrait effectué après la 5e année, les gains sont exonérés d’impôt et soumis uniquement aux prélèvements sociaux.
Comment investir ?
Vous pouvez acquérir des parts d’ETF soit auprès d’un intermédiaire financier agréé, soit, sous certaines conditions, lors de leur création (marché primaire), soit encore directement en bourse (marché secondaire). Les ETF sont négociables sur le marché boursier dans les mêmes conditions qu’une action, ce qui leur permet d’être accessibles en continu durant la journée boursière. Ils peuvent, en outre, être achetés au comptant et au SRD (service de règlement différé) si les entreprises qui composent l’indice font partie des plus importantes du marché parisien. À noter que les ETF peuvent être logés au sein des principales enveloppes françaises : compte-titres, Plan d’épargne en actions, contrat d’assurance-vie et Plan d’épargne retraite.
Quelques bonnes pratiques
L’apparente simplicité des ETF ne doit pas vous dispenser de respecter des règles élémentaires de prudence avant d’investir. Voici quelques bonnes pratiques à garder en tête. Tout d’abord, il existe un nombre important d’ETF. Certains de ces ETF peuvent être complexes. Et leur dénomination, parfois obscure, peut conduire à faire de mauvais choix. Ensuite, un investissement dans des ETF doit correspondre à vos objectifs, à votre appétence aux risques et à votre horizon de placement. Ainsi, pour pouvoir prendre une décision éclairée, il est nécessaire de lire attentivement le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du fonds et le prospectus de l’ETF. Des documents qui contiennent des précisions sur les objectifs et la politique de gestion du fonds, sur le profil de risque et de rendement, ou encore sur les frais.
Faut-il encore investir dans des places de parking ?
Malgré la tendance verte des grandes métropoles françaises, acquérir une place de parking peut encore être très rentable.
Ticket d’entrée peu élevé, rendement attractif, contraintes locatives quasi inexistantes… Faire l’acquisition d’une ou de plusieurs places de parking n’est pas dénué d’intérêt. À condition de faire les bons choix.
Les avantages de cet investissement
L’acquisition de places de parking ou de garages en vue de les louer peut constituer pour un investisseur une excellente opportunité de diversifier son patrimoine immobilier. Cet investissement peut également se révéler très rentable et offrir, dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, notamment, des rendements supérieurs à 5 % par an.
Autre avantage, et non des moindres, l’acquisition de places de parking peut être réalisée avec une mise de départ modeste. En effet, les prix pour une place de parking ou un garage s’échelonnent en moyenne entre 15 000 € et 50 000 € pour une place individuelle à Paris et entre 6 000 € et 25 000 € en province.
Un investissement d’un autre temps ?
Compte tenu des politiques environnementales menées par les pouvoirs publics ces dernières années, la question de l’avenir de ce type d’investissement peut se poser. En effet, par exemple, la métropole du Grand Paris a fait savoir qu’elle comptait interdire tous les véhicules thermiques d’ici à 2030.
Une politique qui pourrait d’ailleurs donner des idées à d’autres métropoles françaises...
Du coup, si le Grand Paris arrive à tenir cet objectif, les places de parking risquent, à terme, de perdre de leur valeur. Aussi, afin d’éviter les mauvaises surprises, il peut être intéressant de revoir le secteur géographique d’investissement en privilégiant notamment les villes de province importantes où l’utilisation d’un véhicule personnel est quasi incontournable. Et préférer celles où le manque de places de stationnement est important et durable.
Une autre stratégie peut consister à anticiper les mutations de la mobilité dans les grandes villes (développement de l’usage de la voiture électrique, notamment). L’idée étant de réaliser des travaux pour équiper les places de parking de bornes de charge pour véhicules électriques. Dans certains cas, un crédit d’impôt pourra même être obtenu par les investisseurs. Le taux de ce dernier étant égal à 75 % des dépenses engagées. Étant précisé que son montant est limité à 300 € par système de charge.
Investir dans un box
Bien que certaines grandes villes aient l’intention de réduire le nombre de véhicules thermiques dans leurs rues, les box et les garages fermés peuvent tirer leur épingle du jeu. En effet, ces espaces peuvent être reconvertis et servir à du stockage, voire à des activités de bricolage.
Comment bien protéger votre conjoint ?
Pour assurer l’avenir du conjoint survivant, les époux peuvent notamment agir sur leur régime matrimonial et mettre en place des solutions d’assurance.
Protéger son conjoint en cas de décès fait partie des préoccupations de tous les couples. Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes stratégies peuvent être utliisées.
Adapter son régime matrimonial
Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Un régime qui octroie au conjoint survivant la moitié des biens communs du couple. Ainsi, lors du règlement de la succession, un partage s’opère sur le patrimoine du défunt, composé de la moitié de la communauté et de ses biens propres. L’époux survivant peut, par conséquent, prétendre à une partie de ces biens, en qualité d’héritier.
Mais il est possible d’avantager encore un peu plus le conjoint survivant en insérant diverses clauses dans un régime légal comme la clause dite de « partage inégal » qui autorise la transmission de plus de la moitié du patrimoine au conjoint survivant.
Plus protecteur encore, il est également possible d’opter pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Dans cette configuration, les époux conviennent de mettre en commun tous leurs biens. Et la clause d’attribution intégrale permet, quant à elle, au conjoint survivant de recueillir la totalité de la communauté universelle en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime matrimonial « radical » présente des inconvénients pour les enfants du couple. À manier avec précaution !
Consentir une donation entre époux
La donation entre époux est un acte notarié qui permet à l’un des époux d’augmenter les droits sur la succession de l’autre au moment de son décès sans pour autant pénaliser ses enfants. En effet, grâce à cet outil, le conjoint survivant dispose notamment d’un choix plus important sur le patrimoine dont il hérite que celui prévu par la loi. Ce dernier pourra ainsi opter soit pour :- la moitié (en présence d’un seul enfant), le tiers (en présence de deux enfants), ou le quart en pleine propriété (en présence de trois enfants ou plus) des biens de la succession ;- la totalité des biens en usufruit ;- ou un quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.
Principal intérêt de la donation entre époux : elle permet un panachage des droits en pleine propriété et en usufruit, ce que la loi ne prévoit pas. La donation entre époux présente, en outre, la particularité d’être compatible avec n’importe quel régime matrimonial (séparation de biens, communauté légale…).
Opter pour des solutions de prévoyance
Afin d’anticiper les coups durs, il est possible de se tourner vers une assurance décès. Concrètement, en cas de réalisation de l’événement assuré, la compagnie d’assurance garantit, en échange de cotisations, le versement de prestations, sous forme de capital ou de rente selon les cas, à l’assuré ou à ses ayants droit. Assurer la protection de son conjoint passe aussi par l’assurance-emprunteur. En effet, dans le cadre d’un crédit immobilier, cette dernière garantit la prise en charge de tout ou partie des échéances de remboursement d’un crédit dues en cas de survenue de certains événements, le plus souvent le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente, l’incapacité temporaire de travail et la perte d’emploi. Avec un contrat assurant le capital à hauteur de 100 % sur la tête de chaque emprunteur, si l’un d’entre eux décède, l’autre n’aura plus rien à rembourser !
Couples non mariés : quelles solutions ?
Contrairement aux personnes mariées, les partenaires de Pacs et les concubins n’héritent pas l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle il leur est vivement conseillé de rédiger un testament. En l’absence d’enfant, ce document peut, en principe, prévoir une transmission de la totalité du patrimoine en faveur de l’autre. À noter que le partenaire pacsé survivant bénéficie, au même titre que le conjoint survivant, d’une exonération totale de droits de succession. Ce qui n’est pas le cas des concubins ! Une transmission par ce biais sera donc fiscalement pénalisante pour eux. En effet, les droits de succession applicables dans ce cadre s’élèvent à 60 % (après abattement de 1 594 €) !
Autre solution, faire appel à l’assurance-vie. Cette dernière répond idéalement à la problématique de la protection. En effet, grâce à ce contrat, il est possible de désigner son conjoint qui recevra, en cas de décès, l’intégralité des sommes épargnées du vivant de l’assuré. Lors du décès, ces sommes transmises hors succession bénéficieront d’un traitement fiscal extrêmement favorable (exonération totale de droits de succession pour les couples mariés ou pacsés, exonération jusqu’à 152 500 € pour les couples en concubinage).
Connaissez-vous l’assurance-vie luxembourgeoise ?
Les contrats d’assurance-vie du Grand-Duché suscitent l’intérêt de nombreux épargnants.
Les assurances-vie luxembourgeoises continuent de séduire les épargnants français. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, en 2019, la collecte a établi un nouveau record : 17 Md€ en unités de compte (+10 %) et 11 Md€ placés sur des fonds garantis (+35 %). Fait marquant, la France est, de loin, le premier marché de l’assurance-vie luxembourgeoise en Europe. Des chiffres qui amènent à se poser la question de la raison de cet engouement.
Un contrat sur-mesure
Le principal intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel très large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur pourra investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats hauts de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés ou encore des contrats de devises. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants disposant d’actifs à l’international.
Un contrat sécurisé
L’assurance-vie luxembourgeoise bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer en priorité, avant tout autre créancier, les sommes déposées en cas de défaillance de l’assureur.
Transmission : comment alléger la facture fiscale ?
Grâce à l’utilisation d’abattements, il est possible de faire baisser le coût fiscal d’une transmission.
En principe, des droits de mutation sont dus lorsque des biens passent d’un patrimoine à un autre. Des droits de mutation dits « à titre gratuit » lorsque ce transfert de propriété s’opère via, par exemple, une donation ou une succession. Et pour diminuer le montant de ces droits, des abattements fiscaux existent en faveur des contribuables. Tour d’horizon.
Transmission par succession
Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits sont dus, sachant que des abattements sont prévus.
Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €.
Dans les autres situations, l’abattement est plus modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !
Transmission par libéralités
Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réalisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est possible de profiter, pour partie, des mêmes abattements que ceux prévus pour les successions. Par exemple, une donation entre parents et enfants est exonérée de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abattement est octroyé à chaque parent et non pas pour le couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. Particularité, les transmissions réalisées par donation entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement de 80 724 €.
Mais attention, globalement, ces différents abattements fiscaux, une fois consommés, ne se reconstituent qu’au bout d’une période de 15 ans.
À noter :
Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.
Tarif et paiement des droits de mutation
Une fois l’abattement appliqué sur le montant transmis, les éventuels droits de mutation à payer sont calculés selon un barème progressif. Barème qui dépend, là encore, du degré de parenté entre l’héritier et le défunt ou le donateur.
À ce titre, afin de faciliter les transmissions, l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéficier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement différé ou fractionné des droits de mutation. Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés (c’est-à-dire divisés en nue-propriété d’un côté et usufruit de l’autre). Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de ces droits.
Préparer sa retraite : PER ou assurance-vie ?
Depuis octobre 2019, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) est disponible. Comme l’assurance-vie, il permet de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Mais une question se pose : lequel de ces contrats faut-il privilégier ? Tout dépend bien évidemment des besoins de l’assuré et de sa situation patrimoniale. Pour vous aider à faire un choix, nous vous proposons de comparer ces deux supports.
Une épargne disponible avec l’assurance-vie
Contrairement au PER, l’assurance-vie autorise l’épargnant à effectuer des retraits à tout moment.
Durant la phase d’épargne, les sommes logées dans une assurance-vie peuvent être récupérées à tout moment par l’assuré, par le biais d’un rachat partiel ou total. Attention toutefois, les rachats entraînent, en principe, une taxation à l’impôt sur le revenu. Dans certaines situations seulement, ces rachats sont exonérés d’impôt : licenciement, liquidation judiciaire, mise en retraite anticipée ou invalidité de l’assuré ou de son conjoint.
Pour le PER, les rachats ne sont pas possibles. L’épargne est donc bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de l’épargne ont été prévus : acquisition de la résidence principale, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité affectant le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou un enfant, situation de surendettement, expiration des droits au chômage ou, pour les mandataires sociaux, absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans ou cessation d’une activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
La déduction des versements avec le PER
Le PER permet de déduire des revenus de l’assuré le montant des cotisations versées. L’assurance-vie, quant à elle, n’offre aucun avantage fiscal au moment des versements.
Les versements réalisés dans le cadre d’une assurance-vie n’engendrent aucun avantage fiscal. Ce qui n’est pas le cas du PER. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :- 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 101 € maximum au titre de 2020 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.
Pour les versements effectués par les particuliers (salariés...), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 419 € en 2020 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 052 €.
PER : un transfert de contrat facilité
Il est possible de transférer les droits d’un PER vers un autre PER ouvert dans un établissement concurrent.
Transférer l’épargne accumulée sur un PER vers un autre PER est possible. Toutefois, s’il est réalisé dans les 5 ans suivant l’ouverture du contrat, des frais, plafonnés à 1 % des droits acquis, sont dus. Au-delà de 5 ans, ce transfert est gratuit.
Du côté de l’assurance-vie, depuis la loi Pacte, le transfert de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie à un autre est envisageable. Attention cependant, ce transfert ne peut être réalisé que chez le même assureur (ou filiale de cet assureur). Un transfert qui s’opérera sans perte de l’antériorité fiscale.
La fiscalité en sortie : une situation contrastée
Au moment de la retraite, l’assuré doit choisir entre la rente viagère et le versement d’un capital. Selon l’option choisie, la fiscalité est plus ou moins pénalisante.
Que ce soit pour le PER ou l’assurance-vie, l’assuré peut profiter de son épargne soit par le versement d’une rente viagère, soit par la perception d’un capital. Dans le cadre du PER, lorsque la rente viagère a été choisie et que l’assuré ne souhaite pas déduire ses cotisations lors de leur versement, une fraction seulement de la rente est soumise à l’impôt sur le revenu, selon l’âge du rentier au premier versement. Cette fraction étant de 70 % sur les produits si le rentier est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans. Si les cotisations ont été déduites à l’entrée, la rente viagère est totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 %. Dans les deux cas, des prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente, avec un abattement en fonction de l’âge, trouvent à s’appliquer. Pour l’assurance-vie, la rente viagère est imposée de la même manière que celle issue du PER lorsque les cotisations n’ont pas été déduites à l’entrée. Match nul entre les deux supports !
En cas de sortie en capital, l’écart se creuse entre les deux produits. L’assurance-vie jouit d’une fiscalité plus douce. En effet, seuls les gains générés par le contrat sont soumis au PFU au taux réduit de 7,5 % jusqu’à 150 000 € et de 12,8 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Étant précisé qu’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s’applique sur ces contrats de plus de huit ans.
Avec un PER, en cas de déduction des cotisations à l’entrée, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les gains sont soumis au PFU au taux de 12,8 %. Là encore, des prélèvements sociaux sont dus. En revanche, si l’assuré n’a pas choisi de déduire, seuls les gains sont soumis au PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux. En clair, la sortie en capital dans le cadre du PER est pénalisante !
Conclusion
Vous le constatez, le PER constitue un formidable outil pour préparer votre retraite et paraît mieux armé que l’assurance-vie, notamment pour les personnes qui se situent dans une tranche marginale d’imposition supérieure ou égale à 30 %. Situation dans laquelle le levier fiscal fonctionne de façon optimale. Dans le même temps, l’assurance-vie reste un produit performant et incontournable en gestion de patrimoine. Un contrat qui permet de protéger le conjoint survivant, d’organiser la transmission à ses enfants, de valoriser un capital, d’aider à financer un projet… Afin de faire le bon choix, il est donc essentiel de réaliser une étude personnalisée qui tiendra compte de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos objectifs.
Durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers
Les banques se montrent plus regardantes avant d’accorder des crédits immobiliers.
Depuis la fin du confinement, les investisseurs reviennent en force sur le marché de l’immobilier. Mais dans un contexte économique incertain, les banques sont de plus en plus sélectives s’agissant de l’attribution des prêts immobiliers.
Une crispation des autorités et des banques
Quelques mois avant le confinement, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, incitait les établissements bancaires à limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Des limites imposées pour éviter les risques de surchauffe et pour réduire les volumes importants de crédits immobiliers octroyés aux ménages français. Des limites qui ont conduit à exclure de nombreuses personnes de l’accès au prêt.
Et avec la crise sanitaire du Covid-19, les conditions d’octroi d’un crédit immobilier vont encore se durcir.
Des dossiers passés au crible
Outre le taux d’endettement, les banques s’intéressent de près au reste à vivre, à la capacité d’épargne, au montant de l’apport et, nouveauté, au secteur d’activité des candidats à l’emprunt.
Ainsi, par exemple, un pilote de ligne, bien qu’ayant de très hauts revenus, peut se voir refuser un financement au motif qu’un risque trop important pèse actuellement sur le secteur aérien et que les probabilités qu’il perde son emploi sont donc élevées. D’autres secteurs sont aussi concernés comme l’habillement, l’automobile, l’évènementiel ou encore l’hôtellerie-restauration.
Pour évaluer le risque, les banques examinent également le bien à financer. Par exemple, une maison cotée située dans une zone périurbaine avec travaux ou loin des transports pourrait perdre de la valeur en cas de retournement du marché. Ce qui conduirait à mettre en difficulté l’emprunteur qui serait alors obligé de vendre son bien immobilier à un prix inférieur au montant emprunté.
L’infuence du taux d’usure
Un autre facteur conduit à rejeter certains dossiers : le taux d’usure. Il s’agit du taux maximal (comprenant le taux d’intérêt de base, les différents frais, le coût de l’assurance) auquel les banques sont autorisées à prêter de l’argent lors d’un achat immobilier. Le plafond de ce taux d’usure est relativement bas depuis plusieurs mois. Du coup, ce sont les dossiers les plus fragiles qui sont exclus car ils obtiennent les taux d’intérêts les moins intéressants.
Embellir son dossier
Pour rassurer la banque, l’idéal est de disposer de 20 à 30 % de la valeur du bien, à la fois pour constituer un apport et pour couvrir les frais de notaire et d’agence. Autre moyen de rassurer, détenir une épargne de précaution après achat représentant environ 6 mensualités de prêt.
Votre épargne est-elle à l’abri en cas de crise ?
Un fonds de garantie spécifique protège une partie de l’épargne des Français.
Selon un sondage Harris Interactive d’avril 2019, 54 % des Français pensent que leur argent ne serait pas protégé si leur banque faisait faillite. L’occasion de rappeler l’existence du fonds de garantie des dépôts.
Une garantie plafonnée
Le fonds de garantie des dépôts permet aux épargnants, en cas de faillite d’un établissement financier, d’être couverts jusqu’à 100 000 € sur les sommes déposées sur leurs comptes (compte courant, compte épargne logement, plan d’épargne logement...), hors livrets d’épargne règlementée. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts effectués par une même personne dans une même banque, quel que soit le nombre de comptes qui ont été ouverts. Ce qui veut dire que si elle détient des comptes dans plusieurs banques, elle pourra profiter du plafond autant de fois que d’établissements concernés.
À noter que le fonds de garantie des dépôts couvre tous les déposants : particuliers, mineurs ou majeurs, sous tutelle ou représentés par un tiers, entreprises (SA, SARL...), entrepreneurs individuels, associations ou autres groupements professionnels.
En outre, un fonds spécifique existe pour couvrir les titres et les autres instruments financiers confiés à un intermédiaire financier (actions, obligations…) sur un plan d’épargne en actions ou sur tout autre compte-titres (couverture à la fois des titres et des espèces associées au fonctionnement des comptes-titres). En cas de défaillance de l’intermédiaire boursier, ces fonds sont couverts à hauteur de 70 000 €.
Quid des livrets règlementés ?
Toutes les sommes déposées sur des livrets d’épargne règlementée (Livret A, LDDS et Livret d’épargne populaire) sont garanties jusqu’à 100 000 € par client et par établissement. Cette garantie s’ajoute à celle couvrant les comptes courants et d’épargne classique.
Une garantie étendue
La limite de 100 000 € peut être dépassée dans le cadre des « dépôts exceptionnels temporaires », c’est-à-dire des sommes encaissées moins de 3 mois avant la défaillance de l’établissement et qui proviennent notamment de la vente d’un bien immobilier, de la réparation en capital d’un dommage, du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession ou d’une donation. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la limite d’indemnisation est relevée à 500 000 €.
Et l’assurance ?
Pour les produits d’assurance, c’est le fonds de garantie des assurances de personnes qui peut être actionné. Il prévoit, en cas de faillite d’une compagnie d’assurances, une indemnisation à hauteur de 70 000 € par assuré, adhérent ou bénéficiaire, quel que soit le nombre de contrats d’assurance-vie, de capitalisation ou retraite souscrits auprès de cet assureur.
Pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et celles résultant d’un contrat d’assurance décès, l’indemnisation maximale est de 90 000 €.
Que faire de ses anciens contrats d’épargne retraite ?
Avec l’arrivée du nouveau Plan d’épargne retraite, un bilan portant sur ses contrats d’épargne supplémentaires doit être fait. Un bilan qui permettra d’envisager ou non un transfert vers le PER.
Pour préparer votre retraite, vous avez peut-être souscrit un Perp ou un contrat Madelin. Mais à l’heure du nouveau Plan d’épargne retraite (PER), faut-il conserver ces contrats ou transférer les droits qui y sont inscrits sur un PER ? Éléments de réponse.
Transférer son Perp
Si vous possédez un plan d’épargne retraite populaire (Perp), vous n’avez pas forcément intérêt à le conserver. En effet, le PER, plus souple et plus complet, reprend pour l’essentiel les caractéristiques du Perp : déductibilité des cotisations, cas de déblocage anticipé des sommes, sortie en rente viagère…
Toutefois, le Perp présente une spécificité fiscale par rapport au PER. En cas de sortie en capital au moment du départ à la retraite (autorisée à hauteur de 20 % ou en totalité pour l’achat d’une résidence principale), les sommes épargnées peuvent, sur option, être soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu de 7,5 % assis sur le montant du capital diminué d’un abattement (non plafonné) de 10 %. Une fiscalité plutôt légère ! Si vous souhaitez acquérir votre résidence principale au moment de votre départ à la retraite, vous avez donc tout intérêt à conserver votre Perp.
Éplucher son contrat Madelin
Le cas du contrat Madelin est plus délicat à traiter puisqu’il bénéficie d’options que l’on ne retrouve pas au sein du PER. Ce qui veut dire qu’il faut, avant d’envisager un transfert, analyser attentivement votre situation et le contenu de votre contrat. Par exemple, certains contrats Madelin offrent des tables de mortalité garanties. Ces tables, qui déterminent l’espérance de vie, servent en partie à calculer le montant de la rente viagère versée à l’assuré. Or, des changements de tables interviennent régulièrement afin de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie. Et plus l’espérance de vie augmente, plus le montant de la rente viagère que versera l’assureur diminue. Pour protéger un niveau de rente, l’assureur peut s’engager à figer la table de mortalité qui sera utilisée pour la conversion du capital en rente. Un avantage non négligeable !
Vers une fin programmée
Les « anciens » contrats retraite (Perp, Madelin, Préfon, Corem, Perco, article 83…) ne pourront plus être souscrits à compter du 1er octobre 2020. Les assurés qui en disposent actuellement pourront soit continuer à les faire fonctionner, soit transférer l’épargne accumulée sur ces produits au sein d’un PER souscrit pour l’occasion.
Étant précisé que le transfert de vos droits de votre ancien contrat retraite vers un PER est gratuit. À condition toutefois que ce contrat ait plus de 10 ans. Si tel n’est pas le cas, des frais vous seront facturés. Des frais plafonnés à 5 % de l’encours.
En résumé, face à la complexité du sujet, mieux vaut se faire accompagner par un spécialiste pour déterminer si un changement de contrat servira ou non votre stratégie patrimoniale.
À noter :
Il sera possible, jusqu’au 31 décembre 2022, de transférer l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers un plan d’épargne retraite. Ces sommes iront alimenter le compartiment individuel du PER.
Les rendements 2019 des assurances-vie en euros
Le rendement des fonds en euros est encore en baisse en 2019.
Les années se suivent et les épargnants font toujours le même constat : le rendement des fonds en euros continue sa lente et inexorable chute. Pour l’année 2019, le rendement moyen de ces actifs a atteint un nouveau plancher : 1,40 %, soit 0,2 point de moins qu’en 2018. Une baisse qui n’a rien de surprenant puisque les taux des obligations d’État, qui composent majoritairement les fonds en euros, sont en berne. En outre, compte tenu de l’environnement économique actuel, les autorités (Banque de France et ACPR) ont appelé les établissements financiers à baisser drastiquement la rémunération servie aux épargnants.
Des niveaux de collecte toujours élevés
Selon la Fédération française de l’assurance, malgré la baisse des rendements, l’assurance-vie continue de séduire. En effet, la collecte nette en 2019 (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 25,9 milliards d’euros, soit 4,4 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Et l’encours des contrats d’assurance-vie s’élevait à 1 788 milliards d’euros à fin décembre 2019, en progression de 6 % sur un an.
Les rendements 2019 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
| Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
| 2019 | 2018 | ||
| Afer | Compte Afer | 1,85 % | 2,25 % |
| Agipi / Axa | Cler | 1,70 % | 2,10 % |
| Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,30 % | 1,70 % |
| Allianz Vie | Gaipare | 2,15 % | 2,50 % |
| Asac-Fapès | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,05 % | 2,48 % |
| Axa | Figures Libres | 1,60 % à 2 % | 1,90 % à 2,25 % |
| BforBank | BforBank Vie | 1,65 % | 2,10 % |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,27 % | 1,56 % |
| Boursorama.com | Boursorama Vie | 1,55 % | 2,31 % |
| Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,25 % | 1,90 % |
| CNP / La Banque Postale | Cachemire 2 | 1,25 % à 1,37 % | 1,90 % à 2,09 % |
| Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 Série 2 | 1,20 % | 1,25 % |
| Generali Vie | Xaélidia | 2 % | 2,45 % |
| GMF Vie | Multéo | 1,90 % | 2,10 % |
| ING | ING Vie | 1,50 % à 1,70 % | 2,25 % |
| LCL | LCL Vie | 1,70 % | 1,75 % |
| Le Conservateur | Helios Sélection | 1,80 % | 2,27 % |
| MACIF | Mutavie Actiplus | 1,80 % | 1,90 % |
| MAAF VIE | Winalto | 1,75 % | 1,85 % |
| MACSF | RES Multisupport | 1,70 % à 1,75 % | 2,20 % |
| MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 1,95 % | 2,35 % |
| MMA Vie | Multisupports | 1,47 % à 1,97 % | 1,51 % à 2,01 % |
| Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 1,15 % | 1,65 % |
| Mutavie | ActiPlus | 1,80 % | 1,90 % |
| Natixis Assurances | Horizéo | 1 % à 1,35 % | 1,25 % à 1,60 % |
| Nortia | Canopla | 2,20 % | 1,75 % |
| Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 1,50 % | 1,80 % |
| SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 1,65 % | 2,24 % |
| Société Générale / Sogecap | Séquoia | 0,90 % à 1,38 % | 1,33 % à 1,78 % |
| Spirica | Private Vie | 1,20 % | 1,60 % |
| Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 1,60 % | 2 % |
| Swiss Life | Liberté | 1 % à 2,70 % | 1,50 % à 2,50 % |
| UAF Life Patrimoine | Arborescence Opportunités | 1,50 % | 2,90 % |
Renoncer à une succession pour mieux transmettre
Renoncer à un héritage peut permettre de donner un coup de pouce à ses enfants.
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les patrimoines se transmettent de plus en plus tard. Du coup, lorsqu’un héritier estime ne pas avoir besoin de la partie du patrimoine du défunt qui lui est destinée, il peut y renoncer pour que ses propres enfants en bénéficient directement.
Un saut de génération
Il est possible pour un enfant de renoncer à la succession de ses parents pour permettre à ses propres enfants d’hériter à sa place. Une renonciation qui présente un double avantage.
D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans avoir à se dessaisir de biens de son propre patrimoine. D’autre part, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.
Attention toutefois, car la renonciation est un acte lourd de conséquences. En effet, un héritier ne peut pas renoncer à une partie de ses droits seulement. Et il ne peut pas non plus décider de la manière dont seront transmis les biens auxquels il renonce.
Bien qu’étant étranger à la succession, l’héritier renonçant garde cependant certains droits comme celui de conserver des souvenirs de famille (décorations militaires, diplômes...), de défendre la mémoire et l’honneur du défunt ou encore de se faire rembourser par la succession les frais qu’il a légitimement exposés pour le compte de celle-ci avant d’y avoir renoncé.
Comment renoncer ?
L’enfant qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession de ses parents dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour le faire. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à faire le choix d’accepter ou de refuser la succession.
Il doit ensuite faire connaître sa décision. Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*02) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Un formulaire devant être accompagné de certaines pièces : une copie recto verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.
Renonciation et assurance-vie
La renonciation à une succession n’emporte pas la renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie dont le renonçant est désigné en tant que bénéficiaire.
À noter :
pour réaliser une transmission de patrimoine avec un saut de génération, il est possible de faire appel à un autre outil : la donation-partage transgénérationnelle. Cette dernière permet aux grands-parents de transmettre et de répartir, de leur vivant, tout ou partie de leurs biens (somme d’argent, biens meubles et immeubles...) en faveur de leurs petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Les parents devant toutefois consentir, ici aussi, à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place. Fiscalement, la donation-partage donne droit à un abattement spécifique de 31 865 € pour chaque petit-enfant. Cet abattement étant renouvelable tous les 15 ans.
Connaissez-vous le dispositif Pinel « centre-ville » ?
Un dispositif fiscal a été créé afin d’encourager la rénovation des centres-villes dégradés. Passage en revue des principales conditions liées à ce nouveau type d’investissement locatif.
Les logements concernés
Sont visées les opérations de rénovation réalisées dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué.
Le Pinel « centre-ville », aussi appelé « dispositif Denormandie », concerne les logements anciens situés dans le centre d’une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ou ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT). Une liste des communes éligibles ayant été récemment communiquée.
Pour bénéficier du dispositif, les investisseurs doivent acquérir dans une de ces communes, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, un logement rénové ou à rénover. Sachant que les travaux de rénovation doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.
Précision :
sont également concernées les acquisitions de locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.
L’investissement peut être réalisé soit en direct par les contribuables, soit par l’intermédiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, soit par la souscription de parts de SCPI (95 % de la souscription devant être affectés à l’acquisition de logements éligibles).
La nature des travaux
Les travaux de rénovation éligibles sont strictement définis.
Les travaux doivent avoir pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie ou la création de surfaces habitables par l’aménagement de surfaces annexes (combles, garages). Ils doivent, en outre, respecter un niveau de performance énergétique globale. Plus précisément, ils doivent permettre d’atteindre une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové inférieure à 331 kWh/m²/an, soit par l’amélioration d’au moins 30 % (20 % dans un immeuble) de l’efficacité énergétique du logement, soit par la réalisation d’au moins deux des cinq catégories de travaux suivantes : isolation de la toiture, isolation des murs extérieurs, isolation des fenêtres, système de chauffage, système de production d’eau chaude sanitaire.
Ils doivent, par ailleurs, être facturés par une entreprise. Sont donc notamment exclus les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu’une entreprise, ainsi que le coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. En revanche, les dépenses liées à l’installation, par une entreprise, de ces matériaux sont prises en compte.
La réduction d’impôt
Le Pinel centre-ville doit respecter les conditions d’application du Pinel « classique ».
Outre les conditions spécifiques tenant aux travaux de rénovation, le Pinel centre-ville doit également respecter les conditions d’application du Pinel « classique » (plafonds de loyers, ressources du locataire…). Il ouvre droit à une réduction d’impôt qui s’applique, pour deux logements au plus par an, sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 €/m² de surface habitable et de 300 000 €.
Attention :
un même logement ne peut pas bénéficier à la fois de la réduction d’impôt Pinel « classique » et Pinel centre-ville.
Le propriétaire bailleur doit donner le logement en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. La location peut toutefois être consentie à un ascendant ou à un descendant. L’investisseur a le choix de s’engager à louer pour une durée minimale de 6 ou 9 ans. Cette option étant irrévocable. Il peut, à l’issue de cette période d’engagement de location de 6 ou 9 ans, décider de prolonger son engagement initial jusqu’à 12 ans, par période de 3 ans. L’avantage fiscal est alors modulé en fonction de la durée de l’engagement de location choisie. Le taux étant ainsi de 12 % pour 6 ans, de 18 % pour 9 ans et de 21 % pour 12 ans. En outre-mer, ces taux sont respectivement fixés à 23 %, 29 % et 32 %.
Taux applicables
| Durée d’engagement initial | Investissement en métropole | Investissement outre-mer |
| 6 ans1re prolongation de 3 ans2de prolongation de 3 ansRéduction d’impôt maximale | 12 %+ 6 %+ 3 %21 % | 23 %+ 6 %+ 3 %32 % |
| 9 ansProlongation de 3 ansRéduction d’impôt maximale | 18 %+ 3 %21 % | 29 %+ 3 %32 % |
La réduction d’impôt est répartie par fractions égales sur 6 ou 9 ans, et accordée, selon les cas, au titre de l’année d’acquisition du logement ou d’achèvement des travaux (ou de la souscription des parts de SCPI). Elle s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des 5 ou 8 années suivantes, à raison de 1/6eou de 1/9ede son montant total au titre de chacune des années comprises dans la période d’engagement initial. En cas de prolongation de l’engagement, l’avantage fiscal s’impute, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans la période de prolongation.
Si le montant annuel de la réduction excède celui de l’impôt dû au titre de la même année, l’excédent ne peut pas être imputé sur l’impôt sur le revenu des années suivantes, ni donner lieu à un remboursement.
À noter :
le dispositif est soumis au plafonnement global des niches fiscales, fixé à 10 000 € par an (ou 18 000 € pour les investissements outre-mer).
Les obligations déclaratives
Des obligations propres au Pinel centre-ville doivent être remplies, en sus de celles du Pinel classique.
Comme pour le Pinel classique, le propriétaire bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus de la première année d’application du dispositif l’engagement de location ainsi qu’un certain nombre de pièces justificatives (copie du bail, avis d’imposition du locataire…). Des documents qui doivent de nouveau accompagner la déclaration de revenus en cas de prorogation de l’engagement de location l’année du terme de l’engagement initial et l’année du terme de la première période triennale.
Et des obligations déclaratives particulières doivent également être remplies. Le propriétaire doit ainsi joindre à cette première déclaration une note récapitulant les travaux réalisés et leur montant. Et il doit tenir à la disposition de l’administration les documents justifiant du respect des conditions de performance énergétique et les factures des entreprises ayant réalisé les travaux de rénovation, identifiant distinctement le montant de ces travaux.
Zoom sur le nouveau plan d’épargne retraite
Dans le cadre de la loi dite « Pacte » du 22 mai 2019, les pouvoirs publics ont souhaité réformer l’épargne retraite pour la rendre plus attractive. Pour cela, ils ont unifié les différents produits d’épargne existants au sein d’un produit unique : le Plan d’épargne retraite (PER). Un nouveau contrat, commercialisé à compter du 1er octobre 2019, qui se veut plus souple et mieux adapté à la carrière professionnelle des assurés. Voici un tour d’horizon des principales caractéristiques de ce Plan d’épargne retraite.
Un produit compartimenté
Le Plan d’épargne retraite est composé d’un compartiment individuel et d’un compartiment collectif. Ces derniers ont vocation à réunir des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83.
Le Plan d’épargne retraite a vocation à rassembler les produits d’épargne retraite supplémentaire actuels. Pour ce faire, il est doté de deux compartiments :- un compartiment individuel (on parle de PERI) qui remplace le Perp et le contrat Madelin ;- et un compartiment collectif, lui-même subdivisé en deux produits : le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC) et le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO).
Le premier produit (le PEREC), qui vient remplacer le Perco, est ouvert à tous les salariés. Une condition d’ancienneté peut être prévue, mais elle ne doit pas dépasser 3 mois. Ce plan sera alimenté par les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement et participation), par des versements volontaires du titulaire, par des jours de congé inscrits au compte épargne-temps et par des abondements de l’entreprise.
Le second produit (le PERO), qui remplace le contrat de l’article 83, peut, quant à lui, être réservé à une catégorie de salariés seulement. Il recevra les cotisations volontaires du titulaire, les jours de congé inscrits sur son compte épargne-temps ainsi que les cotisations obligatoires du salarié ou de l’employeur.
L’alimentation du contrat
Le PER pourra être alimenté notamment par des versements volontaires de l’épargnant. Des versements qui seront investis dans des actifs financiers choisis par l’assuré.
Pour se constituer un capital, l’assuré pourra, pendant son activité, alimenter son PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne sera investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. L’assuré pourra, de son côté, choisir entre des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte…). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat.
À noter :
il sera possible, dès 2022, de transférer l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers un Plan d’épargne retraite. Ces sommes iront alimenter le compartiment individuel.
Intérêt du PER, les sommes épargnées seront intégralement portables d’un compartiment à un autre. La retraite supplémentaire sera ainsi mieux adaptée aux parcours professionnels des assurés.
À noter que les « anciens » produits d’épargne retraite (Perp, Madelin, Préfon, Corem, Perco, article 83…) ne pourront plus être souscrits à compter du 1er octobre 2020. Les assurés qui en disposent actuellement pourront soit continuer à les faire fonctionner, soit transférer l’épargne accumulée sur ces produits au sein d’un Plan d’épargne retraite souscrit pour l’occasion.
La gestion de l’épargne
Le PER bénéficiera d’une gestion dite à horizon. Une gestion qui sécurise l’épargne à l’approche du départ en retraite.
Pour aider les assurés dans la gestion de leur épargne retraite, les établissements financiers devront leur proposer une « gestion à horizon ». Concrètement, il s’agit d’un mécanisme qui consiste à réaliser des arbitrages automatiques des unités de compte (qui ne sont pas garanties) vers des actifs à faible risque (fonds en euros, par exemple), autrement dit à sécuriser la position au fur et à mesure que l’assuré s’approchera de l’âge de départ à la retraite.
Cette gestion à horizon devra également proposer trois profils d’investissement avec des niveaux de risques différents : un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Sachant que, sans action de la part de l’assuré, les versements seront affectés selon une allocation correspondant à un profil équilibré. Mais s’il le souhaite, l’assuré pourra choisir de piloter seul son contrat et de réaliser sa propre allocation d’actifs.
À noter :
s’il désire changer d’établissement financier, l’assuré pourra transférer ses droits vers un autre PER. Un transfert qui engendrera des frais, limités à 1 % des droits acquis pour les plans de moins de 5 ans. Pour les PER de plus de 5 ans, le transfert sera gratuit.
La sortie de l’épargne
L’assuré peut choisir de récupérer son épargne retraite sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère.
Au moment de la liquidation de la retraite, le Plan d’épargne retraite laisse à l’assuré le choix des modalités de sortie de l’épargne. Ce dernier pourra opter, tant pour l’épargne volontaire que pour l’épargne salariale, pour la perception soit d’un capital, soit d’une rente viagère. Les sommes se rapportant aux cotisations obligatoires ne pourront, quant à elles, faire l’objet que d’une rente viagère.
Précision importante :
bien que l’épargne soit bloquée jusqu’au départ à la retraite, le PER prévoit, comme pour le Perp ou le Madelin, des cas de déblocage anticipé : décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire et achat de la résidence principale.
Le régime fiscal du PER
Pour encourager les Français à épargner pour leur retraite, le nouveau Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal favorable.
Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, le régime fiscal attaché au PER se veut incitatif. Ainsi, les versements ouvriront droit à une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, sauf option contraire exercée par l’assuré.
À la sortie, la fiscalité dépendra de l’option choisie à l’entrée et de l’origine des versements. Pour mieux comprendre, le régime fiscal du PER est présenté dans le tableau synthétique ci-dessous.
Mais dans le cas le plus courant où les versements individuels devraient être déduits des revenus imposables, la rente ou le capital seraient taxés. Sans surprise !
Fiscalité du Plan d’épargne retraite
| Fiscalité à l’entrée | Fiscalité à la sortie | ||
| Sortie en rente | Sortie en capital | ||
| Versements volontaires sur le PER individuel et collectif | Deux options s’offrent à l’épargnant : Option 1 : déduire les sommes versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu (dans les plafonds du Perp pour les salariés et ceux du Madelin pour les travailleurs non salariés) Option 2 : ne pas déduire les sommes versées au contrat | • Si l’option 1 a été choisie, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit(1)• Si l’option 2 a été choisie, les produits de la rente sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux(2) | • Si l’option 1 a été choisie, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %• Si l’option 2 a été choisie, seules les plus-values sont soumises au PFU |
| Épargne salariale versée sur le PER collectif | Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu | La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux(2) | Les capitaux sont exonérés d’impôt. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % |
| Versements obligatoires sur le PERO | Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu | La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit(1) | La sortie en capital n’est pas possible dans ce cas de figure |
(1) Le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit consiste à imposer ces dernières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement forfaitaire de 10 %.(2) Pour le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux, l’imposition ne s’effectue que sur une partie de la rente. Cette partie est variable selon l’âge du bénéficiaire de la rente au moment du 1er versement. À la date du 1er versement, la fraction imposable est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans.
Profitez d’une rente défiscalisée avec un PEA
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le plan d’épargne en actions autorise la sortie de capitaux en rente viagère. Une sortie qui s’effectue dans un cadre fiscal très avantageux.
Vous souhaitez vous assurer des revenus complémentaires lors de votre départ à la retraite ? Sachez que le Plan d’épargne en actions (PEA) peut vous faire profiter d’une sortie en rente viagère dans un cadre fiscal très avantageux. Explications.
Comment sortir en rente viagère ?
Comme beaucoup de produits d’épargne, le plan d’épargne en actions autorise la sortie des capitaux en rente viagère. Pour ce faire, l’épargnant doit s’adresser à son établissement financier pour convertir son capital. Mais attention, seuls peuvent être convertis les capitaux issus d’un PEA assurance de plus de 8 ans.
Sachant que si l’épargnant dispose d’un PEA bancaire, il peut le faire convertir en PEA assurance auprès d’un assureur sans que cette conversion entraîne la perte de l’antériorité fiscale. En effet, c’est la date de souscription du PEA qui est retenue pour déterminer le régime fiscal applicable.
À l’instar de l’assurance-vie, le montant de la rente viagère est alors déterminé notamment en fonction de l’importance des capitaux convertis et de l’espérance de vie du titulaire du PEA.
À noter :
les compagnies d’assurances peuvent pratiquer des frais de service des rentes (prélevés lors de la conversion du capital en rente) et/ou des frais prélevés sur chaque rente versée.
Une fiscalité attractive
La sortie en rente viagère d’un PEA assurance bénéficie d’un régime fiscal très attractif. En effet, lorsqu’une rente viagère est servie au moins 8 ans après l’ouverture du PEA, elle est exonérée d’impôt sur le revenu. Elle ne supporte que les prélèvements sociaux (17,2 %) sur une fraction de son montant calculée en fonction de l’âge de l’épargnant au moment où il demande le versement de la rente pour la première fois. Cette fraction étant de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, de 50 % entre 50 et 59 ans, de 40 % entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans.
En revanche, lorsque la sortie en rente viagère a lieu avant 8 ans, les versements sont soumis à l’impôt sur le revenu et supportent les prélèvements sociaux. Là aussi, l’imposition s’applique sur une fraction seulement du montant, déterminée forfaitairement selon l’âge de l’épargnant.
À noter :
dans le cadre d’un plan d’épargne en actions, lorsque l’épargnant a souscrit une option de réversion de la rente en faveur de son conjoint en cas de décès, l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficie également à ce dernier.
Les avantages de la rente
La sortie en rente d’un PEA présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre à l’épargnant une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité car les rentes sont versées par l’assureur jusqu’au décès de l’épargnant, et ce même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.
Transmettre un bien via un don manuel
Comment gratifier un membre de sa famille sans avoir de formalités à accomplir.
Le don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Ce mode de transmission ne nécessite pas de formalité particulière (même si les conseils d’un notaire sont les bienvenus). Pour autant, certaines règles simples doivent être respectées. Voici une présentation de ce qu’il faut savoir en la matière.
Les conditions de validité d’un don manuel
Un don manuel peut porter sur différents types de biens mobiliers : une somme d’argent, un objet, une voiture, un portefeuille de valeurs mobilières, etc.
Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur (celui qui donne), de son vivant, au profit du donataire (celui qui reçoit). Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.
La fiscalité du don manuel
La déclaration du don manuel auprès de l’administration fiscale n’est pas obligatoire. Lorsqu’il n’est pas déclaré, le don manuel n’est évidemment pas taxable. Mais il le devient lors de son éventuelle révélation à l’administration fiscale (spontanément par le donataire ou suite à une demande ou à une procédure contentieuse de l’administration). En outre, lors de la succession du donateur, les sommes versées sont, en principe, rapportées à sa succession et donc taxées, le cas échéant.
Lorsqu’il est déclaré par le donataire, le don manuel donne lieu au paiement de droits de donation et ouvre droit aux abattements applicables aux donations. Ainsi, par exemple, les dons consentis au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont exonérés de droits de donation à hauteur, respectivement, de 100 000 €, de 31 865 € et de 5 310 € par donataire. Et lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, un abattement supplémentaire de 31 865 € est accordé.
L’intérêt d’un écrit
L’absence de formalité obligatoire signifie qu’il n’y a pas besoin de rédiger un acte. Dans les faits, cependant, il peut être judicieux d’établir un acte sous seing privé entre les parties, voire un acte dressé devant notaire, qui précise la façon dont le don est effectué. Et ce, dans le but d’éviter toute contestation dans le cadre d’un héritage (même si le donataire est présumé propriétaire du bien donné, il aura une preuve écrite de l’existence de ce don) ou de pouvoir se justifier aux yeux de l’administration fiscale.
À noter :
un don consenti dans le cadre d’un événement particulier (mariage, anniversaire, obtention d’un diplôme…) et dont la valeur est modique au regard de la situation financière du donateur n’est pas considéré comme une donation mais comme un présent d’usage. Principal avantage de ce dernier, il n’est pas soumis aux droits de donation.
La sortie d’une assurance-vie en rente viagère
Plutôt qu’un capital, le souscripteur d’une assurance-vie peut choisir de percevoir une rente viagère.
À l’échéance d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis (les sommes versées et les intérêts capitalisés) ou d’opter pour une sortie en rente viagère. Une option encore méconnue. Présentation.
Une rente viagère ?
Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer », avec le concours de son assureur, son capital en un revenu régulier qui lui sera versé jusqu’à son décès. Étant précisé qu’une fois la sortie en rente actée, il n’est plus possible de faire marche arrière et de récupérer tout ou partie de son capital.
La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (le bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.
À noter :
l’assurance-vie n’est pas le seul produit d’épargne autorisant une sortie en rente viagère. Certains autres placements proposent, à titre facultatif ou obligatoire, cette modalité de versement. C’est le cas, par exemple, du plan d’épargne retraite populaire (Perp), du contrat retraite Madelin, du Perco ou encore du plan d’épargne en actions.
Le calcul de la rente
Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital abrité par le contrat. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital un taux de conversion qui est défini en fonction de l’âge et de l’espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité de l’Insee) de l’épargnant au moment de l’entrée en jouissance de la rente. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ». Sachant que ce montant peut varier en fonction d’options qu’il est possible de souscrire (réversion au conjoint, annuités garanties, taux technique…).
Précision :
la réversion est une option permettant de désigner un bénéficiaire qui percevra la rente de l’assuré en cas de décès. Les annuités garanties sont une option de rente par laquelle l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier. Enfin, le taux technique est un taux qui permet de choisir le niveau de sa rente de départ et son niveau de revalorisation.
Des options qui peuvent se révéler utiles notamment lorsque le décès de l’assuré survient prématurément et que le montant de la rente qui a été servi par l’assureur est inférieur au capital « abandonné ». Par exemple, en cas d’option pour des « annuités garanties », l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier.
La fiscalité de la rente
Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement selon l’âge de l’assuré lors du premier versement de la rente, est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Une fois déterminée, cette fraction imposable ne varie pas avec l’âge du crédirentier.
L’assurance-vie, un bon placement ?
L’assurance-vie reste un outil incontournable pour valoriser son épargne et s’assurer un complément de revenus durant sa retraite. Le cadre juridique de ce contrat permet, en outre, à son souscripteur d’organiser la transmission de son patrimoine dans les meilleures conditions.
Une épargne disponible à tout moment
Le souscripteur d’une assurance-vie peut effectuer des rachats à tout moment
L’assurance-vie est un produit d’épargne très souple. En effet, les capitaux sont disponibles à tout moment. Pour récupérer en partie ou en totalité son épargne, le souscripteur peut réaliser ce que l’on appelle un « rachat ». Lorsque ce rachat concerne la totalité des sommes épargnées, le contrat est de facto clôturé. A contrario, lorsqu’il n’est que partiel, le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits. Quant aux versements, ils peuvent, en principe, être effectués librement par le souscripteur. Ce dernier pouvant ainsi alimenter son contrat sans contrainte de montant.
Précision :
plutôt que de puiser dans son épargne en cas de besoin, le souscripteur a la possibilité de demander une avance à son assureur. L’avance permet de disposer, pour une durée déterminée, d’une certaine somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. En contrepartie, un intérêt, dont le taux est défini chaque année, est dû à l’assureur.
Une diversité de placements importante
L’épargne accumulée sur une assurance-vie peut être investie dans différents types de supports (actions, obligations, immobilier…)
En souscrivant un contrat d’assurance-vie multisupports, le souscripteur a accès à un large panel d’investissements. Il peut ainsi détenir sur son contrat des fonds en euros, c’est-à-dire des fonds peu risqués composés à 80 % d’obligations et garantis par l’assureur. Inconvénient : ces fonds sont de moins en moins rémunérateurs, à cause notamment de la chute des taux obligataires constatée ces dernières années.
Aussi, pour tenter de doper le rendement de son contrat d’assurance-vie, une stratégie consiste à faire appel aux unités de compte. Concrètement, les unités de compte représentent une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, pierre papier...).
Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Attention donc, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Aussi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut diminuer.
C’est la raison pour laquelle ces actifs s’adressent aux épargnants qui ont conscience du risque qu’ils courent en les souscrivant et de la longue durée pendant laquelle il faudra les détenir pour lisser la performance dans le temps et ainsi diluer le risque de perte.
À noter :
si l’épargnant détient un « vieux » contrat ne permettant pas d’accueillir des unités de compte, il dispose de la faculté de le transformer en une assurance-vie multisupports. Avantage : cette procédure gratuite permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.
Une fiscalité avantageuse
(1) Prélèvement forfaitaire libératoire. (2) Impôt sur le revenu. (3) Prélèvements sociaux. (4) Personne seule. (5) Couple.
La pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie diminue avec la durée de détention.
Les produits (gains) des contrats d’assurance-vie sont taxés, non pas pendant la durée du contrat, mais lors du rachat partiel ou total. Ces gains bénéficient d’une fiscalité dégressive permettant une optimisation du contrat après 8 années de détention.
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie. Étant précisé que deux régimes fiscaux cohabitent et s’appliquent sur les gains en fonction de la date des versements effectués par l’épargnant sur son contrat.
Fiscalité de l’assurance-vie
| Durée de détention | 0 à 4 ans | 4 à 8 ans | 8 ans et plus | |
| Fiscalité des produits issus des versements effectués avant le 27/09/2017 | 35 % (1) ou IR (2) + PS (3) | 15 % (1) ou IR (2) + PS (3) | 7,5 % (1) ou IR (2) + PS (3) | Abattement annuel de 4 600 € (4) ou 9 200 € (5) avec une application en priorité sur les primes versées avant le 27/09/2017 |
| Fiscalité des produits issus des versements effectués à compter du 27/09/2017 | 12,8 % + PS (3) | Primes versées et non rachetées < 150 000 € | 7,5 % + PS (3) | |
| Primes versées et non rachetées > 150 000 € | 12,8 % + PS (3) | |||
| Le prélèvement forfaitaire non libératoire (de 12,8 % ou 7,5 % en fonction des conditions de durée) sera retenu par l’assureur lors du rachat. L’option au barème de l’IR sera possible mais uniquement au moment de la déclaration de revenus. |
Sur option, le souscripteur peut préférer l’application du barème de l’impôt sur le revenu plutôt que le prélèvement forfaitaire unique. À cette taxation progressive s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux annuel de 17,2 %. Ces derniers sont acquittés sur les produits générés (par les unités de compte) par le contrat soit lors d’un rachat, soit lors du dénouement du contrat par l’arrivée du terme ou le décès du souscripteur. Particularité : pour les produits générés par les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont acquittés chaque année à l’inscription des gains sur le contrat.
Un outil de transmission simple et efficace
L’assurance-vie constitue également un moyen intéressant de transmettre un capital à moindre coût fiscal.
Des bénéficiaires librement désignés
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la possibilité de désigner, dans une clause dite « bénéficiaire », une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de sa famille, qui sont appelées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent qu’il a ainsi épargnées.
Mais attention, la désignation des bénéficiaires doit être clairement énoncée pour éviter une identification difficile voire impossible par l’assureur, et, par voie de conséquence, la réintégration du capital dans la succession du défunt et sa taxation selon les règles de droit commun. Il est donc conseillé de donner un maximum d’informations sur le(s) bénéficiaire(s) : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, etc.
Précision :
le souscripteur d’une assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Sauf en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, validée par le souscripteur. Dans ce cas, il faut obligatoirement obtenir son accord pour pouvoir procéder à cette modification.
Des sommes exonérées de droits de succession
Au décès de l’assuré, les sommes sont versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie hors succession et bénéficient, en conséquence, d’un régime fiscal particulièrement favorable. En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé, lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est exonéré de toute taxation.
Quant aux autres bénéficiaires, un abattement de 152 500 € leur est appliqué, quel que soit leur lien de parenté avec le souscripteur, pour les primes versées par l’assuré sur le contrat avant ses 70 ans. La fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 € est imposée à 31,25 %.
Pour les versements effectués après 70 ans, l’assurance-vie est moins avantageuse mais n’est toutefois pas dénuée d’intérêt. Ainsi, les bénéficiaires profitent encore d’un abattement de 30 500 € sur les sommes reçues. Un abattement que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession.
Zoom sur le crédit d’impôt transition énergétique
Vous bénéficiez d’un avantage fiscal pour les travaux de rénovation énergétique de votre logement.
Les conditions d’application
Des conditions tenant au logement et à la nature des travaux doivent être respectées.
Le crédit d’impôt sur le revenu, appelé « crédit d’impôt pour la transition énergétique » (Cite), a été mis en place pour encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique des logements. Un avantage fiscal qui a été modifié au gré des lois de finances, y compris en toute fin d’année dernière. L’occasion de faire le point sur ce dispositif.
Pour en bénéficier, le logement faisant l’objet des travaux, situé en France, doit constituer votre habitation principale et être achevé depuis plus de 2 ans. En revanche, peu importe que vous en soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit.
Et seules les dépenses d’isolation du logement ou d’économies d’énergie prévues par la loi sont éligibles. Parmi elles, figurent, notamment, la dépose d’une cuve à fioul, les chaudières au gaz à très haute performance énergétique, les fenêtres en double vitrage venant en remplacement de simple vitrage, l’isolation thermique des parois opaques (planchers, murs...), les pompes à chaleur autres que air/air ou encore le système de charge pour véhicule électrique. Étant précisé que certaines dépenses sont plafonnées et/ou soumises à des conditions de ressources.
En pratique :
les équipements, matériaux et appareils doivent normalement être fournis et installés par une même entreprise.
Pour être éligible au Cite, la plupart des travaux doivent être réalisés par des professionnels certifiés « RGE » (reconnu garant de l’environnement). Des professionnels qui doivent effectuer, avant l’établissement du devis, une visite du logement afin de valider l’adéquation des équipements, matériaux ou appareils au logement. La date de la visite devant figurer sur la facture. Pour trouver un professionnel qualifié RGE, vous pouvez consulter l’annuaire disponible sur le site www.faire.fr/trouvez-un-professionnel.
Le montant
Le taux du Cite est variable dépend de la nature des dépenses engagées.
Pour calculer le crédit d’impôt auquel vous pouvez prétendre, il suffit d’appliquer un taux au montant des dépenses payées, qui s’élève à :
- 15 % pour les fenêtres ;
- 50 % pour la dépose d’une cuve à fioul ;
- 30 % pour les autres dépenses.
Toutefois, le montant des dépenses prises en compte ne peut excéder 8 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé et 16 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune, majoré de 400 € par personne à charge. Un plafond qui s’apprécie, pour un même logement, sur 5 années consécutives.
À savoir :
le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019.
Les travaux doivent être déclarés l’année suivant celle de leur paiement, en même temps que vos revenus. L’avantage fiscal vient alors en déduction de votre impôt, l’excédent vous étant restitué. Sachez que vous êtes dispensé de joindre la facture à votre déclaration mais que vous devez la conserver pour le cas où l’administration vous la demanderait. Ainsi, les dépenses payées en 2019 devront être déclarées au printemps 2020 et donneront lieu, le cas échéant, au versement du Cite à l’été 2020. Cet avantage fiscal n’étant pas concerné par l’acompte versé en janvier pour certains crédits et réductions d’impôt (garde d’enfants, dons…). À noter que le Cite est soumis au plafonnement global des niches fiscales fixé, en principe, à 10 000 €.
Précision :
le Cite est cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro.
Tableau récapitulatif
Voici la liste des principales dépenses éligibles et le taux qui leur est applicable pour 2019.
La liste des principales dépenses d’équipements, matériaux, appareils et travaux de pose éligibles et le taux qui leur est applicable pour 2019 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.
Crédit d’impôt transition énergétique
| Nature de la dépense | Taux applicable aux dépenses payées en 2019 |
| Dépose d’une cuve à fioul | 50 % |
| Chaudières au gaz à très haute performance énergétique | 30 %* |
| Chaudières à micro cogénération (puissance de production électrique ≤ 3 kilovolt-ampères/logement) | 30 %* |
| Équipements de chauffage au bois ou autres biomasses** | 30 % |
| Appareils de régulation de chauffage ou matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | 30 % |
| Appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire | 30 % |
| Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans les copropriétés | 30 % |
| Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages | 15 %* |
| Isolation thermique des parois opaques (application d’un plafond par m²) | 30 % |
| Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (sauf panneaux photovoltaïques et éoliennes produisant de l’électricité)** | 30 % |
| Pompe à chaleur (autre qu’air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire** | 30 % |
| Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique | 30 % |
| Acquisition de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de la biomasse** | 30 % |
| Diagnostic de performance énergétique non obligatoire (un diagnostic/logement/5 ans) | 30 % |
| Système de charge pour véhicule électrique | 30 % |
* en principe, application d’un plafond de dépenses.** y compris les dépenses de pose, sous conditions de ressources.
Zoom sur le dispositif de « mobilité bancaire »
Un dispositif qui permet de changer facilement d’établissement bancaire.
Manque de temps, peur de devoir faire face à des démarches interminables, complexité… des arguments souvent avancés par les consommateurs lorsque l’on évoque la possibilité de changer de banque. Pourtant, la « loi Macron » du 6 août 2015 a mis en place un dispositif censé faciliter le changement de banque. Présentation.
Mandater la nouvelle banque
Après avoir choisi sa nouvelle banque et ouvert un compte, le client doit se voir proposer le service d’aide à la mobilité. Ce service, gratuit, consiste, pour ce dernier, à donner mandat à sa nouvelle banque de réaliser pour lui (dans un délai de 12 jours ouvrés) les opérations nécessaires au changement de domiciliation bancaire. Concrètement, le client indique, dans le mandat, les opérations qu’il autorise. Il peut s’agir, par exemple, de l’annulation ou du transfert de tous les ordres de virement récurrent enregistrés sur son compte d’origine, de l’information de ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs des virements récurrents (mutuelle, organismes de protection sociale…) ou encore de la clôture du compte qu’il détient dans la banque de départ.
Précision :
l’établissement bancaire de départ doit informer son ancien client, durant un délai de 13 mois suivant la clôture du compte, des prélèvements ou des virements ainsi que des présentations de chèques qui ont lieu sur le compte clos. Et en cas de présentation d’un chèque, la banque a l’obligation de refuser son paiement.
Un dispositif peu utilisé
Aussi pratique soit-il, ce dispositif n’a pas dopé la mobilité bancaire. À en croire les dernières estimations, seuls 4 à 5 % des Français changeraient de banque chaque année, contre 10 % dans le reste de l’Europe. À ce titre, un sondage réalisé l’an dernier par OpinionWay, à la demande du Comité consultatif du secteur financier, nous apprend que 7 Français sur 10 connaissent ce service et que 80 % de ceux qui ont changé de banque l’an dernier ont souhaité en bénéficier. Toutefois, si 17 % des Français ont envisagé de changer de banque, nombre d’entre eux y ont renoncé, notamment pour conserver leur taux d’intérêt sur un emprunt immobilier en cours ou en raison des frais engendrés par le transfert de certains produits financiers.
Lexique :
un virement récurrent correspond à toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des 13 derniers mois précédant la demande de mobilité du client.
Transmettre son patrimoine par donation-partage
La donation-partage consiste à transmettre ses biens à ses enfants de son vivant.
Moins connue que le testament ou la donation « classique », la donation-partage n’en constitue pas moins un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Présentation.
Une transmission de son vivant...
La donation-partage est l’acte par lequel une personne donne et partage, de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses enfants ou de ses petits-enfants. En l’absence d’enfants, elle peut même être réalisée en faveur des collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes...). Procédant, comme son nom l’indique, à la fois de la donation et du partage, la donation-partage permet ainsi d’anticiper le règlement de sa propre succession. Avantage de taille, elle n’est jamais rapportable à la succession du donateur, ce qui signifie que le montant donné n’aura pas à être ajouté à la succession pour déterminer la part d’héritage qui revient à chaque enfant.
De plus, pour vérifier, au décès du donateur, que chaque enfant a bien reçu la part minimale que la loi lui réserve, les biens partagés seront en principe évalués au jour de la donation-partage, et non au jour du décès comme pour une donation ordinaire.
... À tous ses enfants...
La donation-partage peut porter sur tous les biens du donateur ou sur une partie seulement. Et tout type de biens dont le donateur est propriétaire au jour de la donation-partage peut être transmis (argent, meubles, biens immobiliers, titres de sociétés…).
Des biens qui peuvent être transmis par donation-partage à au moins deux enfants (s’il n’y en a qu’un, il n’y a rien à partager !). Sachant que la participation de tous les enfants n’est pas exigée pour la validité de l’opération. Même si, en pratique, il est préférable que tous les enfants du donateur y participent et que les attributions de chacun soient équivalentes, si ce n’est strictement égalitaires.
Et s’il n’est pas possible de former des lots équilibrés, il convient de prévoir une soulte : par ce biais, celui qui a reçu plus que les autres les indemnise en leur versant une somme d’argent.
... Qui peut être réitérée
Dans sa vie, une personne peut consentir plusieurs donations-partages à un moindre coût fiscal. En effet, la loi (règle dite du « non-rappel fiscal des donations passées ») permet, par exemple, de donner, en franchise de droits de donation, 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans.
Dernier point, une donation-partage se réalise nécessairement par acte notarié.
À noter :
un père et une mère peuvent consentir ensemble une seule et même donation-partage au profit de leurs enfants, à condition d’être mariés. On parle alors de donation-partage conjonctive. Avantage de cette dernière : sa souplesse. Elle peut porter à la fois sur des biens communs et sur des biens propres à chacun des époux, sans considération de leur origine.
Comment doper son épargne avec les fonds thématiques
Les fonds thématiques peuvent constituer une solution intéressante pour contrer l’effet de la baisse des rendements des fonds en euros.
Les fonds thématiques sont de plus en plus mis en avant par les sociétés de gestion et les établissements financiers. En effet, dans le contexte actuel, cette forme d’investissement peut constituer un bon moyen de diversifier son portefeuille et de profiter de leviers de performance. Présentation.
Un fonds thématique, c’est quoi ?
Un fonds thématique est un fonds qui investit, sur le long terme, le fruit de sa collecte dans une « mégatendance ». Il peut s’agir, par exemple, du secteur de la santé, de la robotique, du changement climatique, de la mobilité et des transports ou encore de la transition énergétique. Concrètement, la viabilité d’un fonds thématique repose sur l’identification d’une tendance émergente. Pour qu’elle soit considérée comme telle, elle doit généralement posséder trois caractéristiques :- avoir des impacts forts sur l’économie ;- offrir des applications aux entreprises ;- disposer au minimum d’une durée de vie de 10 à 15 ans.
La sélection des valeurs
En pratique, dans un fonds thématique, le gérant va tenter d’identifier les « phénomènes » porteurs de croissance, puis de sélectionner, dans ces univers, les valeurs boursières qui seront le plus susceptibles de générer une performance pérenne. Sachant que les fonds thématiques sont construits de façon très transversale afin de mieux traverser les différents cycles économiques et d’être affectés le moins possible par les inévitables soubresauts des marchés financiers.
Pour la sélection des valeurs, le gérant procède comme pour un fonds traditionnel. Il évalue la valeur des sociétés en analysant leurs données, comme les bénéfices ou le chiffre d’affaires. Il utilise également des ratios financiers spécifiques (le bénéfice par action, la capitalisation boursière, le price earning ratio, le rendement boursier...) permettant d’évaluer rapidement la valeur et le potentiel d’une action, en prenant en compte l’étendue du prix du titre et une mesure de performance.Comment investir ?Les fonds thématiques ne sont pas l’apanage des professionnels de la finance. Les particuliers peuvent, eux aussi, acquérir des parts de ces supports d’investissement. Des supports d’investissement qu’il est possible de loger dans un compte-titres ordinaire, un plan d’éparge en actions ou encore un contrat d’assurance-vie multisupport via des unités de compte.
Quelle performance ?
Se positionner sur un courant porteur n’est pas forcément un gage de réussite ni une manière de se protéger contre la volatilité des marchés financiers. Globalement, les fonds thématiques sans quand même plus risqués que les actifs habituels (monétaires, obligations...). Mais, en contrepartie, ils offrent des performances pouvant dépasser les 10 % pour les meilleurs (performances annualisées sur 3 ans).
Investir dans une résidence service en « seconde main »
Il est possible d’acquérir un bien en résidence service sur le marché secondaire.
Investir dans une résidence service (logement pour étudiants, touristes ou personnes âgées) est souvent proposé aux épargnants qui souhaitent se constituer des revenus complémentaires. Généralement, ce type d’investissement concerne des logements vendus neufs. Pourtant, depuis quelques années, un marché secondaire se développe.
Les atouts du marché secondaire
Acquérir un bien immobilier de « seconde main » présente certains avantages. D’une part, le prix d’acquisition est moins élevé (décote de 20 à 30 %) que celui d’un bien acquis sur plan. Ce qui procure, à loyers constants, une rentabilité accrue par rapport au neuf. D’autre part, étant donné que la résidence service fait déjà l’objet d’une exploitation, l’investisseur va pouvoir percevoir des revenus dès l’acquisition. Sans compter que ce type d’investissement immobilier permet de bénéficier d’un statut fiscal avantageux.
Mais attention, tous les biens et exploitants de ces résidences ne se valent pas. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de se faire accompagner par des professionnels connaissant ce marché très particulier. Ces derniers analyseront notamment la qualité du bien immobilier et le sérieux de l’exploitant de la résidence, la viabilité économique du montage, la localisation, le taux de remplissage, le nombre d’incidents de paiement et les termes du bail commercial.
Le statut de LMNP
Acquérir un logement dans une résidence service place l’investisseur sous le statut fiscal de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Ce statut lui permet notamment d’imputer les déficits d’exploitation sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qu’il réalise au cours de la même année et des 10 années suivantes.
En plus, le statut de LMNP rend possible l’amortissement du bien immobilier. Le but étant de pouvoir déduire du résultat de chaque année, mais dans certaines limites, une annuité d’amortissement équivalant à la dépréciation théorique de l’immeuble. Ce régime permet aussi de déduire certaines charges pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, frais de gestion…).
Précision importante, en investissant dans un bien de seconde main, le loueur en meublé non professionnel ne peut pas bénéficier du dispositif de défiscalisation Censi-Bouvard. En effet, ce dernier s’applique uniquement aux investissements dans le neuf. Rappelons que le Censi-Bouvard permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, répartie sur 9 ans, dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements).
Attention :
les loueurs en meublé non professionnels imposables selon le régime micro-BIC (recettes inférieures à 70 000 €) ne peuvent ni constater un déficit ni déduire d’amortissement ou de charges. Leur revenu imposable est déterminé par application aux recettes d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 %.
Les rendements 2018 des assurances-vie en euros
Les fonds en euros ont vu leur rendement diminuer en 2018.
Comme chaque année à la même époque, les banques et les assureurs ont annoncé les performances de leurs fonds en euros pour l’année passée. Et sans surprise, les résultats sont en berne puisque le taux moyen du rendement des fonds en euros, tous types de contrats confondus, est tombé à 1,6 % en 2018 (1,8 % en 2017). Une baisse qui s’explique par la faiblesse des taux des obligations, lesquelles représentent l’essentiel des actifs des fonds en euros.
Une collecte record
Selon la Fédération française de l’assurance, malgré une baisse des rendements, l’assurance-vie s’en est bien sortie en 2018 puisque la collecte nette (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 22,4 milliards d’euros, soit 8,3 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Une performance réalisée en dépit d’un mois de décembre en repli (- 0,6 milliard d’euros).
Le montant total des cotisations collectées en 2018 s’est élevé à 140,1 milliards d’euros (134,6 milliards en 2017), ce qui constitue la troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006. Quant à l’encours des contrats d’assurance-vie, il a atteint 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018 (+ 1 % sur un an)
Les rendements 2018 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
| Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
| 2018 | 2017 | ||
| Afer | Compte Afer | 2,25 % | 2,40 % |
| Agipi / Axa | Cler | 2,10 % | 2,10 % |
| Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,70 % | 1,90 % |
| Allianz Vie | Gaipare | 2,50 % | 2,65 % |
| Asac-Fapès | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,48 % | 2,58 % |
| Axa | Figures Libres | 1,90 % à 2,25 % | 1,90 % à 2,25 % |
| BforBank | BforBank Vie | 2,10 % | 2,15 % |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,56 % | 1,82 % |
| Boursorama.com | Boursorama Vie | 2,31 % | 2,10 % |
| Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,90 % | 1,75 % |
| CNP / La Banque Postale | Cachemire 2 | 1,90 % à 2,09 % | 1,85 % à 1,97 % |
| Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 Série 2 | 1,25 % | 1,20 % |
| Generali Vie | Xaélidia | 2,45 % | 2,59 % |
| GMF Vie | Multéo | 2,10 % | 2,10 % |
| ING | ING Vie | 2,25 % | 2,10 % |
| LCL | LCL Vie | 1,75 % | - |
| Le Conservateur | Helios Sélection | 2,27 % | 2,45 % |
| MACIF | Mutavie Actiplus | 1,90 % | 1,80 % |
| MAAF VIE | Winalto | 1,85 % | 1,85 % |
| MACSF | RES Multisupport | 2,20 % | 2,45 % |
| MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 2,35 % | 2,50 % |
| MMA Vie | Multisupports | 1,51 % à 2,01 % | 1,51 % à 2,01 % |
| Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 1,65 % | 1,77 % |
| Mutavie | ActiPlus | 1,90 % | 1,80 % |
| Natixis Assurances | Horizéo | 1,25 % à 1,60 % | 1,15 % à 1,50 % |
| Nortia | Canopla | 1,75 % | 1,90 % |
| Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 1,80 % | 2,05 % |
| SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,24 % | 2,26 % |
| Société Générale / Sogecap | Séquoia | 1,33 % à 1,78 % | 1,33 % à 1,81 % |
| Spirica | Private Vie | 1,60 % | 1,70 % |
| Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 2 % | 2 % |
| Swiss Life | Liberté | 1,50 % à 2,50 % | 1,80 % à 2,60 % |
| UAF Life Patrimoine | Arborescence Opportunités | 2,90 % | 3 % |
Lorsqu’un généalogiste vous contacte...
Zoom sur le rôle d’un généalogiste lors d’une ouverture de succession.
Dans le cadre d’une succession, le notaire peut avoir à rechercher les héritiers du défunt. Une tâche qui, pour de nombreuses raisons (absence d’héritiers connus, rupture des liens entre les familles…), peut se révéler compliquée. Lorsque ses recherches n’aboutissent pas, il peut faire appel à un généalogiste.
L’intervention d’un généalogiste
Après avoir été mandaté par un notaire, le généalogiste a pour mission soit d’identifier d’éventuels héritiers dont l’existence n’est pas connue, soit de localiser des héritiers déjà recensés. Pour ce faire, il va entreprendre une véritable enquête et récolter des informations en consultant les registres d’état civil, les listes électorales, les recensements et les archives ou en recueillant des témoignages.
Lorsque les héritiers sont identifiés, le généalogiste entre en contact avec eux et leur demande de signer un contrat de révélation. Ce contrat stipule que le bénéficiaire de la succession s’engage à supporter le coût de la prestation du généalogiste. Une fois la prestation réglée, ce dernier révèle alors l’identité du défunt.
Le coût de la prestation
En contrepartie de la révélation, l’héritier doit rémunérer le généalogiste. Cette rémunération correspond à un pourcentage (40 % le plus souvent) appliqué sur la part nette d’héritage recueillie par l’héritier retrouvé, c’est-à-dire après paiement des droits de succession et de tous les frais afférents à la liquidation de celle-ci. Étant précisé que ce pourcentage, fixé librement par le généalogiste, varie notamment selon le degré de parenté entre l’héritier et le défunt, le montant de l’actif et les frais liés aux recherches. Si la « facture » du généalogiste vous semble élevée au regard des prestations fournies, vous pouvez tenter de négocier le pourcentage demandé. Lorsque la négociation échoue, vous avez alors la possibilité de saisir le juge pour obtenir une réduction du prix.
Vous êtes également en droit de faire annuler le contrat de révélation si le travail du généalogiste a été inexistant ou si son intervention n’était pas nécessaire pour que l’ouverture de la succession du défunt soit portée à votre connaissance.
Gare aux aranaques !
Suite à des tentatives régulières d’escroquerie, le groupement professionnel Généalogistes de France appelle les particuliers à la plus grande vigilance. Il rappelle qu’un généalogiste, intervenant sur mandat d’un notaire, ne demande jamais d’honoraires sous forme d’avance dans le cadre d’un contrat de révélation de succession.
En cas de doute sur la sincérité d’une demande d’un généalogiste, il encourage les particuliers à vérifier si celui-ci est membre d’un syndicat affilié ou titulaire d’une carte professionnelle ou bien à contacter le notaire chargé du règlement de la succession.
À noter :
répartis dans 150 cabinets (comprenant 1 000 collaborateurs), les généalogistes successoraux professionnels identifient, sur 500 000 décès recensés chaque année, pas moins de 150 000 héritiers et leur restituent 1 milliard d’euros.
Fonds en euros : de quoi sont-ils composés ?
Pour assurer la garantie en capital des fonds en euros, les assureurs ont leur recette !
Les Français ont fait de l’assurance-vie en euros l’un de leurs placements préférés. Et pour cause, cette formule convient aux épargnants dont l’aversion au risque est importante puisque les sommes placées sont garanties par les assureurs. Mais comment ces derniers composent-ils ces fonds avec les primes versées par les assurés ? Éléments de réponse.
Un fonds d’investissement composite…
Pour assurer cette garantie accordée sur le capital investi, les fonds en euros sont composés à 80 % d’obligations conservées jusqu’à leur remboursement. Des titres de créance peu risqués, émis par des entreprises ou des États, qui procurent des intérêts stables et réguliers. Le pourcentage restant est globalement investi, d’une part, dans des actions, afin de tenter de capter une partie des performances dégagées par les marchés financiers et, d’autre part, dans des actifs monétaires et immobiliers. Sachant que chaque assureur est libre de concocter sa « propre recette » à l’aide de ces différents supports.
… qui est amené à évoluer
Conscients que les rendements des obligations ne sont plus aussi dynamiques qu’auparavant, les assureurs commercialisent, depuis plusieurs années maintenant, de nouveaux types de fonds en euros à capital garanti.
Ainsi, on trouve notamment :
- les fonds en euros immobiliers. Des fonds principalement investis dans des immeubles de bureaux ou abritant des commerces. Leur potentiel de rendement est meilleur grâce à la sécurité des loyers et à leur indexation sur l’inflation ;
- les fonds euro-dynamiques. Ils disposent d’une poche plus importante investie en actions. Celle-ci pouvant, en pratique, représenter près de 30 % des sommes versées. Particularité de ces fonds, les actifs risqués peuvent être progressivement renforcés en cas de hausse des marchés ou désinvestis dans le cas contraire.
Une nouvelle génération de fonds en euros
De nouveaux fonds en euros, les fonds euro-croissance, ont été lancés en 2014. Ils ont pour vocation de réaffecter une partie de l’épargne de l’assurance-vie dans des compartiments ciblés comme les placements en actions. L’une de leurs caractéristiques étant qu’ils octroient une garantie du capital investi à l’issue d’une période de 8 ans (et non plus à tout moment comme pour les fonds en euros classiques). Cette garantie différée permet à l’assureur de gérer les actifs de façon plus performante grâce à un horizon de placement plus long. Et pour le souscripteur, l’espérance de rentabilité est accrue par rapport à celle d’un fonds en euros traditionnel.
À noter :
bien que faisant appel aux mêmes supports d’investissement, les fonds en euros des contrats d’assurance-vie ne sont pas tous similaires. Les différentes allocations d’actifs proposées peuvent donc être un critère de sélection de votre contrat.
Les aides aux travaux de rénovation énergétique
Un coup de pouce peut être donné aux propriétaires qui rénovent leur logement.
Vous souhaitez faire baisser le montant de la facture énergétique de votre résidence principale ou de votre investissement locatif ? Sachez que vous pouvez bénéficier d’aides publiques pour réaliser des travaux. Zoom sur les plus importantes d’entre elles.
Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
Les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour certains travaux d’amélioration de la qualité environnementale réalisés dans leur résidence principale, lorsqu’elle est située en France et achevée depuis plus de 2 ans. Ces dépenses doivent notamment être engagées pour l’acquisition de certains équipements (chaudières, pompes à chaleur…).
Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses payées au cours de l’année d’imposition.
À noter:
ces travaux de rénovation énergétique peuvent, sous conditions, être financés via un éco-prêt à taux zéro (jusqu’à 30 000 €).
Le programme « Habiter Mieux »
Autre dispositif : le programme « Habiter Mieux ». Une partie de ce programme consiste à allouer aux propriétaires-bailleurs une aide financière de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) lors de la réalisation de travaux d’économie d’énergie permettant au bien immobilier de gagner au moins 35 % de performance énergétique et d’être classé au minimum à D sur l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique (DPE).
En contrepartie, le propriétaire-bailleur doit signer une convention dans laquelle il s’engage à respecter des plafonds de loyers et de ressources des locataires pendant une durée de 9 ans.
L’aide « Habiter Mieux » réunit la subvention pour travaux de l’Anah, d’un montant de 25 % du coût des travaux, plafonnée à 750 €/ m² dans la limite de 60 000 € et de 80 m² au maximum par logement, et la prime Habiter Mieux de 1 500 € par logement.
Rappel :
le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cette échelle de valeur comporte 7 classes énergétiques, de A à G. La classe A correspondant à la meilleure performance énergétique et la classe G à la plus mauvaise.
Une exonération de taxe foncière
Les propriétaires de logements (achevés avant le 1er janvier 1989), occupants ou bailleurs, peuvent également bénéficier, pendant 5 ans, d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière lorsqu’ils ont réalisé un certain montant de travaux d’économie d’énergie éligibles au crédit d’impôt transition énergétique et que cette exonération a été votée par la commune dans laquelle est situé le logement. Une demande d’exonération qui doit être formulée auprès de l’administration fiscale.
Les banques en ligne ont le vent en poupe
Les banques en ligne gagnent du terrain grâce à des offres tarifaires agressives.
Dans un secteur en plein bouleversement, les grands établissements bancaires ont créé, ces dernières années, des structures totalement virtuelles qui proposent de nouvelles façons de consommer des services financiers. Mais ces banques en ligne présentent-elles suffisamment d’arguments pour inciter les consommateurs à y adhérer ?
Des produits et services comparables à ceux des banques classiques
Les banques en ligne n’ont rien à envier aux établissements dits « physiques ». En effet, elles proposent tous les services bancaires classiques : moyens de paiement (carte bancaire, chéquier...), virements, prélèvements, découverts, retraits d’espèces, oppositions sur prélèvement, etc.
À côté du compte courant, elles offrent également une large gamme de produits d’épargne : l’incontournable livret A et son complément le livret de développement durable, des assurances-vie, des PEA ainsi que des comptes-titres ordinaires.
Les banques en ligne peuvent également proposer des offres de crédits à la consommation et immobiliers. Des prêts dont les taux sont globalement proches de ceux des banques traditionnelles.
Point faible, certains établissements n’assurent pas le dépôt d’argent liquide. L’alimentation d’un compte bancaire ne pouvant alors se faire que par virements ou dépôts de chèques.
À noter :
dans son espace personnel, le client souscrit aux offres, pilote ses comptes et passe ses opérations seul. Mais en cas de difficultés, il peut toujours prendre contact avec un conseiller bancaire par courrier, téléphone, e-mail, webcam ou chat.
Des tarifs attractifs
L’un des arguments ayant permis aux banques en ligne de se faire une place sur le marché très convoité de la bancarisation des particuliers, c’est leur faible coût. Car globalement, pour les principales enseignes, les prestations de base sont fournies gratuitement. Pour le reste, la tarification reste comparable à celle pratiquée par les banques de réseau. Ainsi, par exemple, il est possible d’obtenir gratuitement une carte de paiement adossée à un compte courant. Mais attention, la gratuité ne s’applique que pour une utilisation « normale » et sans incident de paiement ou découvert ! Et pour les produits d’épargne (comme l’assurance-vie, le PEA et le compte-titre), aucun frais de gestion n’est pratiqué.
Un accès réservé
Les formules proposées par ces banques peuvent être tentantes. Mais pour en bénéficier, il peut être demandé au candidat, par exemple, un minimum de 1 200 € de revenus nets mensuels ou de 5 000 € d’épargne pour pouvoir ouvrir un compte courant et disposer d’une carte de paiement basique. Pour bénéficier d’une carte « Gold », les montants sont plus élevés. Cette fois-ci, il faudra justifier, par exemple, de 1 800 € de revenus nets ou de 10 000 € d’épargne. Ces seuils étant différents d’un établissement à un autre.
Quel régime fiscal pour votre SCI ?
Une société civile immobilière (SCI) est une forme de société qui a pour objet de permettre l’acquisition, la conservation et, en général, la location de biens immobiliers. Elle constitue un outil incontournable pour gérer un patrimoine immobilier. Toutefois, une interrogation se pose au moment de la création d’une telle société : celle du choix de l’option fiscale, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Les conséquences financières résultant de ce choix étant très différentes. Voici une présentation des principaux points appelant à la vigilance.
Choisir le régime fiscal de sa SCI
Les résultats d’une SCI sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu, sauf lorsque son activité est commerciale. Toutefois, à la création ou en cours de vie sociale, les associés d’une SCI peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.
Par défaut, la société civile immobilière relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dont les résultats sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu (IR). L’imposition étant réalisée, pour la totalité du résultat, entre les mains des associés, en fonction des droits qu’ils possèdent dans la société. Mais ce régime d’imposition n’est pas obligatoire. En effet, les associés peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option étant ouverte aussi bien à la création que pendant la vie de la SCI.
Précision :
en cours d’activité, l’option pour l’impôt sur les sociétés doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du 3e mois d’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.
Exceptionnellement, ce régime s’impose lorsque la société se met à exercer une activité commerciale, comme peut l’être la location meublée. Il faut savoir également qu’une fois exercée, l’option est irrévocable ! Il n’est alors plus possible de basculer de l’IS à l’IR.
Attention toutefois, opter pour l’IS pendant la vie de la SCI entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise et donne lieu, en principe, à une imposition immédiate du résultat non encore imposé, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes sur les éléments d’actif immobilisé.
À noter :
les SCI peuvent également bénéficier des avantages fiscaux issus de certains dispositifs d’investissement immobilier tels que la réduction d’impôt « Pinel ». Mais attention, pour cela, la SCI ne doit pas être soumise à l’IS. Un élément qui doit évidemment être pris en considération !
Les différences entre SCI soumise à l’IR ou à l’IS
Les règles d’imposition à l’IR et l’IS sont très différentes. Choisir le régime d’imposition doit se faire notamment en fonction des objectifs des associés.
Les revenus tirés de la location
Le traitement fiscal des revenus tirés de la location des biens immobiliers est radicalement différent selon que l’on se trouve dans une SCI soumise à l’IR ou à l’IS.
• Lorsque la SCI est soumise à l’IR, les associés voient leur quote-part de résultat imposée à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers, et ce même s’ils n’ont pas été effectivement appréhendés. Revenus soumis également aux prélèvements sociaux de 17,2 %.
Ce régime réel d’imposition s’applique, en principe, dès lors que les revenus bruts fonciers excèdent 15 000 €. Il permet notamment de déduire des loyers le montant des charges réelles (exemples : travaux de réparation et d’entretien, primes d’assurance, intérêts d’emprunt, etc.). Dans l’hypothèse où la SCI ne perçoit pas de revenus (par exemple, création pour la détention de la résidence de ses associés), il n’est pas possible ni pour la société, ni pour les associés de déduire des charges afférentes au logement. En revanche, sont autorisés les dispositifs de crédits d’impôt pour dépenses engagées sur le logement pour les associés occupant le bien.
Si les revenus bruts fonciers n’excèdent pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition, c’est le régime du micro-foncier qui s’applique, sous certaines conditions. Dans ce cas, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges. Étant précisé que si les charges déductibles dépassent ce montant, les associés ont tout intérêt à user alors de leur faculté d’option pour le régime réel. Au final, le régime de transparence fiscale des sociétés de personnes peut s’avérer pénalisant lorsque le taux marginal d’imposition de l’associé est élevé.
• Lorsque l’option pour l’IS a été retenue, c’est la société qui est taxée sur son résultat au taux normal de 28 % (25 % à partir de 2022) jusqu’à 500 000 € de bénéfices (et au taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable). Les associés n’étant soumis à l’IR que lorsqu’ils perçoivent des dividendes. Si tel est le cas, les dividendes sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (après abattement de 40 %) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mais attention, l’option, lorsqu’elle est exercée, vaut pour l’ensemble des revenus, des gains et des créances entrant dans le champ d’application du PFU.
L’avantage de l’IS réside dans le fait que les associés peuvent décider de capitaliser le résultat en réserve et ainsi différer la taxation au moment de la distribution des résultats et/ou des réserves. Un bon moyen de satisfaire une « politique » de réinvestissement sans pression fiscale excessive.
Les plus-values
Lorsque la société cède un bien immobilier, la plus-value engendre une imposition. Cette imposition variante, là aussi, selon le régime fiscal de la SCI.
• Pour les SCI à l’IR, la plus-value est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. Elle est déterminée à partir du prix d’acquisition de l’immeuble par la société. La plus-value est imposée au taux forfaitaire de 19 % et soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une imposition globale de 36,2 %. En revanche, la plus-value bénéficie d’un abattement pour durée de détention, qui conduit à son exonération totale au bout de 22 ans (30 ans pour l’exonération totale des prélèvements sociaux).
• En ce qui concerne la plus-value réalisée dans une SCI à l’IS, le régime qui s’applique est celui des plus-values professionnelles. Cette plus-value est taxée au taux de droit commun (15 %, puis 28 %). La plus-value est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition minoré des amortissements réalisés, mais sans pouvoir prétendre à l’abattement pour durée de détention. L’option peut donc être pénalisante lorsque l’associé détient ses parts depuis plusieurs années.
Précision :
seule l’option à l’IS permet d’amortir l’immeuble détenu au sein de la SCI. L’amortissement vient alors réduire le résultat fiscal. Peuvent être amortis le prix d’achat d’un immeuble, tout comme les travaux qui ont pu être réalisés. En clair, la SCI soumise à l’IS coûte fiscalement moins cher pendant toute la durée de l’amortissement et permet de soulager la trésorerie.
L’option à l’IS modifie également le régime d’imposition des plus-values de cession des parts de la SCI par les associés. Au régime des plus-values privées immobilières est substitué le régime des plus-values de cession de droits sociaux. À noter qu’en cas de moins-value, celle-ci est imputable sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes. En revanche, lorsque la cession de parts de SCI relève du régime des plus-values immobilières, aucune imputation des moins-values n’est en principe possible. Une compensation entre plus-values et moins-values peut toutefois être opérée dans le cas d’une cession en bloc, à un ou plusieurs acquéreurs, des parts d’une même SCI.
Alors quel régime fiscal choisir ? La réponse peut différer selon vos objectifs et l’ampleur de vos projets. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à vous tourner vers le Cabinet qui vous aidera à définir la solution la plus adaptée à votre situation.
Investir dans la finance responsable
De plus en plus présente, la finance responsable a des atouts à faire valoir.
Les Français sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la finance responsable. Une forme de capitalisme qui cherche à avoir des impacts positifs sur la société et l’environnement. Mais la question est de savoir si ce type de placement est aussi performant que les autres.
Un rendement souvent supérieur
L’investissement socialement responsable (ISR) véhicule bon nombre de préjugés, parmi lesquels figure celui du manque de rentabilité. Pourtant, une étude de 2015 de Friede, Busch et Bassen, qui synthétise pas moins de 2 200 études sur le sujet, confirme que les entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dégagent un supplément de performance économique stable dans le temps. Ainsi, les gestionnaires des fonds ISR qui sélectionnent strictement ces entreprises « vertueuses » assureraient à l’investisseur un surcroît de rendement par rapport à une gestion d’actifs plus traditionnelle. Preuve en est, le fonds ISR Sycomore Sélection Responsable, spécialisé dans les actions de la zone euro, a délivré un rendement de 18,89 % en 2015. Sachant que la moyenne 2015 des rendements de ces valeurs (Euro Stoxx TR) s’est établie à 10,33 %.
Précision :
les critères ESG constituent le pilier de l’analyse extra-financière. Concrètement, le critère environnemental vise les efforts qu’une société déploie pour limiter ses impacts (gestion des ressources naturelles, gaz à effet de serre...). Le critère social a, quant à lui, pour objet d’évaluer le comportement d’une entreprise vis-à-vis des règles en matière de droit du travail et du respect des droits de l’homme. Enfin, le critère de gouvernance porte sur la manière dont l’entreprise est dirigée et contrôlée (respect des droits des actionnaires, indépendance du conseil d’administration).
Une grande diversité de fonds
Dans l’esprit de certains investisseurs, l’ISR serait cantonné aux seuls actifs en actions. Ce qui reviendrait à prendre des risques plus importants qu’avec un fonds classique. En réalité, à l’instar des autres produits financiers, l’investissement socialement responsable bénéficie d’un univers assez riche. Outre les actions, il est ainsi possible d’investir dans des fonds obligataires, diversifiés ou monétaires. Une diversité qui permet de se constituer un portefeuille avec différentes classes d’actifs et niveaux de volatilité. Étant précisé que ces fonds ISR peuvent être souscrits dans le cadre d’un compte-titres, d’un plan d’épargne en actions, d’une assurance-vie ou encore de l’épargne salariale ou retraite (PEE, Perp, contrat Madelin…).
Des actifs moins volatiles
Il a été observé que plus la notation selon des critères ESG d’une société était élevée, moins le prix de ses actions avait tendance à être volatil, et ce particulièrement dans les périodes où les marchés financiers sont agités.
Faut-il tenir une comptabilité dans une SCI ?
Comme les autres sociétés, les sociétés civiles immobilières sont soumises à des obligations comptables.
En raison de sa souplesse, bon nombre d’investisseurs et de dirigeants d’entreprise font le choix de créer une société civile pour détenir et gérer leur patrimoine immobilier. Mais cette souplesse permet-elle de se dispenser de tenir une comptabilité ? Le point sur cette question.
Des obligations comptables
Les sociétés civiles immobilières (SCI) doivent, au même titre que les autres sociétés, tenir une comptabilité. Sont concernées par cette obligation notamment :
- les SCI assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- les SCI exerçant une activité particulière (comme la construction-vente ou encore le placement collectif en immobilier) ;
- les SCI de taille importante, c’est-à-dire dépassant deux des trois seuils suivants : 1 550 000 € de total de bilan, 3 100 000 € de chiffre d’affaires et 50 salariés ;
- les SCI ayant des statuts imposant cette formalité.
Une comptabilité en « partie double » qui doit être tenue conformément aux règles du Plan comptable général.
En revanche, pour les autres sociétés civiles immobilières, globalement celles soumises à l’impôt sur le revenu, la tenue d’une comptabilité n’est pas spécifiquement requise. Toutefois, il est fortement recommandé de tenir a minima une comptabilité de trésorerie. En pratique, il s’agit d’un cahier dans lequel sont enregistrées les recettes et les dépenses. Le but du jeu étant que le solde de fin d’année corresponde au solde figurant sur les relevés bancaires de la SCI.
L’intérêt de tenir une comptabilité
La tenue d’une comptabilité présente certains avantages. Ainsi, elle permet au gérant de satisfaire à son obligation d’information à l’égard des autres associés sur la situation de la société civile immobilière, de fixer les droits respectifs des associés et de justifier auprès du fisc le montant des comptes courants d’associés ainsi que le contenu des déclarations fiscales. Elle est également utile en cas de cession ou de donation des parts pour fixer leur valeur et calculer les droits de mutation ainsi que l’impôt sur la plus-value.
Attention à la fictivité !
Bien qu’étant simplement destinée à loger un patrimoine immobilier, la SCI est une société à part entière. Aussi faut-il respecter un certain formalisme lors de sa création et régulièrement tout au long de son existence. Il convient donc de tenir une comptabilité et de déposer les différentes déclarations fiscales mais aussi de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an.
Et attention, s’exonérer de ces formalités peut mettre en danger la viabilité d’une SCI. En effet, en cas de contentieux, l’administration fiscale n’hésitera pas à constater la fictivité de la société civile, voire à considérer que les associés ont constitué une SCI dans un but uniquement fiscal.
Attention à la fictivité !
Bien qu’étant simplement destinée à loger un patrimoine immobilier, la SCI est une société à part entière. Aussi faut-il respecter un certain formalisme lors de sa création et régulièrement tout au long de son existence. Il convient donc de tenir une comptabilité et de déposer les différentes déclarations fiscales mais aussi de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an.
Et attention, s’exonérer de ces formalités peut mettre en danger la viabilité d’une SCI. En effet, en cas de contentieux, l’administration fiscale n’hésitera pas à constater la fictivité de la société civile, voire à considérer que les associés ont constitué une SCI dans un but uniquement fiscal.
Ce qu’il faut savoir sur la garantie des accidents de la vie
La garantie des accidents de la vie est un contrat d’assurance dont l’objet est d’indemniser les assurés en cas de dommages corporels accidentels importants survenant dans le cadre privé.
La garantie des accidents de la vie (GAV) est un contrat de prévoyance qui vous assure une indemnisation en cas de dommages corporels accidentels de la vie privée. Un contrat qui peutt se révéler utile à condition de bien le choisir. Explications.
Quelle couverture ?
La garantie des accidents de la vie couvre les dommages corporels causés par des accidents domestiques, médicaux, de loisirs, des catastrophes naturelles, des agressions ou des attentats.
Peu importe d’ailleurs l’endroit où ces accidents surviennent : chez vous, en France, en Europe, voire dans le reste du monde, à condition toutefois que votre séjour n’excède pas une durée continue de 3 mois. Sont en revanche exclus les accidents de la route ainsi que les accidents du travail (sauf pour les artisans, les commerçants, les libéraux et les agriculteurs) qui sont soumis à un régime d’indemnisation spécifique.
La GAV prévoit également le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré.
À noter que la garantie des accidents de la vie peut être souscrite pour une personne seule, un couple ou une famille entière. Le nombre d’assurés influant bien évidemment sur les conditions tarifaires.
Quelle indemnisation ?
Pour déclencher une indemnisation, l’assuré doit être atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 30 %. Un « seuil d’intervention » que l’on retrouve généralement dans les contrats d’entrée de gamme. Pour atteindre ce taux, il faut avoir été victime d’un accident d’une certaine gravité. À titre d’exemple, la perte d’un gros orteil représente une incapacité permanente de 10 %, celle de la vision d’un œil 25 %, d’une jambe 40 à 50 %, etc. D’autres contrats, plus protecteurs,interviennent à partir d’un taux d’invalidité de 10 %, voire de 5 %.
Dès lors que l’incapacité permanente de l’assuré est au moins égale à 30 %, les contrats garantie accidents de la vie indemnisent notamment le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément (par exemple, impossibilité de continuer la pratique de l’activité de loisirs de l’assuré), les souffrances physiques et psychiques et la perte de revenus résultant de l’incapacité de travailler.
Côté cotisation, comptez en moyenne 150 € par an pour un contrat individuel intervenant à partir de 10 % d’invalidité et 100 € pour un contrat à 30 %. Et côté indemnités, c’est l’assureur qui détermine, la plupart du temps, leur montant en se basant sur les barèmes établis par les tribunaux. Des barèmes qui tiennent compte de l’invalidité, de ses conséquences financières, des souffrances et des préjudices esthétique et d’agrément.
Délai d’indemnisation
L’assureur doit proposer une offre d’indemnisation dans les 5 mois qui suivent la déclaration de l’accident ou du décès. Une fois cette proposition acceptée par la victime, le règlement des sommes doit intervenir dans un délai d’un mois.
Location meublée touristique : êtes-vous en règle ?
Le point sur les obligations à respecter pour louer un meublé de tourisme.
Avec le développement des plates-formes Internet comme Airbnb, la tentation de s’adonner à la location meublée touristique est de plus en plus forte chez les particuliers.
Une bonne occasion de faire un tour d’horizon des principales règles qui encadrent cette activité très surveillée par les pouvoirs publics.
Des obligations déclaratives
Si vous décidez de louer votre résidence principale, vous n’aurez, en principe, pas de démarches particulières à réaliser. Attention toutefois de ne pas louer votre logement plus de 120 jours par an. Au-delà, il serait considéré comme votre résidence secondaire. Ce qui vous obligerait à accomplir les formalités attachées à ce régime.
En revanche, si vous souhaitez louer votre résidence secondaire, vous devrez le déclarer à la mairie au moyen du formulaire n° 14004*03.
En complément, dans certaines villes (plus de 200 000 habitants), il pourra également être nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage de votre logement. Une demande qui devra aussi être formulée à la mairie.
Autre formalité, dans les villes qui l’ont décidé par délibération du conseil municipal, vous devrez demander auprès de la mairie un numéro d’enregistrement qui devra figurer sur toutes vos annonces de location.
Des obligations fiscales
Les revenus tirés de la location de meublés de tourisme relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée de façon occasionnelle ou habituelle. Si vos recettes annuelles ne dépassent pas 70 000 €, vous devrez indiquer leur montant directement sur votre déclaration complémentaire de revenus (formulaire 2042 C PRO). Au-delà de ce montant, une déclaration professionnelle n° 2031 devra être remplie.
Et sachez que, selon les villes, vous devrez collecter auprès de vos locataires une taxe de séjour que vous devrez reverser à la commune. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie !
À noter :
la location de logements meublés constitue par nature une activité commerciale professionnelle imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Toutefois, peuvent être exonérées de CFE les personnes qui louent occasionnellement une partie de leur résidence principale ou secondaire ; ou régulièrement, à un prix raisonnable (plafond annuel de 185 € par m² de surface habitable en Île-de France et 136 € dans les autres régions), à un locataire qui en fait sa résidence principale.
Des obligations sociales
Si les recettes tirées de la location de votre meublé touristique sont supérieures à 23 000 € par an, vous serez redevable de cotisations sociales. Selon le montant de vos recettes, vous relèverez du régime de la micro-entreprise, du régime général de la Sécurité sociale ou de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI).
Les Sofica valent-elles vraiment le coup ?
La réduction d’impôt offerte par les Sofica attire de nombreux investisseurs. En revanche, le rendement attaché à ces supports d’investissement est plutôt décevant.
En investissant dans une Sofica, il est possible de bénéficier d’un avantage fiscal attrayant. En revanche, le rendement reste assez faible.Coup de projecteur sur ce produit, vieux de plus de 30 ans, qui concourt au financement des œuvres cinématographiques et télévisuelles.
Une réduction d’impôt attractive…
Les personnes qui investissent en numéraire dans une Sofica agréée bénéficient, en principe, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des souscriptions effectivement versées au cours de l’année d’imposition. L’assiette de l’avantage fiscal est toutefois plafonnée à 25 % du revenu net global et à 18 000 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.
Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans. Un délai qui n’a visiblement pas été choisi au hasard puisqu’il correspond au cycle moyen de production et d’exploitation d’une œuvre cinématographique.
… mais des rendements limités
Les performances des Sofica sont très variables. Concrètement, en intégrant l’avantage fiscal de 6 480 € (taux de 36 %), la performance moyenne constatée par certaines études oscille entre 2,5 % et 5,5 %. Un résultat obtenu en considérant que les Sofica restituent aux investisseurs entre 75 % et 90 % du capital collecté au bout de 6 ans. Ce qui est loin d’être le cas le plus courant puisque, sur un échantillon de 50 Sofica (commercialisées entre 2002 et 2016), 60 % d’entre elles remboursent en dessous de 70 %. Et même en considérant qu’une Sofica a aidé à financer un film à gros succès, les espoirs de gains ne seront peut-être pas au rendez-vous puisque son investissement n’aura représenté qu’un pourcentage très limité de l’investissement total. Vous l’aurez compris, le rendement des Sofica est avant tout produit par la réduction d’impôt.
En conclusion, ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients. D’une part, il n’existe aucune place de marché organisé, ce qui veut dire que les investisseurs ne peuvent ni achter ni vendre des parts de Sofica. D’autre part,les délais pour récupérer ses fonds peuvent être longs. Généralement, une Sofica procède à sa liquidation et à la restitution des sommes aux épargnants à parir de la 6eannée d’existence, sauf si elle décide de prolonger sa durée de vie jusqu’à 10 ans.
La liste des Sofica
Chaque année, le Centre national du cinéma et de l’image animée dévoile la liste des Sofica agréées par les pouvoirs publics pour collecter des fonds.
Généralement, cette liste contient une dizaine de noms et autorise une collecte d’un peu plus de 60 millions d’euros.
Prélèvement à la source : le rôle de l’employeur
Actuellement, vos salariés s’acquittent de l’impôt sur le revenu directement auprès de l’administration fiscale. À compter du 1er janvier 2019, vous devrez, en tant qu’employeur, prélever cet impôt, chaque mois, sur le montant net imposable de leurs rémunérations pour le reverser à l’État. Comment allez-vous mettre en place ce prélèvement à la source (PAS) dans votre entreprise ? Et quel sera l’impact de la réforme pour vos salariés ? Premier tour d’horizon.
Le taux de prélèvement
Lors de la déclaration de leurs revenus de 2017, vos salariés prendront connaissance du taux de prélèvement qui s’appliquera à leurs salaires en janvier 2019.
Un taux personnalisé
Si ce n’est déjà fait, vos salariés vont prochainement déclarer leurs revenus de 2017. À cette occasion, l’administration fiscale va calculer le taux de prélèvement qui s’appliquera à leurs salaires à partir de 2019. Ce taux, dit « personnalisé », est déterminé par foyer fiscal et tient compte de la situation familiale, des revenus et des charges du salarié, mais pas de ses réductions et crédits d’impôt. Il se calcule à partir de la formule savante suivante :[IR x (RNI PAS / RNI)] / R.
- IR correspondant à l’impôt avant réductions et crédits d’impôt ;- RNI PAS au revenu net imposable entrant dans le champ d’application du prélèvement ;- RNI au revenu net global imposable ;- et R aux revenus soumis au prélèvement (avant déduction des frais professionnels).
Exemple :
un couple marié a déclaré, pour 2017, des salaires de 20 000 € et 25 000 €, des revenus mobiliers (sans abattement) de 2 500 € et une réduction d’impôt de 1 250 €. Étant précisé que les revenus mobiliers n’entrent pas dans le champ d’application du PAS.- Salaires après déduction des frais professionnels (10 %) : 40 500 € ;- Impôt sur le revenu avant réduction d’impôt = 3 274 € ;- Taux du PAS : [3 274 x 40 500 / (40 500 + 2 500)] / (20 000 + 25 000) = 6,85 %.
Et attention, ce taux de 6,85 % ne tient pas compte des réductions et crédits d’impôt. Il générera donc un prélèvement plus élevé que celui que vos salariés auraient connu si le régime actuel de la mensualisation avait été conservé. Les réductions et crédits d’impôt ne seront régularisés qu’en septembre de l’année suivante. Un effet négatif sur la trésorerie de vos salariés qui ne sera que partiellement corrigé par le versement, en mars de chaque année, d’un acompte de 30 % des crédits d’impôt relatifs aux frais de services à la personne et de garde de jeunes enfants obtenus l’année précédente.
L’année blanche :
en 2018, vos salariés vont payer l’impôt sur leurs salaires de 2017. En 2019, ils s’acquitteront de l’impôt sur les salaires de 2019. Pour éviter un double prélèvement, l’impôt sur les salaires de 2018, normalement dû en 2019, sera, en principe, neutralisé par un crédit d’impôt.
Des options possibles
Le taux ressortant de la formule de calcul ne sera pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, pourront opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus.
Quant aux salariés qui ne souhaiteront pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ils auront aussi la possibilité de choisir un taux « non personnalisé ». Celui-ci sera déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise, en fonction d’une grille de taux, correspondant au revenu d’un célibataire sans enfant, publiée par l’administration. Étant précisé que si ce taux conduit à un prélèvement moins important que le taux personnalisé, le salarié devra régler la différence directement auprès de l’administration fiscale.
Point important, les salariés devront demander ces changements de taux auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 15 septembre 2018, et non de l’employeur.
À noter :
chaque année, vos salariés continueront de souscrire une déclaration de revenus. L’administration fiscale calculera l’impôt définitif sur leurs revenus de l’année précédente et percevra le paiement du solde de l’impôt ou procédera à la restitution d’un éventuel trop versé. Elle actualisera également le taux du PAS, applicable à partir de septembre de l’année en cours jusqu’en août N+1. Point important : à aucun moment, l’employeur n’a de rôle à jouer dans ces régularisations.
L’information des salariés
Veillez à informer d’ores et déjà vos salariés sur l’instauration du prélèvement à la source.
Vos salariés auront bientôt connaissance de leur taux de prélèvement et des options possibles lors de leur déclaration de revenus en ligne ou au moment de la réception de leur avis d’imposition. Une communication qui suscitera par la suite de nombreuses questions. Afin d’éviter la multiplication des sollicitations, il est fortement recommandé d’informer sans attendre vos salariés sur l’instauration du PAS et ses conséquences pratiques, même si vous n’avez aucune obligation légale en la matière. Vous pourrez ainsi leur rappeler que leur interlocuteur pour toute question fiscale reste la DGFiP !
Attention :
le prélèvement devra apparaître sur le bulletin de paie de vos salariés. En pratique, devront figurer la rémunération nette avant et après prélèvement, le taux et le montant du prélèvement ainsi que la nature du taux (personnalisé ou non).
3 mois d’essai
Si vous anticipez suffisamment, vous pourrez faire préfigurer le prélèvement à la source sur les bulletins de paie de vos salariés des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
Le taux de prélèvement applicable à chaque salarié vous sera transmis par l’administration fiscale via la déclaration sociale nominative (DSN). Plusieurs modifications doivent donc être apportées à votre logiciel de paie. Vous devez en conséquence vous assurer dès à présent que votre éditeur est engagé dans ce chantier afin d’être opérationnel dans les délais. Anticiper l’adaptation de votre logiciel de paie vous permettra également de réaliser une préfiguration du PAS, c’est-à-dire une simulation du montant du prélèvement sur les bulletins de paie de vos salariés.
Concrètement, si votre logiciel est adapté au PAS à l’été 2018, vous pourrez recevoir, dès septembre 2018, les taux de prélèvement de vos salariés et simuler le PAS sur les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Une anticipation conseillée afin, d’une part, de vérifier l’efficacité de votre logiciel de paie et, d’autre part, de sensibiliser vos salariés à la réforme.
La mise en œuvre du prélèvement à la source
C’est à vous, employeur, qu’il reviendra de prélever l’impôt sur le revenu de vos salariés et de le reverser à l’administration fiscale.
Prélever la retenue à la source en appliquant le taux de prélèvement du salarié et la reverser au fisc relèvera de votre responsabilité. En pratique, vous recevrez le taux de prélèvement de chacun de vos salariés via le « compte rendu métier » (CRM) qui vous sera retourné suite au dépôt de votre DSN. Si aucun taux n’est transmis, vous devrez utiliser la grille de taux par défaut. Le taux de chaque salarié devra ensuite être appliqué à son salaire net imposable. Puis, vous devrez reverser le prélèvement à l’administration quelques jours après le paiement du salaire. Ce délai sera variable selon la taille de votre entreprise. Ainsi, les reversements devront intervenir :- le 8 du mois suivant pour les entreprises de plus de 50 salariés dont la date limite de dépôt de la DSN est fixée au 5 du mois ;- le 18 du mois suivant pour les entreprises de moins de 50 salariés dont la date limite de dépôt de la DSN est fixée au 15 du mois.
Par exception, les entreprises de moins de 11 salariés pourront, sur option, procéder à un reversement trimestriel.
Dans cette optique, vérifiez, avant la fin de l’année, que vous avez déclaré sur le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel, les coordonnées bancaires du compte que vous utiliserez pour le reversement du prélèvement. Et pensez aussi à adresser à votre banque le mandat Sepa correspondant, complété et signé.
Comme vous pouvez le constater, votre nouveau rôle de collecteur de l’impôt nécessite de bien se préparer en amont.
Attention :
différentes majorations et amendes sont prévues pour sanctionner les retards, les insuffisances et le défaut de versement de la retenue à la source. Par exemple, en cas d’erreur dans la collecte du prélèvement, une amende de 5 % du prélèvement omis sera encourue, et qui ne pourra être inférieure à 250 €.
Vous laisserez-vous tenter par un FILM ?
Une nouvelle forme d’investissement en location meublée est en train d’émerger.
L’investissement locatif meublé est l’une des solutions privilégiées par les épargnants pour diversifier leur patrimoine. Cet investissement immobilier est possible en direct ou en achetant des parts de fonds d’investissement. À ce titre, un nouveau type de fonds, les FILM (fonds d’investissement en location meublée), a fait récemment son apparition. Présentation.
Vous avez dit FILM ?
Créés par la loi « Macron » du 6 août 2015, les FILM sont des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) dont l’objet est d’acquérir des biens immobiliers afin de les louer meublés. Ces OPCI doivent être composés au minimum de 60 % d’actifs immobiliers physiques et de 10 % de liquidités pour assurer les demandes de retrait des investisseurs. Le reliquat pouvant être librement investi par la société de gestion. Avec un ticket d’entrée modéré de 5 000 €, l’investisseur reçoit des parts qui lui donnent droit à une quote-part des revenus et des plus-values générées par les différents actifs du fonds.
Les avantages des FILM
Les fonds d’investissement en location meublée possèdent plusieurs atouts.
Tout d’abord, les parts de FILM jouissent d’une certaine liquidité. Contrairement aux SCPI, nul besoin qu’un acheteur se présente pour pouvoir vendre ses parts, la société de gestion étant tenue de les racheter. Attention toutefois, l’investisseur ne peut pas demander à être remboursé pendant les 5 premières années de détention.
Ensuite, l’investisseur profite du statut de loueur en meublé non professionnel. Un statut fiscal qui permet notamment de déduire les frais de souscription, les frais de notaire, les intérêts d’emprunt et de constater un amortissement annuel.
En outre, l’investisseur s’affranchit des contraintes de gestion d’un bien immobilier détenu en direct. Et surtout, il peut investir dans une multitude de résidences (étudiantes, tourisme, Ehpad, seniors) sans prendre de risques liés, par exemple, au recouvrement des loyers et à l’occupation locative.
Un bémol toutefois, les fonds d’investissement en location meublée facturent à l’investisseur des frais relativement élevés : environ 10 % de frais de souscription et 10 % de frais annuels de gestion !
Une assurance complémentaire
Certains fonds d’investissement en location meublée proposent à l’investisseur une assurance protection revente. Une assurance permettant une indemnisation en cas de moins-value résultant d’une cession imposée par la force majeure (licenciement économique, invalidité permanente, divorce, décès...). Étant précisé que cette assurance permet une prise en charge dans la limite de 20 % du prix d’achat des parts du FILM et de 35 000 €.
Un rendement attractif ?
Les FILM sont relativement récents. Beaucoup d’entre eux sont même encore en cours de constitution. Certains opérateurs attendent des rendements nets de frais compris entre 2 % et 4 % par an.
Les rendements 2017 des assurances-vie en euros
Le rendement moyen des fonds en euros a baissé, une nouvelle fois, en 2017.
Depuis quelques semaines, les assureurs annoncent les performances réalisées en 2017 par leurs fonds en euros.
Malheureusement, le cru 2017 est encore moins bon que le précédent. En effet, ces supports d’investissement ont délivré un rendement moyen de 1,5 %, soit une baisse de 0,3 point par rapport à 2016. La cause ? Les fonds en euros, investis principalement en obligations, ont subi les effets de la baisse durable des taux d’intérêt.
Toutefois, les rendements pourraient redécoller d’ici quelques années en raison, notamment, du retour de l’inflation en France et de l’augmentation des taux obligataires (OAT 10 ans) amorcée depuis le début de l’année.
Des résultats disparates
Les résultats des fonds en euros sont plutôt hétérogènes.
D’un côté, les contrats des « bancassurances » offrent des rendements à peine plus élevés que la moyenne. C’est le cas, par exemple, du contrat Nuances privilège de la Caisse d’Épargne, qui affiche un taux de 1,75 %.
De l’autre, ceux des mutuelles et des associations d’épargnants parviennent à rester au-dessus de la barre des 2 %. Tel est le cas du contrat d’Asac-Fapès qui offre un rendement de 2,58 %.
Les rendements 2017 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
| Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
| 2017 | 2016 | ||
| Afer | Compte Afer | 2,40 % | 2,65 % |
| Agipi / Axa | Cler | 2,10 % | 2,25 % |
| Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,90 % | 2,10 % |
| Allianz Vie | Gaipare | 2,65 % | 2,90 % |
| Asac Fapes Diffusion | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,58 % | 2,80 % |
| Axa | Figures Libres | 1,90 % à 2,25 % | 2 % à 2,50 % |
| BforBank | BforBank Vie | 2,15 % | 2,17 % |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,82 % | 1,70 % à 1,85 % |
| Boursorama.com | Boursorama Vie | 1,77 % | 2,25 % |
| Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,75 % | 1,80 % |
| CNP / La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 1,95 % à 2,15 % | 1,95 % à 2,17 % |
| Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 | 1,20 % | 1,30 % |
| Generali Vie | Xaélidia | 2,59 % | 2,81 % |
| GMF Vie | Multéo | 2,10 % | 2,50 % |
| ING Direct | ING Direct Vie | 1,77 % | 2,25 % |
| LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 1,80 % | 1,40 % à 1,80 % |
| Le Conservateur | Helios Sélection | 2,45 % | 2,75 % |
| MACIF | Mutavie Actiplus | 1,80 % | 1,80 % |
| MAAF VIE | Winalto | 1,85 % | 2,35 % |
| MACSF | RES Multisupport | 2,45 % | 2,45 % |
| MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 2,50 % | 2,60 % |
| MMA Vie | Multisupports | 1,51 % à 2,01 % | 2,01 % à 2,51 % |
| Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 1,77 % | 2,25 % |
| Mutavie | ActiPlus | 1,80 % | 1,80 % |
| Natixis Assurances | Solévia | 1,45 à 1,7 % | 1,55 à 1,8 % |
| Neuflize Vie | Hoche Patrimoine | 2,10 % | 2 % |
| Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 2,05 % | 2,30 % |
| SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,26 % | 2,05 % |
| Société Générale / Sogecap | Séquoia | 1,33 % à 1,81 % | 1,30 % à 1,50 % |
| Spirica | Private Vie | 1,70 % | 1,71 % |
| Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 2 % | 2,30 % |
| Swiss Life | Liberté | 1,8 à 2,6 % | 2 à 2,7 % |
| UAF Life Patrimoine | Arborescence | 1,75 % | 2,01 % |
Contrat d’assurance-vie et contrat d’assurance-décès : quelles différences ?
Des contrats d’assurance qui ne répondent pas au même objectif.
Bien souvent, assurance-vie et assurance-décès sont confondues par le grand public.
Pourtant, bien qu’ils présentent des similitudes, notamment le fait qu’ils prévoient tous les deux le versement d’un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès du souscripteur, ces deux contrats ont des objets très différents.
L’assurance-vie, un produit d’épargne
Véritable couteau suisse, l’assurance-vie est un produit d’épargne qui permet de se constituer un capital grâce à des versements libres ou programmés, sachant que les capitaux accumulés restent disponibles à tout moment. L’épargnant peut donc utiliser son contrat pour réaliser différents projets comme l’acquisition d’un bien immobilier, le financement des études de ses enfants, la préparation de son départ à la retraite, ou encore la transmission d’un capital aux bénéficiaires de son choix dans un cadre fiscal particulièrement avantageux. En effet, dans la plupart des cas, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés sont exonérés d’impôts et/ou de droits de succession grâce à l’application d’abattements. Par exemple, il est possible de transmettre, par bénéficiaire, jusqu’à 152 500 € en franchise de droits (franchise réservée aux primes versées avant l’âge de 70 ans).
L’assurance-décès, une opération de prévoyance
La vocation première d’un contrat d’assurance-décès est d’offrir une protection à la famille en cas de décès de l’assuré, en couvrant notamment ses besoins immédiats comme les dépenses courantes, les frais de scolarité ou encore le remboursement d’un crédit. Cette protection prend la forme d’un versement en capital dont le montant est défini dès la souscription du contrat.
L’assurance-décès peut également prévoir, en cas d’invalidité absolue et définitive, des garanties comme le versement d’un capital ou d’une rente d’éducation jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge prévu dans le contrat.
Attention toutefois, si le décès (ou l’invalidité) de l’assuré n’intervient pas pendant la durée du contrat, les cotisations versées à la compagnie d’assurance ne sont pas restituées. Des cotisations dont le montant est déterminé lors de la souscription en fonction de l’âge du souscripteur et du capital choisi.
Rédiger la clause bénéficiaire
Lors de la souscription de votre contrat d’assurance, vous devrez vous pencher sur la question de la clause bénéficiaire. Cette clause désigne une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de votre famille, qui seront appelées à devenir, à votre décès, les bénéficiaires des sommes d’argent prévues ou contenues dans le contrat. Vous pourrez choisir l’une des clauses types proposées par votre assureur ou la rédiger vous-même. Mais attention, rédigez-la avec beaucoup de précautions car chaque mot a son importance !
Des contrats complémentaires
Bien que ces contrats d’assurance soient différents dans leur conception et leurs objectifs, rien n’empêche l’épargnant de les combiner pour, à la fois, offrir une certaine protection à ses proches et financer ses projets de vie.
Les formalités médicales pour une assurance-emprunteur
Avant de « couvrir » votre prêt immobilier, la compagnie d’assurances a quelques questions à vous poser...
Lorsque vous contractez un crédit immobilier, l’établissement bancaire vous impose de souscrire un contrat d’assurance-emprunteur.
Une couverture que la compagnie d’assurances vous consentira après vous avoir fait remplir un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. Explications.
Quelles formalités ?
Le questionnaire de santé a pour objet d’aider la compagnie d’assurances à évaluer le risque qu’elle prend en assurant votre crédit immobilier.
En pratique, ce document comprend une série de questions relatives à vos antécédents médicaux : vos arrêts de travail, vos interventions chirurgicales, vos traitements médicaux en cours, les maladies dont vous souffrez, vos antécédents familiaux, etc.
Mais attention, remplissez les différents documents de l’assureur avec le plus de précision et de sincérité possible. Car en cas d’omissions ou de fausses déclarations, vous vous exposeriez à un refus de prise en charge de vos sinistres.
Renseigner un questionnaire de santé suffit généralement pour souscrire une assurance-emprunteur, sauf lorsque vous atteignez un certain âge et pour un certain montant emprunté (45 ans pour un emprunt de plus de 200 000 €, 65 ans pour plus de 100 000 €…) ou que vous présentez des antécédents médicaux sérieux. Dans ces hypothèses, vous devrez passer une visite médicale (avec examens, analyses et rapport médical) auprès de votre médecin traitant ou d’un centre médical agréé par la compagnie d’assurances. Étant précisé que cette dernière prend généralement à sa charge les frais médicaux que vous aurez ainsi engagés pour réaliser les examens qui vous auront été demandés.
À noter :
depuis le 1er janvier 2016, les emprunteurs bénéficient d’un droit à l’oubli. Ce droit permet notamment aux personnes qui ont été atteintes d’un cancer de ne plus avoir à indiquer cet antécédent médical dans le questionnaire de santé. Il s’applique aux cancers qui ont été diagnostiqués avant l’âge de 18 ans et dont le protocole thérapeutique a pris fin depuis 5 ans, et à ceux qui ont été diagnostiqués après 18 ans et dont le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans au moins.
La décision de l’assureur
Après avoir accompli ces différentes formalités, la compagnie d’assurances apportera une réponse à votre demande d’adhésion. Elle pourra accepter votre dossier soit sans restriction, soit en excluant certaines pathologies ou garanties.
En outre, votre état de santé aura bien évidemment une influence sur la tarification de votre contrat. Après étude, l’assureur pourra vous appliquer le taux normal ou majoré de cotisation.
Il pourra également, et c’est le pire des cas de figure, refuser de vous prendre en charge. Sachez toutefois que des recours sont possibles. Ils permettent un réexamen de votre dossier par des spécialistes dont la mission consiste à vous proposer une solution d’assurance, hélas, pas toujours bon marché !
Comment préserver le capital de votre assurance-vie ?
Certains assureurs peuvent vous proposer de souscrire une garantie plancher.
Vous souhaitez profiter du dynamisme des marchés financiers tout en étant sûr que les sommes d’argent que vous avez versées sur votre contrat d’assurance-vie reviendront en totalité à vos bénéficiaires ? C’est possible grâce à la garantie plancher.
Un mécanisme protecteur
Faire appel aux unités de compte est un bon moyen d’améliorer le rendement de son contrat d’assurance-vie. Mais contrairement aux fonds en euros, le capital investi n’est alors pas garanti. Ce qui peut poser problème lorsqu’on a recours à ce produit d’épargne pour transmettre une partie de son patrimoine.
C’est pourquoi certaines compagnies d’assurance proposent aux épargnants la mise en place d’une garantie plancher. En clair, il s’agit d’une assurance complémentaire dont le rôle est de garantir au(x) bénéficiaire(s) du contrat qu’il(s) percevra(ont), au décès de l’assuré, une somme minimale correspondant au capital (net de frais) versé au contrat. Les éventuelles pertes enregistrées seront donc prises en charge par l’assureur. Une garantie qui, selon les contrats d’assurance-vie, peut faire l’objet ou non d’une tarification supplémentaire et d’un plafonnement.
Les différentes garanties
Il n’y a pas que la garantie plancher « simple » pour assurer un capital. La compagnie d’assurance peut également vous proposer d’autres formules : la garantie indexée, la garantie cliquet et la garantie vie entière.
La garantie indexée applique aux cotisations que vous avez versées un taux d’indexation annuel pour déterminer le montant du capital garanti. Pas plus onéreuse qu’une garantie plancher simple, cette option est intéressante pour lutter notamment contre l’érosion monétaire.
La garantie cliquet permet, quant à elle, de garantir le versement d’un capital égal à la valeur de rachat la plus élevée atteinte durant la vie du contrat. Une garantie qui peut représenter un coût important surtout lorsque l’assuré dépasse l’âge de 60 ans.
Enfin, la garantie vie entière, appelée également « garantie majorée », consiste à fixer, lors de la souscription de l’option, le montant du capital qui sera versé aux bénéficiaires en plus de la valeur de rachat de votre contrat au moment de son dénouement.
À noter :
en plus d’être plafonnées, certaines des garanties planchers des contrats d’assurance-vie en unités de compte cessent de produire leurs effets au-delà d’un certain âge : 75 ans pour la garantie simple et 65 ans pour la garantie assortie d’un effet cliquet.
Comment acheter un bien immobilier aux enchères ?
Les précautions à prendre et la procédure à suivre lors de l’acquisition d’un bien immobilier aux enchères.
Tout le monde est à la recherche de la bonne affaire, encore plus lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier. Et pour la dénicher, certains décident de se rendre à une vente aux enchères. Zoom sur les précautions à prendre et sur la démarche à suivre en la matière.
Bien connaître le logement
Que vous ayez choisi de vous rendre à une vente notariale ou judiciaire, vous avez tout intérêt à participer en amont aux visites organisées par les chargés de la vente. À cette occasion, vous pourrez juger du potentiel du bien immobilier et des éventuels travaux à réaliser.
Vous devez également prendre connaissance des cahiers des charges, mis à votre disposition, selon le cas, au cabinet du notaire ou de l’avocat ou au greffe du tribunal de grande instance. Ces documents contiennent notamment les diagnostics, les baux consentis, les servitudes, le motif de la mise en vente, la mise à prix, etc.
Préparer son financement
Hors de question de participer à une vente aux enchères sans avoir préparé le financement de l’opération.
Pour une vente notariale, vous devrez, le jour de la vente, déposer un chèque simple ou de banque du montant de la consignation demandée dans le cahier des charges.
Pour une vente judiciaire, une caution bancaire ou un chèque de banque représentant 10 % du montant de la mise à prix vous sera demandé. Des garanties financières que vous récupérerez si vous n’enchérissez pas ou ne remportez pas le lot.
Porter une enchère
Les ventes aux enchères notariales sont ouvertes à tous, mais seules les personnes munies d’un badge délivré par l’organisation peuvent enchérir. Dans une vente judiciaire, les choses sont différentes : seul un avocat du barreau concerné a le droit de porter une enchère lors de l’audience d’adjudication. Pour participer, vous devrez donc mandater l’un de ces professionnels. Si vous avez porté l’enchère la plus élevée, vous serez déclaré adjudicataire. Vous aurez, en principe, 45 jours (vente notariale) ou 60 jours (vente judiciaire) pour régler la totalité du prix ainsi que les frais liés à l’achat (autour de 15 %). Au-delà de ce terme, ce prix produira de plein droit des intérêts au taux légal en vigueur. Sachant que dans certains cas, la vente n’est définitive qu’après un délai de 10 jours suivant la date de la vente. Pendant ce laps de temps, toute personne peut faire une offre supérieure de 10 % au montant adjugé. Si tel est le cas, une nouvelle vente aux enchères est organisée.
Et attention, enchérir n’est pas un acte anodin. Car vous ne pouvez pas soumettre votre achat à une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Et vous ne bénéficiez pas non plus d’un délai de réflexion ou de rétractation commes dans les ventes immobilières classiques.
Une nouvelle formule
Les ventes aux enchères se déroulent soit à la bougie, soit au chronomètre. Mais une nouvelle formule est en train d’émerger : la vente au cadran. Elle se déroule uniquement sur Internet, le vendeur déterminant un prix de départ ainsi qu’un prix de réserve. Une fois la vente lancée, le prix de départ baisse toutes les 30 secondes. Le premier acheteur à se manifester (un clic sur « Enchérir ») remporte la vente. Avantage de ce procédé : aucune consignation de fonds n’est exigée.
Comment assouplir le régime de la séparation de biens ?
La société d’acquêts permet aux époux de mettre en commun des biens personnels.
Le régime de la séparation de biens confère aux époux une totale indépendance patrimoniale, chacun d’eux étant libre de gérer ses biens personnels comme il l’entend.
Toutefois, pour atténuer les effets de ce cloisonnement de leurs biens respectifs (pas de biens communs), les époux peuvent constituer une société d’acquêts.
Un régime matrimonial à la carte
La séparation de biens avec société d’acquêts est un régime matrimonial hybride, puisqu’il concilie deux notions contradictoires : l’indépendance patrimoniale des époux et la communauté d’intérêts du mariage. En pratique, ce régime crée trois masses de biens : les biens personnels de chaque époux et une « bulle de communauté » comprenant des biens leur appartenant en commun. Étant précisé que ce sont les époux qui déterminent, lors de la rédaction du contrat de mariage par un notaire, les biens qu’ils souhaitent faire entrer en communauté. Il peut indifféremment s’agir de biens personnels de l’un des époux et/ou de biens indivis qu’ils ont acquis pendant le mariage.
Le plus souvent, la société d’acquêts comprend la résidence principale du couple et, le cas échéant, leurs immeubles de rapport ou encore des biens professionnels, comme un fonds de commerce qu’ils exploitent ensemble.
L’intérêt d’une société d’acquêts
L’adoption de ce régime permet d’atténuer la rigueur de la séparation de biens et de faire profiter un époux de l’enrichissement de l’autre.
Autre intérêt, il est possible de faire régir les biens figurant dans la société d’acquêts par les mêmes clauses que dans un régime de communauté. Par exemple, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause de partage inégal ou d’attribution intégrale des biens. Des clauses qui viendront améliorer le sort du conjoint survivant au décès de son époux.
Par ailleurs, il faut savoir que les biens contenus dans la société d’acquêts sont, sauf clause contraire, gérés selon les règles du régime de la communauté légale. Ainsi, chaque époux peut, en principe, accomplir tout acte de gestion sur ces biens (vente, location, actes d’administration ou de conservation...). En outre, lors de la dissolution du mariage, par divorce ou par décès, ces biens sont généralement partagés de façon égalitaire entre les époux.
Et la société d’acquêts souffre de la même faiblesse que le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). En effet, les biens qui y sont logés ne sont pas à l’abri des poursuites des différents créanciers de chaque époux. Ce qui signifie que la dette d’un époux peut non seulement absorber ses biens personnels mais aussi ceux contenus dans la société d’acquêts.
Attention, ce régime matrimonial, issu de la pratique notariale, n’est pas encadré par la loi. Il convient donc de porter un soin tout particulier à la rédaction du contrat qui définira les règles qui s’appliqueront aux époux.
Réveiller son épargne avec les exchange traded funds
En acquérant des ETF, l’investisseur peut, en une seule opération, se positionner sur un panier de titres ou s’exposer sur un marché spécifique.
Leur succès ne se dément pas. Ils pèsent aujourd’hui près de 4 000 milliards de dollars dans le monde. Et rien que depuis le début de l’année, les souscriptions d’exchange traded funds (ETF) ont atteint 253,31 milliards de dollars. Un engouement qui n’est visiblement pas près de s’arrêter.
Une bonne raison de s’intéresser à ce qui peut pousser les investisseurs à s’orienter vers ces produits atypiques.
Portrait-robot des ETF
Placés sous l’étiquette des produits à gestion passive, les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un « sous-jacent » (indice boursier, panier d’actions ou d’obligations, pays, secteur d’activité, type d’entreprise...) pris en référence. Concrètement, le gérant constitue les ETF comme un fonds d’investissement traditionnel (OPCVM), c’est-à-dire en détenant en portefeuille les titres composant le sous-jacent.
Notons également que certaines sociétés d’investissement proposent des ETF à effet de levier. Ces derniers peuvent multiplier la performance d’un sous-jacent ou générer du rendement à l’inverse de l’évolution de l’indice (ETF baissiers). Des supports d’investissement pouvant être plus performants mais aussi beaucoup plus risqués que les ETF « classiques ». À utiliser donc avec prudence !
L’intérêt des ETF
Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué, de l’indice CAC 40 par exemple. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention donc, si les cours du sous-jacent s’effondrent, les ETF subiront dans les mêmes proportions une baisse de leurs performances.
En termes de fonctionnement, les ETF se négocient comme les actions et permettent d’investir, en une seule opération, dans un indice ou un panier de titres.
Outre leur grande diversité, les exchange traded funds présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 % à 0,7 % sont prélevés. Revers de la médaille, le faible niveau de ces frais n’encourage pas tous les courtiers à proposer des ETF sur leurs plates-formes.
Enfin, il faut souligner que les ETF peuvent être souscrits par le plus grand nombre puisqu’ils sont, pour la plupart, éligibles au plan d’épargne en actions, au compte-titres ordinaire et à l’assurance-vie via des unités de compte.
Des actifs liquides
Les exchange traded funds sont des actifs bénéficiant d’une certaine liquidité. Cela signifie que ces supports d’investissement se négocient facilement sur les marchés financiers. Sachant que cette liquidité est soutenue par des teneurs de marché (market makers). En pratique, ces derniers s’engagent à se porter contrepartie à l’achat et à la vente sur les différentes places de cotation.
Comment bien préparer votre retraite ?
La préparation de la retraite est un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux Français. D’autant qu’ils savent bien que notre système de retraite par répartition connaît des difficultés pour assurer le versement de pensions convenables à chacun. Il existe toutefois un certain nombre de solutions qui peuvent vous permettre de compenser ou de réduire la baisse de revenus que vous subirez lors de votre départ à la retraite. Voici un tour d’horizon des principaux outils à votre disposition.
Le rachat de trimestres
Pour compléter sa carrière, il est possible de racheter des trimestres de cotisations.
Si vous n’avez pas suffisamment cotisé durant votre vie active, vous avez la possibilité de racheter quelques trimestres. À ce titre, deux dispositifs peuvent être utilisés : le versement pour la retraite « Fillon » et le rachat de trimestres « loi Madelin ».
Le versement pour la retraite permet de racheter, sous conditions, jusqu’à 12 trimestres (dans la limite de 4 trimestres pour la même année civile) correspondant aux années d’études supérieures et aux années civiles incomplètes. Cette faculté est ouverte aux personnes, âgées d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande, qui n’ont pas encore fait liquider leur retraite. Ces rachats étant possibles notamment auprès du régime général des salariés, des travailleurs indépendants (commerçants, artisans, industriels), des professions libérales et agricoles. Le coût d’un rachat dépend évidemment du nombre de trimestres rachetés, mais aussi de l’âge de l’assuré et de ses revenus professionnels des 3 années civiles qui précèdent sa demande. Étant précisé que les versements effectués à ce titre sont déductibles, sans limitation de montant, de la rémunération ou des bénéfices de l’intéressé.
Quant au dispositif Madelin, il s’adresse spécifiquement aux commerçants, artisans et industriels affiliés au régime social des indépendants (RSI). Il leur permet, sous certaines conditions, de racheter les trimestres manquants d’une année incomplète, et ce dans les 6 ans qui suivent la date à laquelle le RSI a connaissance des revenus définitifs de l’année incomplète. Sachant que si le travailleur indépendant cesse son activité professionnelle, il ne dispose plus alors que d’une année pour présenter une demande de rachat. Le coût d’un trimestre racheté dépend ici de la moyenne des revenus non salariés antérieurs actualisés depuis 1973 et de l’âge de l’assuré au moment du rachat. Attention toutefois, un rachat n’est possible que si l’assuré est à jour de ses cotisations vieillesse et invalidité-décès. Intéressant : le rachat Madelin est cumulable avec le versement pour la retraite.
Le rachat de points
Les professionnels libéraux ont la faculté de racheter des points auprès de leur caisse afin d’améliorer le montant de leur retraite complémentaire.
Les professionnels libéraux qui ne bénéficient pas d’une pension de retraite complémentaire obligatoire à taux plein peuvent racheter des points avant leur départ en retraite (le point étant l’unité choisie pour calculer le montant de la retraite complémentaire). Attention toutefois, seules certaines caisses le proposent. C’est le cas, par exemple, de la caisse autonome de retraite des médecins de France, la caisse de retraite des notaires ou la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes. Concrètement, bien que les conditions et le coût d’un rachat diffèrent selon la caisse concernée, le rachat de points peut être effectué au titre notamment des années d’études supérieures, du service national, de la maternité ou de la dispense de cotisations en début d’activité. Là encore, les sommes versées pour racheter des points sont déductibles fiscalement, sans limitation.
Les dispositifs facultatifs de retraite
Certains dispositifs peuvent être mis en place au sein de l’entreprise pour compléter les retraites de base et complémentaires.
Les régimes de retraite supplémentaire
Des régimes collectifs de retraite supplémentaire peuvent être mis en place dans les entreprises pour compléter les retraites de base et complémentaires obligatoires des salariés. Ces régimes, qui assurent à leurs bénéficiaires le versement d’une rente lors de leur départ en retraite, peuvent également bénéficier aux dirigeants assimilés salariés (gérant minoritaire de SARL, président de SAS…).
Trois dispositifs sont prévus : un régime à prestations définies (régime de l’article 39 du CGI) et deux régimes à cotisations définies (articles 82 et 83 du CGI). Sous certaines conditions, la contribution de l’entreprise au contrat de retraite supplémentaire de ses salariés bénéficiaires est, en principe, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu (sauf pour les régimes article 82) et déductible de son résultat imposable.
Précision :
un contrat est à cotisations définies lorsque le montant de la rente qui sera servie au salarié dépend du montant des cotisations versées par le bénéficiaire. Le cabinet ne s’engageant alors que sur les versements. À l’inverse, un contrat est à prestations définies lorsque l’employeur s’engage vis-à-vis de ses salariés à leur verser un certain niveau de pension de retraite.
Le Perco
Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) est un dispositif de retraite à adhésion facultative. Réservé aux entreprises qui comptent au moins un salarié, il permet à ses bénéficiaires de se constituer une rente ou un capital pour leur départ à la retraite. Peuvent bénéficier de ce plan, non seulement les salariés, mais aussi les dirigeants assimilés salariés, les dirigeants non salariés et leur conjoint (collaborateur ou associé) lorsque l’entreprise ne compte pas plus de 250 salariés.
Le Perco est alimenté par son titulaire. Il peut aussi faire l’objet de versements de la part de l’entreprise, ces abondements étant, sous certaines conditions, déductibles de son résultat imposable et exonérés de cotisations sociales (sauf CSG-CRDS et forfait social) et d’impôt sur le revenu.
L’épargne retraite
Les établissements financiers proposent des solutions d’épargne ayant pour but la constitution d’un complément de revenus lors du départ à la retraite.
Le Perp, une solution d’épargne ouverte à tous
Le Plan d’épargne retraite populaire (Perp) est un produit d’épargne à long terme qui a pour objet la constitution d’un complément de revenus au moment de la retraite. Pour pouvoir en bénéficier, le souscripteur alimente son contrat à son rythme par des versements libres ou programmés. Des versements qui lui permettent d’acquérir un droit à rente viagère qu’il pourra faire valoir au moment de son départ en retraite. Sachant que le capital investi est totalement bloqué pendant toute la phase d’épargne. Seules des situations exceptionnelles (invalidité, décès, liquidation judiciaire…) peuvent permettre un déblocage anticipé.
Avantage non négligeable, les sommes versées sur un Perp sont déductibles du revenu imposable de l’intéressé dans la limite d’un plafond global. Le Perp se dénoue, en principe, sous forme de rente viagère. Toutefois, la majorité des contrats permettent au souscripteur de récupérer partiellement (jusqu’à 20 %) les sommes y figurant (ou totalement pour financer l’acquisition de la résidence principale).
Le Madelin, un contrat dédié aux TNS
Le contrat « Madelin » est un produit de préparation à la retraite dédié exclusivement aux travailleurs non salariés (TNS). Il fonctionne quasiment de la même manière que le Perp. Le contrat Madelin permet toutefois une déduction fiscale plus importante que le Perp. Ainsi, dès sa souscription, ce contrat doit faire l’objet d’une alimentation régulière, généralement par un versement annuel. À ce titre, le chef d’entreprise fixe le montant qu’il s’engage à verser, ce montant pouvant varier selon la classe de cotisations qu’il choisit. Les cotisations versées deviennent totalement indisponibles jusqu’à ce que l’adhérent liquide ses droits à la retraite. Le capital accumulé sera alors restitué sous la forme d’une rente viagère. Par exception, l’entrepreneur peut, comme pour le Perp, opérer un retrait anticipé des sommes, mais dans certains cas seulement.
Autre avantage, les cotisations versées sont déductibles du bénéfice imposable. Mais attention, pour bénéficier des avantages du Madelin, il est nécessaire d’être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.
Comment gérer la fiscalité de vos revenus lors d’un divorce ?
Le divorce n’a pas qu’un impact psychologique sur les membres du couple. Il a également une incidence sur leur imposition.
Divorcer, ce n’est pas seulement se pencher sur des questions d’ordre civil et procédural. En effet, souvent, les époux qui engagent une telle procédure n’ont pas conscience que la fin de leur union aura également des conséquences sur leur impôt sur le revenu.
Une imposition séparée
Fort logiquement, la séparation met fin à l’imposition commune. Ainsi, chaque ex-époux doit déclarer ses revenus et ses charges de façon distincte l’année qui suit celle de la fin de leur vie commune. C’est le cas lorsque le divorce a été définitivement prononcé mais aussi lorsque les époux sont séparés de biens et qu’ils ne vivent pas sous le même toit, lorsqu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ou lorsque l’un et l’autre des époux ont abandonné le domicile conjugal et que chacun dispose de revenus propres. En pratique, les époux seront imposés sur les revenus personnels qu’ils ont perçus pendant l’année du divorce ainsi que sur la quote-part des revenus communs leur revenant. Étant précisé que les revenus personnels s’entendent des salaires, pensions et rentes viagères, rémunérations aux gérants et associés de certaines sociétés, bénéfices non commerciaux ou encore bénéfices industriels et commerciaux. Les autres revenus qui n’entrent pas dans ces catégories sont considérés comme des revenus communs.
À noter :
pendant l’année du divorce (ou de la séparation de corps), l’imposition portant sur les revenus de l’année précédente sera toujours émise au nom du couple. Les mensualités ou les acomptes qui en découlent seront donc à régler en commun.
Quotient familial et pension alimentaire
Chaque ex-époux qui déclare séparément ses revenus a droit à une part de quotient familial. Peuvent s’y ajouter les parts fiscales des enfants. Ces dernières sont attribuées au parent qui en a effectivement la charge. Toutefois, en cas de résidence alternée, les parents se partagent la part de chaque enfant.
Par ailleurs, si une pension alimentaire a été prévue, celui qui la reçoit doit la déclarer comme un revenu imposable, l’autre pouvant la déduire. Néanmoins, dans le cadre d’une résidence alternée, cette pension n’est ni imposable chez celui qui la reçoit, ni déductible chez celui qui la verse.
Les investissements locatifs
En cas de divorce, les avantages fiscaux attachés aux dispositifs de défiscalisation immobilière (Pinel, par exemple) ne sont pas systématiquement remis en cause. En effet, lorsque le divorce intervient pendant la durée de l’engagement de location, l’époux qui s’est fait attribuer le bien lors des opérations de partage peut demander à l’administration fiscale la reprise du régime à son profit. Une demande qui doit être jointe à la déclaration de revenus de l’année du divorce.
Vente de la résidence principale
Lors d’une procédure de divorce, les ex-époux peuvent être amenés à vendre le logement familial. Dans pareille situation, ils peuvent, sous conditions, bénéficier de l’exonération totale de la plus-value réalisée.
La location meublée, un régime davantage encadré
Les meublés de tourisme de courtes durées sont dans le collimateur des pouvoirs publics.
De plus en plus de propriétaires ont recours aux services de plateformes Internet (Airbnb, Abritel, HomeAway, Wimdu...) afin de proposer leur logement à la location pour de courtes durées. Face à ce phénomène grandissant, les pouvoirs publics ont décidé d’encadrer encore un peu plus le régime de la location meublée. Le point sur les nouvelles règles applicables.
Une adhésion au RSI
Depuis le 1er janvier 2017, les revenus tirés de la location de logements meublés entre particuliers sont soumis au Régime social des indépendants (RSI), et donc assujettis aux cotisations sociales correspondantes, dès lors qu’ils excèdent 23 000 € par an et que les logements sont loués, pour de courtes durées, à une clientèle de passage ou que l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel. En deçà de 23 000 €, ces sommes restent considérées comme des revenus du patrimoine et sont assujetties aux prélèvements sociaux (15,5 %).
Pour échapper au RSI, les bailleurs peuvent toutefois s’affilier au régime général de la Sécurité sociale lorsque leurs recettes annuelles n’excèdent pas la limite du régime fiscal micro fixée, en principe, à 82 800 €. Mais avant d’opter pour ce régime, mieux vaut faire évaluer les avantages et les inconvénients de ce choix.
La communication des recettes à l’administration fiscale
Par le passé, certains bailleurs n’ont pas « pris soin » de déclarer à l’administration fiscale les revenus tirés de leur activité de location. Aussi, afin de pallier ce manquement, le législateur met à la charge des plateformes Internet une nouvelle obligation déclarative automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs.
Prévue pour la première fois au titre des revenus perçus en 2019, cette déclaration, dématérialisée, devra notamment indiquer l’identité de l’utilisateur, son adresse mail, son statut (particulier ou professionnel), le montant total des revenus bruts qu’il aura perçus ainsi que la catégorie à laquelle se rattachent ces revenus.
De nouvelles formalités
Depuis peu, certaines communes peuvent, par une délibération du conseil municipal, décider de soumettre à déclaration préalable en mairie toute location pour de courtes durées d’un meublé de tourisme. Peuvent être concernés les logements situés à Paris, dans une commune de la petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), dans une commune de plus de 200 000 habitants ou dans une commune de plus de 50 000 habitants comportant des zones dites « tendues ».
Imposition des revenus
L’ensemble des revenus tirés de la location (directe ou indirecte) de logements meublés relève désormais des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que cette activité soit exercée de façon occasionnelle ou habituelle. Et ce à compter des revenus perçus en 2017.
Les alternatives aux fonds en euros traditionnels des contrats d’assurance-vie
Des solutions d’investissement alternatives existent et sont proposées par certains assureurs.
Les contrats d’assurance-vie en fonds en euros possèdent de nombreux avantages : une garantie totale du capital, un mécanisme d’effet cliquet qui sécurise les intérêts générés et une liquidité permanente. Mais leur rendement s’érode d’année en année. Un contexte qui pousse les assureurs à proposer des solutions innovantes.
Le déclin des fonds en euros
Les performances 2016 des fonds en euros sont relativement mauvaises : 1,8 % seulement en moyenne. Un rendement en chute de 0,5 point par rapport à l’année 2015.
Cette baisse s’explique par le fait que les assureurs, pour composer les fonds en euros, investissent massivement les cotisations des assurés dans des obligations émises par de grandes entreprises et/ou qui portent sur de la dette souveraine (obligations d’État). Or, ce dernier type d’obligation, au profil sécurisé, subit une tendance baissière depuis plusieurs années. Dès lors, les compagnies d’assurance ne peuvent maintenir des taux de rémunération performants. De ce fait, certaines d’entre elles obligent désormais les épargnants qui souhaitent accéder ou effectuer des versements complémentaires sur un fonds en euros à placer au moins 20 % des primes versées sur des unités de compte.
Une nouveau type de contrat
Cette situation de baisse des taux a conduit certains établissements financiers à proposer de nouvelles solutions. Ainsi, un premier acteur a lancé un fonds en euros assorti d’un niveau de garantie du capital de 98 %, et non plus de 100 %. Grâce à cette option, le gérant du fonds dispose de plus de latitude pour aller chercher de la performance, le fonds pouvant être investi jusqu’à 35 % dans une poche de diversification composée d’unités de compte. L’objectif de ce nouveau fonds en euros : afficher un rendement de 1 à 1,5 point supérieur à celui délivré par les fonds en euros traditionnels.
Un autre assureur propose un contrat d’assurance-vie multisupport qui protège les unités de compte contre les fortes chutes des marchés financiers. À chaque date anniversaire du contrat, le capital est en effet protégé par un seuil de perte maximal de 10 % ou 15 % selon le support d’investissement choisi. En somme, le souscripteur a la faculté d’assurer son épargne contre les aléas boursiers. Sachant qu’en cas de décès, le capital transmis aux bénéficiaires sera au moins égal à 85 % ou 90 % du capital atteint à la date anniversaire précédente.
Pourquoi et comment changer d’assurance-emprunteur ?
Changer de contrat peut être source d’économies substantielles.
Selon la dernière enquête de la Fédération française de l’assurance, en 2014, 88 % des emprunteurs ont souscrit une assurance-emprunteur dans le même établissement que celui dans lequel ils ont obtenu leur prêt. Ainsi, seulement 12 % d’entre eux ont mis en œuvre une procédure de délégation d’assurance. Pourtant, conclure un contrat en dehors de l’établissement prêteur peut permettre de réaliser de jolies économies.
Le pouvoir de choisir son assurance-emprunteur
Pour faciliter la mise en concurrence et la liberté de choix, les pouvoirs publics ont rendu possible, il y a quelques années, la délégation d’assurance. En clair, il s’agit de la faculté pour un emprunteur de contracter, dans certaines conditions, un contrat d’assurance-emprunteur auprès de la compagnie de son choix, sans être tenu de souscrire celui proposé par l’établissement de crédit. Ainsi, grâce à loi Hamon du 17 mars 2014, les emprunteurs peuvent même, pour les offres de prêt émises depuis le 26 juillet 2014, changer d’assurance pendant les 12 mois qui suivent la signature du contrat de prêt. Et bonne nouvelle ! Une loi du 21 février 2017 offre aux emprunteurs la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, non seulement dans les 12 mois suivant la signature du prêt, mais aussi chaque année à la date anniversaire du contrat. Sont concernées par cette mesure les offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Pour les contrats d’assurance souscrits antérieurement, la faculté de résiliation annuelle s’appliquera au 1er janvier 2018.
À noter :
depuis le 2 septembre 2015, les anciens malades atteints de certains cancers n’ont plus à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur. Ce droit constitue une avancée majeure pour ces personnes car il leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, leur protocole thérapeutique doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 18 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas.
Des économies conséquentes
Généralement, si les emprunteurs cherchent à obtenir un taux de crédit le plus bas possible, ils négligent encore trop souvent leur assurance-emprunteur. Il s’agit pourtant d’un moyen de réaliser des économies conséquentes. En effet, comme les taux des crédits immobiliers sont particulièrement bas, le coût de l’assurance-emprunteur pèse de plus en plus dans un projet de financement. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à comparer l’assurance de groupe proposée par sa banque aux contrats individuels offerts par d’autres établissements. Dans la plupart des cas, les contrats proposés par les banques sont assez chers. En cause : le montant des cotisations d’assurance est le même pour tous les adhérents, peu importent leur âge ou leur profession. En faisant appel à la délégation d’assurance, l’économie réalisée peut dépasser plusieurs milliers d’euros, surtout si l’emprunteur est jeune et en bonne santé.
Une délégation sous conditions
Une banque n’est tenue d’accepter une délégation d’assurance-emprunteur que si le nouveau contrat souscrit présente un niveau de garanties équivalent à celui de son propre contrat. Afin d’établir un contrat d’assurance répondant à cette contrainte, l’emprunteur a tout intérêt à se procurer auprès de sa banque la fiche standardisée d’informations ainsi que la fiche personnalisée. Des documents contenant la liste des critères d’équivalence des garanties minimales exigées en termes notamment de couvertures décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie, etc.
Par ailleurs, la mise en place d’une délégation d’assurance-emprunteur peut être également l’occasion de chercher à obtenir de meilleures garanties, notamment à améliorer la quotité, c’est-à-dire la répartition de la couverture du prêt (sachant que 100 % du prêt doivent être couverts). Par exemple, un couple qui emprunte pour acquérir sa résidence principale répartit la quotité à 50 % par tête. Cela signifie que si l’un des deux époux décède ou est dans l’incapacité d’assumer sa part, alors 50 % des mensualités seront honorées par l’assurance. En déléguant, pour un niveau de cotisations quasiment équivalent, il peut être possible de passer à une quotité supérieure par tête.
Une déclaration sincère
Pour tenter d’obtenir les meilleures garanties et tarifs possibles, il peut être tentant d’occulter volontairement une partie de son dossier médical ou de ne pas mentionner la pratique de certaines activités à risques. Mauvaise idée ! En effet, lors de la souscription d’un contrat d’assurance, l’assuré est obligé de répondre avec sincérité aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, pour qu’il puisse apprécier les aléas qu’il prend en charge. Ainsi, une déclaration mensongère ou un oubli volontaire peut constituer une fraude à l’assurance. Concrètement, si la mauvaise foi est démontrée, le contrat d’assurance est annulé rétroactivement et l’ensemble des cotisations versées sont conservées par l’assureur. Plus grave encore, sachant que le prêt n’est plus assuré, la banque peut décider de l’annuler et demander son remboursement intégral et immédiat.
Délégation d’assurance, mode d’emploi
Demander une délégation d’assurance-emprunteur auprès de sa banque est relativement simple : après avoir négocié un contrat auprès d’un autre établissement, l’emprunteur doit notifier, par lettre recommandée, à la banque sa demande de résiliation et de substitution d’assurance au plus tard 15 jours avant le terme de la première année du contrat ou la date anniversaire du contrat (en cas de résiliation annuelle). L’emprunteur ayant pris soin de joindre à sa demande le devis édité par le nouvel assureur.
À réception, la banque dispose, quant à elle, de 10 jours pour informer l’emprunteur de sa décision d’acceptation ou de refus (pour cause de garanties non équivalentes). Et en cas d’acceptation, la substitution du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision de l’établissement bancaire.
Exemple :
emprunt de 150 000 € sur 15 ans par un couple de 40 ans dont l’un est fumeur, l’autre non, et disposant d’un bon dossier (50 % sur chaque tête)
Évolution du coût d’un crédit immobilier
| Taux hors assurance | Coût crédit hors assurance | Taux assurance groupe | Taux assurance déléguée | Coût assurance groupe | Coût assurance déléguée | Part de l’assurance | Mensualité | |
| Mars 2013 | 2,85 % | 34 515 € | 0,36 % | 0,15 % | 8 100 € | 3 375 € | 23 % / 10 % | 1 070 € / 1 043 € |
| Mars 2015 | 2,15 % | 25 618 € | 0,36 % | 0,15 % | 8 100 € | 3 375 € | 31 % / 13 % | 1 020 € / 994 € |
| Mars 2017 | 1,45 % | 16 993 € | 0,36 % | 0,15 % | 8 100 € | 3 375 € | 48 % / 20 % | 972 € / 946 € |
Source : www.meilleurtaux.com
L’option pour l’impôt sur les sociétés d’une SCI
Les résultats d’une société civile immobilière (SCI) sont normalement soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés, dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de leur quote-part dans la société, et ce indépendamment de leur perception effective par ces derniers. Cependant, les associés peuvent choisir d’imposer les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés.
Intérêt de l’option
L’option permet notamment de soumettre les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés après déduction d’un ensemble de charges, dont l’amortissement du bien immobilier.
L’un des intérêts de l’option pour l’impôt sur les sociétés est de permettre aux associés de maîtriser leur imposition personnelle sur les résultats. En effet, en cas d’option, la société est taxée à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices (au taux de 15 % ou de 33 1/3 %, selon les cas). Mais les associés ne sont, eux, soumis à une imposition personnelle sur les bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu que s’ils sont distribués sous forme de dividendes. À défaut de distribution, ils ne subissent donc, à leur niveau, aucune imposition.
Autre avantage de l’option, la base d’imposition de la SCI peut être diminuée grâce à des déductions spécifiques, au titre notamment des rémunérations allouées aux associés ou de l’amortissement du bien immobilier.
À noter :
les rémunérations des associés sont imposées à l’impôt sur le revenu entre les mains de chaque bénéficiaire.
Les associés d’une SCI peuvent, en outre, choisir d’opter pour l’impôt sur les sociétés afin de bénéficier d’un régime fiscal exclusivement réservé aux sociétés soumises à cet impôt. C’est le cas, par exemple, du régime de l’intégration fiscale.
Effets de l’option
L’option, irrévocable, donne lieu, en principe, à une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
Une fois exercée, l’option revêt un caractère irrévocable. Les associés ne peuvent plus revenir dessus, aucune cause de retrait du bénéfice de l’option n’étant prévue.
À noter :
l’irrévocabilité est attachée à la personnalité morale de la société. Par exemple, en cas de transformation n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle, l’option reste valable et lie la société sous sa nouvelle forme.
Par ailleurs, l’option donne lieu, en principe, à une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
Bénéfices non encore taxés
À ce titre, le résultat non encore taxé est établi pour la période d’imposition précédant immédiatement le changement de régime fiscal. Par dérogation, les produits acquis et non encore perçus (loyers courus non échus, par exemple) lors du changement de régime sont immédiatement taxables et les dépenses engagées non encore payées (frais d’emprunt d’acquisition d’un immeuble, notamment) sont déductibles des derniers résultats imposables à l’impôt sur le revenu. À l’inverse, les encaissements et les paiements relatifs à des créances et dettes à naître après le changement de régime ne doivent pas être pris en compte.
Plus-values latentes
En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, l’imposition des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé peut être reportée, notamment jusqu’à la cession des biens concernés, si certaines conditions sont satisfaites. En pratique, en cas de choix pour le report d’imposition, les biens concernés doivent ainsi être inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la SCI pour leur valeur d’origine. Cette inscription comporte, d’une part, la valeur des biens, et d’autre part, les amortissements et provisions qui auraient pu être déduits si la SCI avait été soumise à l’impôt sur les sociétés dès leur acquisition. Le montant des amortissements déductible est donc limité à la valeur résiduelle des biens ainsi constatée, l’autre fraction étant réputée déduite avant le changement de régime. Au contraire, si les associés choisissent d’imposer immédiatement les plus-values latentes sur les biens inscrits au patrimoine social de la SCI, les biens concernés sont réévalués et sont inscrits au bilan d’ouverture pour leur valeur vénale. Sachant que le choix entre l’imposition immédiate ou le report d’imposition est global, et ne s’effectue pas élément par élément.
Formalisme de l’option
Pour être valable, l’option doit être exercée conformément à un certain formalisme.
La SCI doit notifier son option pour l’impôt sur les sociétés au service des impôts du lieu de son principal établissement. Notification devant intervenir au plus tard avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt. L’option peut également être exercée avant le début de l’exercice à partir duquel elle produira ses effets. Dans tous les cas, l’administration fiscale en délivre récépissé à la société.
Précision :
l’administration autorise une SCI à clôturer son exercice de façon anticipée afin que ses associés puissent opter pour l’impôt sur les sociétés dans les 3 mois suivant cette clôture.
Pour être valable, la notification doit, en outre, comporter un certain nombre de mentions, à savoir :- la désignation de la SCI et l’adresse de son siège social ;- les noms, prénoms et adresse de chaque associé ;- la répartition du capital social.
Enfin, la notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts de la SCI. Si ces derniers ne prévoient aucune modalité particulière pour l’exercice de l’option, la signature de tous les associés est alors requise.
À savoir :
la SCI a le choix de notifier son option soit auprès de son service des impôts, soit auprès de son centre de formalités des entreprises (CFE). Dans ce dernier cas, elle doit alors impérativement cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire de modification adressé au CFE.
En outre, la SCI doit, dans un délai de 60 jours à compter du changement de régime, fournir à l’administration les déclarations et documents qu’elle est normalement tenue de souscrire au titre d’une année d’imposition. Elle doit notamment communiquer la déclaration de résultat n° 2072 correspondant au dernier exercice soumis à l’impôt sur le revenu, ainsi que le bilan d’ouverture du premier exercice relevant de l’impôt sur les sociétés.
Précision :
c’est au sein de ce premier bilan que la société matérialise son choix entre l’imposition immédiate ou le report d’imposition des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
L’administration a précisé que ce délai de 60 jours court à compter de la notification de l’option. Cette date s’entendant de celle à laquelle la société a expédié son courrier d’option à l’administration et non de la date à laquelle cette dernière l’a reçu. Et si l’option a été formulée avant le début de l’exercice concerné, le délai de 60 jours court à compter du 1er jour de cet exercice. Ce délai de 60 jours est un délai non franc qui inclut, selon le cas, le jour de notification de l’option ou le 1er jour de l’exercice relevant de l’impôt sur les sociétés lorsque l’option est antérieure à cette date.
Assurance-vie en euros : le bilan de l’année 2016
Les rendements des fonds en euros sont une nouvelle fois en baisse.
Les performances des différents fonds en euros ont été dévoilées. Sans surprise, les résultats pour 2016 ne sont pas au rendez-vous : en effet, ces fonds ont rapporté 1,8 % en moyenne. Un rendement en chute de 0,5 point par rapport à 2015. Concrètement, la baisse des rendements des fonds en euros est due à la combinaison de deux facteurs.
D’une part, les revenus des fonds en euros, assurés essentiellement par des supports obligataires dont les taux sont eux-mêmes en repli, s’érodent d’année en année.
D’autre part, les assureurs ont répondu à l’appel du gouverneur de la Banque de France à faire preuve de modération et de réalisme dans la fixation des taux de rendement qu’ils serviront aux épargnants au titre de 2016.
Une collecte en repli
L’année 2016 n’a pas été un grand millésime pour l’assurance-vie. En effet, selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, ce placement a engrangé 16,8 milliards d’euros (collecte nette) seulement, dont 14,1 milliards d’euros rien qu’en unités de compte. Soit globalement 6,8 milliards d’euros de moins qu’en 2015. Un désamour des épargnants qu’expliquerait en partie la baisse continue des taux de rendement des contrats et fonds en euros de ces dernières années.
Les rendements 2016 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
| Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
| 2016 | 2015 | ||
| Afer | Compte Afer | 2,65 % | 3,05 % |
| Agipi / Axa | Cler | 2,25 % | 2,50 % |
| Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 2,10 % | 2,40 % |
| Areas | Multisupport 3 | 2 % à 2,60 % | 2,40 % à 3,40 % |
| Asac Fapes Diffusion | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,80 % | 3,02 % |
| Allianz Vie | Gaipare | 2,90 % | 3,15 % |
| Axa | Figures Libres | 2 % à 2,50 % | 2,20 % |
| BforBank | BforBank Vie | 2,17 % | 2,66 % |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,70 % à 1,85 % | 2,19 % |
| Boursorama.com | Boursorama Vie | 2,25 % | 2,75 % |
| Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,80 % | 2,30 % |
| CNP / La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 1,95 % à 2,17 % | 2,45 % à 2,65 % |
| Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 | 1,30 % | 1,80 % |
| Gan Vie | Chromatys | 1,50 % à 2,50 % | 1,80 % à 2,80 % |
| Generali Vie | Xaélidia (euro épargne) | 2,07 % | 2,52 % |
| GMF Vie | Multéo | 2,50 % | 2,80 % |
| Gresham | Concordances 4 | 2,07 % | 2,50 % |
| Groupama | Groupama Modulation | 1,50 % à 2,50 % | 1,80 % à 2,80 % |
| HSBC | Évolution Patrimoine | 2,46 % à 2,72 % | 2,18 % à 2,44 % |
| ING Direct | ING Direct Vie | 2,25 % | 2,75 % |
| LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 1,40 % à 1,80 % | 1,90 % à 2,30 % |
| MACIF | Mutavie Actiplus | 1,80 % | 2,40 % |
| MAAF VIE | Winalto | 2,35 % | 2,75 % |
| Matmut | Matmut Vie Épargne | 2,20 % | 2,50 % |
| MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 2,60 % | 3,30 % |
| MMA Vie | Multisupports | 2,01 % à 2,51 % | 2,35 % à 2,85 % |
| Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 2,25 % | 2,75 % |
| Mutex (Mutualité française) | Mutex Patrimoine | 1,80 % | 2,40 % |
| Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 2,30 % | 2,75 % |
| SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,05 % | 2,67 % |
| Société Générale / Sogecap | Séquoia | 1,30 % à 1,50 % | 2,06 % à 2,10 % |
| Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 2,30 % | 2,90 % |
| UAF Life Patrimoine | Arborescence | 2,01 % | 2,55 % |
| Vie Plus | Patrimoine Vie Plus | 2,05 % | 2,60 % |
Comment vendre des parts de SCPI ?
Les modalités de sortie d’une société civile de placement immobilier dépendent de la forme de son capital.
Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) connaissent un certain succès auprès des épargnants. Et pour cause, le rendement qu’elles offrent, 4,85 % en moyenne en 2015, constitue un argument de poids. Mais bien que les SCPI présentent des avantages indéniables, leurs parts peuvent parfois se révéler difficiles à céder.
Vente de parts de SCPI à capital fixe
Un épargnant qui désire vendre des parts de SCPI à capital fixe dispose de deux options : soit il s’adresse à la société de gestion de la SCPI, soit il propose lui-même ses parts à la vente. Dans le premier cas, la société de gestion inscrit son ordre de vente dans un registre dédié. Et périodiquement, elle procède à une confrontation des ordres de vente et d’achat inscrits sur ce registre. Cette confrontation permet de déterminer un prix d’exécution, c’est-à-dire le prix qui permet d’échanger le plus grand nombre de parts. Une fois le prix d’exécution fixé, les offres d’achat et de vente au prix d’exécution sont réalisées. Sont exécutés en priorité les ordres d’achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas.
Dans le second cas, le titulaire de parts les vend lui-même à la personne de son choix et aux conditions qu’il négocie. Mais attention, pour que l’opération se boucle, le plus souvent, la société doit agréer l’acheteur. Une décision qu’elle doit prendre dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de cession. Sachant qu’en cas de refus, elle doit soit trouver un autre acheteur, soit racheter elle-même les parts. Précisons qu’aucun agrément ne peut toutefois être imposé dans le cadre d’une succession, de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire ou d’une cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
Vente de parts de SCPI à capital variable
La vente de parts de SCPI à capital variable est plus simple : la société de gestion se charge de l’ensemble des formalités. Là encore, le vendeur transmet son ordre de vente à la société de gestion qui l’exécute à un prix fixé à l’avance.
En principe, pour que le retrait de l’associé ait lieu, son départ doit être compensé par des souscriptions nouvelles. Si tel n’est pas le cas, la société de gestion peut rembourser la valeur des parts en puisant dans un fonds dit « de remboursement ». Et si la société de gestion est dans l’impossibilité de rembourser les parts et qu’au moins 10 % des parts de SCPI en attente de revente ne sont pas traitées, elle peut convoquer une assemblée générale des associés afin de mettre en place un marché secondaire.
SCPI et assurance-vie
Selon leur nature, il peut être plus ou moins difficile et long de revendre des parts de SCPI détenues en direct. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’en souscrire par le biais d’une assurance-vie. Bon nombre d’assureurs proposent en effet des unités de compte dédiées à ce type de placement. Dans ce cadre, la liquidité des parts de SCPI est bien plus forte puisque l’assureur est tenu de les racheter, qu’il ait ou non trouvé un acquéreur.
Pourquoi et comment renoncer à une succession ?
Dans certains cas, les héritiers ont tout intérêt à renoncer à un héritage.
Toute personne est libre de refuser une succession. Cette renonciation peut être motivée par plusieurs raisons : un passif successoral important ou encore la volonté de transmettre ses droits à la génération suivante. Zoom sur la marche à suivre pour renoncer à une succession et sur les conséquences d’une telle opération.
Les effets d’une renonciation
L’héritier qui renonce à sa part successorale est censé n’avoir jamais été héritier. Ce qui signifie que ses droits reviennent à ses représentants (ses enfants ou ses frères et sœurs). Et si le renonçant ne peut pas être représenté, sa part successorale est alors dévolue aux héritiers dits subséquents (neveux et nièces, cousins…). Précision importante, les héritiers venant en représentation se partagent l’abattement fiscal personnel du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession. Mais attention, la renonciation ne remet pas en cause, en principe, les donations ou les legs que le défunt a pu consentir à l’héritier renonçant. Ainsi, un héritier peut très bien renoncer à une succession sans renoncer pour autant à un legs.
Les démarches à accomplir
La renonciation à une succession ne se présume pas. Ainsi, le renonçant doit clairement exprimer sa volonté auprès du greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession en lui adressant un formulaire dédié (Cerfa n° 14037*02) accompagné d’un certain nombre de pièces administratives comme une copie intégrale de l’acte de décès et de l’acte de naissance du renonçant.
En pratique, l’héritier dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour accepter ou refuser une succession. À l’issue de ces 4 mois, tout héritier, tout créancier ou même l’État peut, par acte d’huissier, mettre en demeure l’intéressé de prendre position. Sans réponse de sa part dans un délai de 2 mois, ce dernier est considéré comme acceptant. À l’inverse, à défaut de sommation et de démarches pour accepter ou renoncer à la succession réalisées dans un délai de 10 ans à compter du décès, l’héritier est supposé y avoir renoncé.
Il faut savoir également que l’héritier renonçant a la possibilité de revenir sur sa décision si certaines conditions sont réunies : le droit d’accepter la succession ne doit pas être prescrit (10 ans), les autres héritiers ne doivent pas avoir accepté la succession et l’État ne doit pas avoir été envoyé en possession (succession attribuée à l’État).
Attention :
même si un héritier a l’intention de renoncer à une succession, certains de ses actes peuvent être regardés comme la manifestation de sa volonté de l’accepter. L’acceptation est alors qualifiée de tacite, ses actes traduisant la volonté d’administrer les biens hérités. Typiquement, il s’agit de la situation dans laquelle un héritier cède, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de ses droits successoraux (vente d’un bien immobilier, d’objets…).
La répartition des travaux entre bailleur et locataire
Le bailleur doit assumer les grosses réparations et le locataire les réparations d’entretien.
En tant que bailleur, vous avez peut-être déjà été confronté à la question de la prise en charge des travaux à réaliser dans un logement que vous louez. Sachez que des règles de répartition entre bailleur et locataire sont prévues par les textes.
La répartition des travaux
En cours de bail, vous devez entretenir le logement et effectuer toutes les réparations nécessaires à son maintien en état. Concrètement, cela signifie que vous devez prendre en charge les réparations qui ne sont pas imputables à une faute du locataire. Par exemple, sont à votre charge les grosses réparations, parmi lesquelles figurent les réparations urgentes (panne de chaudière…), les travaux d’amélioration (ravalement, réfection de la cage d’escalier) et les travaux d’entretien normal du logement (volets défectueux, robinetterie). De son côté, le locataire est tenu de financer tous les travaux d’entretien courant du logement, sauf s’ils sont occasionnés notamment par la vétusté, une malfaçon ou un vice de construction. Typiquement, il s’agit du maintien en état de propreté, de la réalisation de raccords de peinture, de la maintenance de la chaudière, etc. Pour faciliter les rapports entre bailleur et locataire, les pouvoirs publics ont dressé une liste des réparations locatives (annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987). Attention toutefois, car cette liste est loin d’être exhaustive !
Les sanctions encourues
Si vous ne remplissez pas votre obligation de prise en charge des grosses réparations, le locataire peut, après avoir recherché une solution amiable (envoi de mises en demeure, saisine de la commission départementale de conciliation), saisir le tribunal d’instance du lieu de situation du logement loué. Le juge pourra alors vous condamner, sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires, ou autoriser votre locataire à les faire directement réaliser à vos frais.
À l’inverse, si c’est le locataire qui n’a pas rempli ses obligations et a dégradé les lieux, ce n’est malheureusement qu’à la fin du bail, avec l’état des lieux de sortie, que vous pourrez vous en rendre compte. Dans ce cas de figure, le locataire devra procéder aux réparations locatives qui s’imposent avant la restitution des clés. À défaut, vous pourrez retenir le dépôt de garantie versé au moment de la conclusion du bail. Et si ces sommes ne sont pas suffisantes, vous aurez la possibilité de demander en justice une indemnisation complémentaire.
Certains travaux sont soumis à autorisation
Sachez que le locataire a le droit d’aménager son logement (peinture, fixation de cadres, changement d’une moquette...). Des aménagements qui ne requièrent pas votre autorisation. En revanche, votre accord est nécessaire lorsque les travaux ont pour objet de transformer le local (percement d’une fenêtre, démolition d’une cloison). Si votre locataire ne vous a pas sollicité, vous pouvez soit profiter de ces transformations sans l’indemniser, soit exiger la remise en état des lieux à ses frais.
Pourquoi investir dans l’immobilier portugais ?
Les faibles prix de l’immobilier portugais attirent les acquéreurs étrangers.
Depuis quelques années, le Portugal est une destination prisée de nombreux Européens qui viennent y chercher, au-delà d’un niveau d’ensoleillement élevé, des opportunités d’investissement. Zoom sur le marché de l’immobilier lusitanien.
Un marché immobilier en effervescence
Après avoir subi de plein fouet la crise économique, le Portugal se redresse lentement. Mais malgré le retour de la croissance en 2014, les prix de l’immobilier restent encore à des niveaux très abordables. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’investir une partie de ses économies dans une résidence secondaire pour profiter de la douceur de vivre du Portugal et pour valoriser et diversifier son patrimoine. À titre d’illustration, le prix moyen observé pour un appartement neuf de bonne qualité situé dans la banlieue de Lisbonne s’établit aux alentours de 2 500 €/m² (1 500 €/m² pour de l’ancien). Dans les quartiers les plus prisés de la capitale portugaise, les prix peuvent toutefois « grimper » jusqu’à 5 000 €. Quant à ceux qui souhaitent s’offrir un pied-à-terre à Porto ou dans sa région, ils peuvent trouver des villas proposées autour de 1 600 €/m². Comparativement, on peut obtenir un appartement « ancien » à Cassis (Bouches-du-Rhône) pour 5 000 €/m² ou à Paris pour 8 000 €/m². Le rapport qualité/prix du mètre carré portugais reste donc très attractif !
Attention :
investir au Portugal ne s’improvise pas ! Il est recommandé de s’adresser à un professionnel implanté dans le pays. Ce dernier pourra proposer des biens sélectionnés pour leur qualité et/ou des programmes immobiliers dédiés à l’investissement locatif.
L’intérêt d’un investissement locatif
Autre solution, l’investissement locatif, qui ne manque pas non plus d’intérêt. En privilégiant, par exemple, un achat dans le centre historique de Lisbonne, là où le flux de touristes est important, on peut espérer obtenir un rendement locatif brut de 4 % à 6 % (en moyenne 2 % à 3 % en France). Car le marché locatif du pays se porte plutôt bien. L’une des raisons réside dans le fait que le marché du travail au Portugal s’est fortement contracté. Par conséquent, les Portugais éprouvent des difficultés à obtenir des crédits immobiliers pour acquérir leur résidence principale. Ils sont donc plus nombreux à se diriger vers la location. Ce qui assure à l’investisseur un bien immobilier occupé de façon régulière.
Une fiscalité légère
Pour dynamiser l’économie et attirer des investisseurs étrangers, le Portugal a mis en place un régime fiscal attractif : le régime du résident non habituel. Ce régime permet aux résidents portugais qui perçoivent des pensions de retraite de source étrangère d’être exonérés d’impôt sur le revenu pendant 10 ans. Pour être considéré comme résident sur le territoire portugais, il faut soit séjourner dans le pays plus de 183 jours par an, soit être propriétaire d’une habitation et l’occuper en tant que résidence principale. Cette exonération d’impôt ne concerne toutefois que les pensions de retraite du privé. Ainsi, les « pensionnés » de la fonction publique ne peuvent bénéficier de ce régime fiscal avantageux.
Pourquoi ne pas adopter une clause bénéficiaire à options ?
Recourir à la clause bénéficiaire à options peut permettre de transmettre le capital d’une assurance-vie dans de bonnes conditions.
Lors de la conclusion d’une assurance-vie, le souscripteur désigne, dans le bulletin d’adhésion, le(s) bénéficiaire(s) du contrat. Le plus souvent, cette désignation s’opère en utilisant une formule type qui prévoit que « les sommes seront transmises en priorité au conjoint survivant, à défaut, aux enfants vivants ou représentés, et à défaut, aux autres héritiers ». Une clause limitée qu’il est possible d’abandonner pour adopter une clause sur mesure.
Les inconvénients de la clause standard
En présence de cette clause standard, les capitaux seront entièrement attribués au bénéficiaire de premier rang (à savoir le conjoint survivant), laissant les bénéficiaires de second rang (les enfants…) simples spectateurs. Ce n’est que si le conjoint renonce à percevoir ces sommes, ou s’il est décédé avant d’avoir accepté, que ces derniers les recueilleront.
Or le conjoint survivant n’a peut-être pas besoin de recevoir l’ensemble des capitaux figurant au contrat et peut souhaiter en faire bénéficier en partie ses enfants.
Dans cette hypothèse, et plus généralement lorsque les préoccupations patrimoniales du souscripteur et du bénéficiaire sortent du schéma d’attribution « classique », la clause standard trouve alors très vite ses limites.
L’intérêt de recourir à la clause à options
Grâce à une clause à options, il est possible de désigner un bénéficiaire qui aurait, par exemple, le choix de recueillir, en pleine propriété ou en usufruit, la totalité du capital du contrat ou une quotité déterminée (¾, ½, ¼) seulement. Dans le cas où il n’accepterait pas ou n’accepterait que l’une des quotités ci-dessus précisées, les capitaux (restants) pourraient alors bénéficier aux enfants du souscripteur par parts égales. Et dans l’hypothèse où il n’accepterait le capital qu’en usufruit, la nue-propriété pourrait bénéficier aux enfants. Au final, cette clause offre de nombreuses possibilités, avec pour seule limite l’imagination du souscripteur !
Un manque d’information
La clause bénéficiaire à options ne connaît pas, pour l’instant, le succès qu’elle mérite. Pour cause, la plupart des contrats d’assurance-vie sont souscrits par le biais des établissements bancaires et des compagnies d’assurance. Et par souci de simplification, ces établissements ne proposent que trop souvent la fameuse clause bénéficiaire standard, sans en expliquer tous les tenants et les aboutissants.
N’hésitez donc pas à opposer à votre conseiller la possibilité de mettre en place une clause à options !
Remarque :
le fait que le bénéficiaire n’accepte qu’une partie des capitaux, et donc attribue indirectement les sommes restantes aux bénéficiaires de second rang, ne constitue en aucun cas un avantage taxable. Une requalification de l’administration fiscale n’est donc pas à craindre sur ce point.
Comment payer moins d’impôt en 2017 ?
En cette période de déclaration de revenus, chacun est amené à calculer le montant des impôts qu’il doit acquitter pour l’année 2015. S’il est trop tard pour en atténuer la charge, il est, en revanche, encore temps de procéder à certains investissements ou de consentir certaines dépenses qui permettront de bénéficier, pour l’an prochain, de crédits ou de réductions d’impôt. Découvrez les principaux dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre jusqu’au 31 décembre 2016 afin d’alléger votre prochaine feuille d’imposition.
Investir dans l’immobilier
L’investissement locatif est un moyen efficace pour se constituer un patrimoine tout en réduisant le montant de son impôt.
Divers placements s’offrent à vous dans le secteur de l’immobilier locatif. Avant toute chose, ayez à l’esprit que, quel que soit le dispositif choisi, vous achetez un logement et non une réduction d’impôt. Ainsi, la souscription d’un produit de défiscalisation ne doit jamais vous faire oublier les règles de base applicables à tout achat immobilier (emplacement, qualité du bien, charges, facilité de revente…). À défaut, vous risqueriez de perdre, à la revente, davantage que les gains fiscaux réalisés.
Le dispositif « Pinel »
Si vous faites construire ou si vous achetez un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement afin de le louer, vous pouvez recourir au dispositif « Pinel ». Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, à condition que vous vous engagiez à louer votre logement pour une durée minimale de 6 ou 9 ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de votre déclaration de revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, étant irrévocable.
Vous pouvez, en outre, à l’issue de cette période d’engagement de location de 6 ou 9 ans, décider de prolonger votre engagement initial jusqu’à 12 ans, par période de 3 ans. L’avantage fiscal est alors modulé et réparti en fonction de la durée choisie pour votre engagement de location. Le taux étant de 12 % pour un engagement de location de 6 ans, de 18 % pour 9 ans et de 21 % pour 12 ans (outre-mer, ces taux sont respectivement portés à 23 %, 29 % et 32 %). Sachant que le montant total de l’investissement est plafonné à 300 000 € par an, dans la limite de deux logements.
L’assiette de la réduction d’impôt est également plafonnée à un prix au mètre carré de surface habitable fixé à 5 500 €.
Et attention, si le montant annuel de la réduction excède celui de l’impôt dû au titre de la même année, l’excédent ne peut pas être imputé sur votre impôt sur le revenu des années suivantes ni donner lieu à un remboursement.
En contrepartie de la réduction d’impôt, vous devrez respecter un certain nombre de conditions (obligation de louer le logement non meublé à titre d’habitation principale, respect de plafonds de loyers et de revenus des locataires, localisation et performance énergétique du logement…).
Précision :
les contribuables qui déclarent en ligne leurs revenus sont dispensés, le cas échéant, de joindre les justificatifs des dépenses ouvrant droit à un avantage fiscal. Ils sont toutefois tenus de les conserver et de les présenter à l’administration fiscale si elle en fait la demande. Ceux qui utilisent la déclaration papier doivent, en revanche, produire certains justificatifs, notamment pour le dispositif Pinel (copie du bail, copie de l’avis d’imposition du locataire, par exemple).
Le dispositif « Censi-Bouvard »
En investissant dans un ou plusieurs logements neufs, en l’état futur d’achèvement ou réhabilités faisant partie d’une résidence de services (résidence pour étudiants, pour personnes âgées ou handicapées, résidence de tourisme classée…) pour les louer, vous pouvez obtenir une réduction d’impôt égale à 11 % du prix de revient du ou des logements, retenu dans la limite globale annuelle de 300 000 €. Une réduction qui sera étalée par parts égales sur 9 ans.
Si le montant annuel de la réduction excède celui de l’impôt dû au titre de la même année, l’excédent pourra, cette fois, être imputé sur votre impôt sur le revenu des années suivantes, jusqu’à la 6e incluse.
Mais attention, pour bénéficier de cet avantage fiscal, vous devrez notamment vous engager à louer le bien meublé à l’exploitant de la résidence pour une durée minimale de 9 ans.
Équiper son logement
Améliorer la qualité environnementale de son logement peut permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Les particuliers propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour certains travaux d’amélioration de la qualité environnementale (matériaux d’isolation thermique, chaudières à haute performance énergétique, équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable…) réalisés dans leur résidence principale, lorsqu’elle est située en France et achevée depuis plus de 2 ans. Le taux de ce crédit d’impôt est fixé à 30 % et s’applique à toutes les dépenses éligibles.
Le montant de ces dernières est toutefois plafonné, par période de 5 années consécutives et pour un même logement, à 8 000 € pour un célibataire et à 16 000 € pour un couple. Ces plafonds étant majorés de 400 € par personne à charge.
Investir dans une PME
Une réduction d’impôt est accordée aux contribuables qui consacrent une partie de leur épargne au financement des entreprises.
Pour réduire la note fiscale, vous avez également la possibilité d’investir dans les PME de moins de 7 ans. Les versements en numéraire effectués lors de la constitution ou des augmentations de capital de ces entreprises ouvrant droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Mais attention, un associé ou un actionnaire ne peut pas souscrire aux augmentations de capital de sa propre société, sauf exception.
La réduction est égale à 18 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour ceux qui sont mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune. Et vous devrez conserver vos titres pendant au moins 5 années.
Investir pour votre retraite
Afin d’inciter les particuliers à préparer leur retraite, certains produits d’épargne bénéficient d’un cadre fiscal avantageux.
Plusieurs dispositifs vous encouragent à vous constituer une retraite supplémentaire à des conditions fiscales avantageuses en vous permettant de déduire une partie de votre effort d’épargne soit de vos revenus professionnels (contrats Madelin), soit de votre revenu global (Perp). Dans ce dernier cas, les cotisations sont déductibles du revenu net global dans la limite, pour les versements effectués en 2016, du plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels de 2015, retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) de 2015, soit une déduction maximale de 30 432 € ;- ou 10 % du Pass de 2015, soit une déduction maximale de 3 804 €.
Autres dispositifs
Il existe de nombreuses solutions pour réduire le montant de son impôt. Mais le montant global des avantages fiscaux procurés par ces dispositifs est plafonné.
Au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, il existe bien d’autres solutions de défiscalisation, et notamment des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer, les Sofica (investissement dans le cinéma) ou encore le dispositif « Malraux ». Souvent performants, ils doivent cependant être maniés avec précaution. D’autant plus que certains dispositifs ne peuvent pas se cumuler entre eux et que le montant des avantages fiscaux accordés au titre de l’impôt sur le revenu est, en principe, plafonné. Pour les avantages souscrits en 2016 et déclarés en 2017, la diminution d’impôt ne peut ainsi être supérieure à 10 000 € (18 000 € en cas d’investissement outre-mer notamment). En cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt est définitivement perdu.
Faut-il se laisser séduire par les placements atypiques ?
S’appuyant sur des actifs tangibles, les placements atypiques peuvent permettre de doper le rendement de son épargne. Des placements qu’il faut toutefois manier avec prudence.
Depuis quelques années, le marché de la voiture de collection a littéralement explosé. Par exemple, une Ferrari 250 GT de 1961 s’est ainsi vendue, le 6 février 2015, à 16 288 000 €. Des ventes records du fait de passionnés de mécanique mais aussi d’investisseurs qui voient l’automobile comme une valeur refuge. Toutefois, cette nouvelle mode de placement, dans des biens tangibles, ne s’arrête pas aux voitures et gagne de nouveaux marchés. Explications.
La promesse des placements atypiques
Les placements atypiques s’appuient sur des actifs tangibles qui ne sont pas utilisés dans des stratégies d’épargne classiques. Il peut s’agir, par exemple, de bouteilles de vin, de chevaux de course, de manuscrits ou de terres rares. Concrètement, la proposition de ces sociétés est simple : en échange d’une somme d’argent, l’investisseur devient propriétaire (ou copropriétaire) du bien. L’objectif étant, à terme, de réaliser une forte plus-value lors de sa revente. La formule est séduisante car elle permet de diversifier son patrimoine tout en réalisant un investissement concret. Un caractère tangible qui « rassure » l’investisseur et comble son désir de propriété. Le côté séduisant de ces placements étant quelquefois renforcé par des dispositifs fiscaux incitatifs.
Les risques liés aux placements atypiques
Mais problème, la présentation de la promesse est souvent simpliste et n’insiste pas sur l’inconvénient majeur d’un tel investissement : l’absence de marchés régulés. En effet, alors que les produits financiers sont encadrés et que leurs valeurs résultent des règles qui régissent les marchés financiers, les placements atypiques s’échangent, quant à eux, de gré à gré sur des marchés très étroits. En clair, il est très difficile de connaître la valeur de ces biens sans être accompagné par des experts.
Autre inconvénient, ces marchés sont soumis à une forte volatilité. Par exemple, dans le domaine du vin, la bouteille de « Château Mouton Rothschild » 1961 cotait, en 2012, près de 1 630 €. Début 2016, sa valeur est retombée à 885 €. Comme l’indique très clairement l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans ses alertes, il n’existe pas de rendement élevé sans risques importants : un risque de perte partielle ou totale du capital investi et un risque de défaut de liquidité.
L’AMF veille au grain
Ces dernières années, de nombreuses arnaques (contrefaçon d’un bien, commercialisation d’un bien inexistant) liées aux placements atypiques ont vu le jour. Résultat, des centaines d’épargnants ont perdu leur mise de départ. C’est la raison pour laquelle l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie régulièrement sur son site Internet des alertes mettant en garde le public contre les activités de certaines sociétés non habilitées à commercialiser ces produits. N’hésitez pas à le consulter ( ) !
À noter :
bien que risqués, certains placements atypiques peuvent offrir de réelles opportunités d’investissement. Mais intervenir sur ces marchés spécifiques nécessite d’être accompagné. N’hésitez donc pas à contacter le Cabinet.
Investir dans une résidence pour seniors
Un investissement séduisant répondant à des enjeux de société importants.
Selon les projections de l’Insee, en 2050, un Français sur trois sera âgé de 60 ans ou plus. Des chiffres qui incitent à penser que des opportunités sont peut-être à saisir du côté des résidences pour seniors.
Des promesses de rendement
Lorsque vous investissez dans une résidence pour seniors, vous devenez propriétaire d’un logement meublé destiné à accueillir des personnes âgées et autonomes. Ces résidences leur proposant un lieu comprenant des équipements modernes et des services assurant une certaine qualité de vie : restauration, jardin, piscine, salle de sports, bibliothèque, activités culturelles, etc. Lors de l’achat (comptez entre 150 000 € et 220 000 € pour un deux-pièces de 40 m²), vous signez, dans le même temps, un bail commercial avec un exploitant qui se chargera de sa gestion : recherche de locataires, entretien de la résidence, etc. Sachant que vous pouvez espérer un rendement brut compris entre 3 % et 5 %. Par ailleurs, vous pourrez soit bénéficier, pour cet investissement, d’une réduction d’impôt au titre du dispositif Censi-Bouvard, soit, par défaut, profiter du statut fiscal de loueur en meublé non professionnel (LMNP).
Des points de vigilance
Si cet investissement vous séduit, il faut, avant de vous engager, passer en revue un certain nombre de points. Tout d’abord, la réussite de votre investissement passe par le choix de l’emplacement du programme immobilier. Les futurs résidents recherchent généralement un logement calme situé près d’une ville dynamique, pourvue en infrastructures et en réseaux de transport. Au-delà de la situation géographique, pensez aussi à évaluer la solidité financière et la réputation du gestionnaire. De plus, il convient de vérifier que le modèle économique choisi par l’exploitant soit viable. Par exemple, certains exploitants font le choix de ne proposer aux résidents que des prestations à la carte pour abaisser les loyers et donc démocratiser l’accès à ce type de résidence. Revers de la médaille, lorsque certains résidents verront leur pouvoir d’achat fléchir, les revenus locatifs pourront être amenés à diminuer. Autre point à contrôler, le contenu du bail que vous aurez à signer. Vérifiez bien, d’une part, que les loyers soient revalorisés en fonction d’un indice de référence connu et cohérent et, d’autre part, que la répartition des charges entre bailleur et locataire ne soit pas déséquilibrée. Veillez notamment à ce que l’exploitant prenne en charge les réparations, certaines charges de copropriété, et surtout les grosses réparations (ravalement, mise aux normes…) pouvant, le cas échéant, faire fondre la rentabilité.
Pouvoir revendre ?
Bien que considéré comme un investissement de long terme, le logement peut toujours être revendu. Un marché secondaire commence d’ailleurs à se dessiner. Toutefois, mieux vaut ne pas espérer réaliser de fortes plus-values. En effet, on estime que la valeur d’un tel bien fait l’objet d’une décote de l’ordre de 20 % à 30 % par rapport au prix du neuf.
Assurance-vie en euros : le bilan de l’année 2015
Malgré une baisse de rendement, l’assurance-vie reste un placement performant.
Tout laissait à penser que les fonds en euros allaient souffrir d’une baisse de rendement en 2015. C’est confirmé ! Bernard Spitz, le président de l’Association française de l’assurance (AFA), a indiqué que le taux moyen de ces fonds était passé de 2,48 % en 2014 à 2,3 % en 2015. Mais les résultats ne sont pas si mauvais pour autant. En effet, dans un contexte d’inflation nulle, les fonds en euros délivrent une performance plus qu’honorable. Car n’oublions pas qu’ils offrent un rendement bien supérieur à celui de certains produits d’épargne plus classiques et qu’ils garantissent de manière permanente le capital investi.
Des niveaux de collecte importants
Toujours selon l’AFA, la collecte brute a progressé de 4,9 % en 2015 par rapport à 2014. Ce qui porte l’encours total de l’assurance-vie à 1 580 Mds€. À titre de comparaison, le livret A et le livret de développement durable représentent ensemble près de 330 Mds€. Dans le détail, la collecte nette – c’est-à-dire les versements diminués des rachats – sur les contrats a atteint 24,6 Mds€ en 2015 (22,6 Mds€ en 2014). Sachant que ce surplus de « liquidités » a alimenté les fonds en euros pour 11 Mds€ et les unités de compte pour 13 Mds€.
Les rendements 2015 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
| Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
| 2014 | 2015 | ||
| Afer | Compte Afer | 3,20 % | 3,05 % |
| Agipi / Axa | Cler | 2,85 % | 2,50 % |
| Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 2,65 % | 2,40 % |
| Areas | Multisupport 3 | 2,80 % à 3,40 % | 2,40 % à 3,40 % |
| Asac Fapes Diffusion | Épargne retraite 2 et 2 plus | 3,20 % | 3,12 % |
| Allianz Vie | Gaipare | 3,40 % | 3,15 % |
| Axa | Figures Libres | 2,55 % | 2,20 % |
| BforBank | BforBank Vie | 3,10 % | 2,66 % |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 2,44 % | 2,19 % |
| Boursorama.com | Boursorama Vie | 2,97 % | 2,75 % |
| Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 2,70 % | 2,30 % |
| CNP / La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 2,70 % | 2,45 % à 2,65 % |
| Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 | 2,10 % | 1,80 % |
| Gan Vie | Chromatys | 1,80 % à 2,80 % | 1,80 % à 2,80 % |
| Generali Vie | Xaélidia (euro épargne) | 2,58 % | 2,52 % |
| GMF Vie | Multéo | 3,05 % | 2,80 % |
| Gresham | Concordances 4 | 2,65 % | 2,50 % |
| Groupama | Groupama Modulation | 1,80 % à 2,80 % | 1,80 % à 2,80 % |
| HSBC | Évolution Patrimoine | 2,46 % à 2,72 % | 2,18 % à 2,44 % |
| ING Direct | ING Direct Vie | 2,97 % | 2,75 % |
| LCL | Lionvie Rouge Corinthe | 2,40 % à 2,60 % | 1,90 % à 2,30 % |
| MACIF | Mutavie Actiplus | 2,60 % | 2,40 % |
| MAAF VIE | Winalto | 3,01 % | 2,75 % |
| Matmut | Matmut Vie Épargne | 3,10 % | 2,50 % |
| MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 3,65 % | 3,30 % |
| MMA Vie | Multisupports | 3,05 % | 2,35 % à 2,85 % |
| Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 2,97 % | 2,75 % |
| Mutex (Mutualité française) | Mutex Patrimoine | 2,70 % | 2,40 % |
| Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 3,10 % | 2,75 % |
| SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,81 % | 2,67 % |
| Société Générale / Sogecap | Séquoia | 2,63 % à 2,70 % | 2,06 % à 2,10 % |
| Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 3,85 % | 3,60 % |
| UAF Life Patrimoine | Arborescence | 3 % | 2,55 % |
| UNOFI | Unofi Avenir | 2,60 % | 2,30 % |
Que faire de son vieux contrat d’assurance-vie ?
Le rendement de certaines assurances-vie s’effondre. Pour parer à cette situation, il peut être opportun de « transformer » son vieux contrat.
En 2015, le rendement moyen des assurances-vie en euros s’est établi à 2,3 %. Un résultat modeste, mais sans doute très supérieur à celui réalisé par votre contrat, pour peu qu’il ait plus de 15 ans. Aussi vous êtes-vous peut-être posé la question de l’opportunité de le conserver. Voici quelques éléments de réponse qui vous aideront à prendre une décision.
Transformer son vieux contrat
Les vieux contrats d’assurance-vie cumulent différents handicaps qui expliquent, pour partie, leur faible rentabilité. D’abord, délaissés par les assureurs qui les ont commercialisés, ils manquent de dynamisme. Ensuite, entièrement investis dans des fonds en euros, ils offrent, en période d’inflation nulle, des rendements assez faibles. Enfin, ces vieux contrats font souvent l’objet de frais de gestion importants.
Toutefois, au lieu d’envisager une clôture qui pourrait vous être préjudiciable, une solution peut consister à transformer votre vieux contrat en assurance-vie multisupport. Ainsi, vous pourrez toujours avoir accès à ces fameux fonds en euros qui offrent une garantie en capital mais aussi aux unités de compte pour profiter du dynamisme des marchés financiers.
Un transfert sans douleur
Cette procédure de transformation (dite « transfert Fourgous ») présente un avantage majeur : vous conservez l’antériorité fiscale de votre contrat. Autrement dit, c’est la date de sa souscription et non celle de son transfert qui est retenue pour déterminer son régime fiscal. Sachant que certains anciens contrats bénéficient d’un régime fiscal très généreux. Mais attention, ce transfert doit s’opérer au sein de la même compagnie d’assurances. De plus, votre épargne doit être réinvestie en unités de compte pour au moins 20 %. Ce qui vous contraint à prendre un peu plus de risques qu’auparavant. Mais, malgré leur absence de garantie, certaines unités de compte, comme les fonds patrimoniaux, peuvent vous permettre d’aller chercher de la performance tout en limitant au maximum les soubresauts des marchés. En effet, ces fonds adaptent leur composition en fonction de l’évolution du contexte financier. Si vous ne souhaitez pas investir de manière conséquente en unités de compte, vous pouvez adhérer au nouveau contrat d’assurance-vie euro-croissance. Ce dernier ne suppose, au moment du transfert d’un contrat en euros, qu’un investissement de 10 % dans de tels actifs. De plus, les fonds euro-croissance, investis en partie sur des supports dynamiques (telles des actions), sont censés dégager un rendement plus élevé qu’un fonds en euros. Néanmoins, ils n’offrent une garantie du capital qu’au bout d’une détention minimale de 8 années.
Quelques chiffres :
selon la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), depuis 2005, date à laquelle le transfert Fourgous est devenu possible, plus de 2,3 millions de contrats monosupport ont fait l’objet d’une transformation en contrat multisupport. Ce qui représente environ 77,6 milliards d’euros d’encours transférés.
L’impact du DPE sur la valeur d’un bien immobilier
La consommation énergétique d’un logement ne doit pas être négligée !
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cet indice, obligatoire depuis novembre 2006, permet notamment d’informer l’acquéreur du bien de son degré d’isolation thermique et du montant des charges prévisionnelles de chauffage. Son incidence sur la valeur d’un bien immobilier est donc importante.
Un impact sur les prix
Avec la situation géographique, l’environnement, l’état général ou encore l’exposition, la performance énergétique est l’un des principaux critères pris en compte par les acheteurs lors de la sélection d’un bien immobilier.
Ainsi, un vendeur qui possède un logement affichant une classe A ou B (A correspondant à la meilleure performance énergétique, G à la plus mauvaise) peut espérer obtenir, lors de la vente, un bonus de 5 % à 10 % de valeur supplémentaire par rapport à la médiane du marché, située à la classe D. À l’inverse, un bien classé F ou G se vendra 25 % moins cher qu’un immeuble classé A ou B.
En clair, un bien immobilier énergivore aura une liquidité plus faible. Ce qui signifie que son propriétaire mettra plus de temps pour le vendre.
Ce bilan énergétique, valable pendant 10 ans, a également de l’importance pour les candidats à la location. Selon une récente enquête d’Harris Interactive, 75 % des locataires affirment que la classe énergétique d’un bien est déterminante dans leur choix. Ils sont d’ailleurs prêts à verser un loyer plus important (de 8 % en moyenne) pour un logement performant.
Précision :
pour établir un DPE, le diagnostiqueur s’appuie sur un ensemble de critères liés au logement (surface, orientation, matériaux…), ainsi qu’à ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Ces mêmes critères lui permettent également d’établir une « étiquette climat ». Cette dernière détermine le niveau d’émission de gaz à effet de serre du logement. Composée également de 7 classes, elle a pour l’instant peu d’influence sur les prix.
Réaliser des travaux
Afin que le logement conserve sa valeur, il peut donc être intéressant de réaliser des travaux de rénovation énergétique. D’autant plus que propriétaires et locataires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour certaines dépenses d’amélioration de la qualité environnementale (matériaux d’isolation thermique, équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable…) de leur résidence principale lorsqu’elle est achevée depuis plus de 2 ans. L’avantage fiscal s’élève à 30 % des dépenses éligibles, dès la première dépense réalisée. Le montant de ces dépenses est toutefois plafonné par période de 5 années consécutives et pour un même logement à 8 000 € pour une personne seule et à 16 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Ces plafonds étant majorés de 400 € par personne à charge.
Percevoir une pension de réversion
Les conditions que le conjoint survivant doit remplir pour prétendre à une pension de réversion.
Les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé (salarié ou non-salarié) soit versée au conjoint survivant. Mais le versement d’une pension de réversion n’est pas pour autant automatique. Le point sur les conditions d’attribution de cette pension.
La situation familiale
Pour percevoir une pension de réversion, il est nécessaire d’avoir été marié avec l’assuré décédé. Ainsi, les concubins et les partenaires pacsés ne peuvent pas en bénéficier. En revanche, aucune durée de mariage minimale n’est, en principe, exigée.
Par ailleurs, si l’assuré a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés. Ce partage s’effectuant proportionnellement à la durée de chaque mariage.
Il faut savoir également que le remariage du conjoint survivant est sans incidence sur le versement de la pension de réversion du régime de base. En revanche, ce remariage entraîne, le plus souvent, la fin du versement de la pension de réversion issue des régimes complémentaires.
Une condition d’âge
Dans la plupart des régimes, le conjoint survivant doit atteindre l’âge de 55 ans pour demander la perception d’une pension de réversion. Une fois cet âge atteint, il peut en faire la demande, qu’il soit en activité ou qu’il perçoive déjà sa propre pension de retraite.
Une condition de ressources
Pour la retraite de base, les ressources personnelles du conjoint survivant ou celles de son nouveau ménage (revenus professionnels, des placements et des biens immobiliers...) sont prises en compte pour le calcul de la pension de réversion. Par exemple, pour la retraite de base du régime des salariés, les ressources du conjoint survivant ne doivent pas dépasser 20 113,60 € pour 2016. Au-delà, le conjoint est privé du bénéfice de cette pension. En revanche, aucune condition de revenus n’est associée à l’attribution de la pension de réversion versée au titre des régimes de retraite complémentaire.
Le montant de la pension
La part de la pension de réversion versée au conjoint survivant est, en principe, égale à 54 % de la pension de retraite du défunt. Ce taux étant fixé à 60 % pour la pension de réversion portant sur la retraite complémentaire. Étant précisé que la pension peut être minorée ou majorée en cas de modification de ressources ou en raison de la situation de famille du bénéficiaire.
Faire face à un départ « à la cloche de bois »
La procédure à suivre pour reprendre un logement abandonné par son locataire
Lorsqu’un locataire quitte brusquement et définitivement les lieux sans prévenir le bailleur, on parle alors de départ « à la cloche de bois ». Une situation qui impose à ce dernier de recourir à une procédure particulière afin de pouvoir reprendre possession de son logement. Explications.
L’intervention d’un huissier de justice
Quand le bailleur soupçonne son locataire d’avoir abandonné le logement (logement vidé, loyers impayés, courrier entassé, témoignages du voisinage...), il doit, dans un premier temps, lui adresser une mise en demeure de justifier qu’il occupe bien ce logement. Une mise en demeure qui doit être effectuée par acte d’huissier de justice.
Le locataire dispose ensuite d’un délai d’un mois pour répondre. Sans manifestation de sa part, l’huissier de justice procède alors à la constatation de l’état d’abandon du logement et pénètre dans les lieux. Il ne peut d’ailleurs le faire qu’en la présence soit du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un agent municipal habilité, soit d’une autorité de police ou de gendarmerie ou de deux témoins majeurs sans lien avec le bailleur ou l’huissier de justice.
Une fois dans le logement, il dresse, le cas échéant, un commandement de payer les arriérés de loyers et un inventaire des meubles laissés sur place par le locataire.
Remarque importante, le propriétaire ne doit pas se faire justice lui-même en entrant dans le logement et en faisant procéder, par exemple, à un changement des serrures de porte. Le locataire serait alors en droit de porter plainte pour violation de domicile. Et le propriétaire s’exposerait à une peine d’un an de prison et à une amende de 15 000 €.
À noter :
avant d’entamer toute démarche auprès d’un huissier, il est indispensable de tenter d’entrer en contact avec le locataire (courriers, appels téléphoniques, e-mails…) afin de connaître les raisons de son départ. Sans réponse de sa part, l’éventuel garant du locataire est la deuxième personne à contacter. Il peut vous renseigner sur la situation du locataire et vous indiquer s’il est prêt ou non à régler lui-même les arriérés de loyers.
S’adresser au juge d’instance
Muni du procès-verbal de l’huissier de justice, le bailleur peut ensuite adresser au juge d’instance du lieu du logement laissé vacant une requête sollicitant la résiliation du bail. S’il estime que la requête est fondée, le juge constate la résiliation du bail d’habitation, ordonne la reprise des lieux, statue sur la demande de paiement en cas d’impayés, désigne les biens ayant une valeur marchande sur la base de l’inventaire dressé par l’huissier de justice et autorise leur saisie et leur vente.
Dans un délai de 2 mois à compter du jugement, le bailleur doit signifier, par acte d’huissier, la décision rendue au locataire ou aux derniers occupants connus. Étant précisé que le locataire dispose ensuite d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement pour s’y opposer.