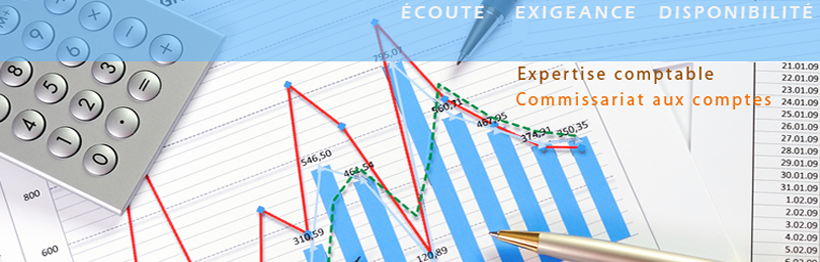Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer
Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.
Une simple requête au tribunal
Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.
Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail...), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible (c’est-à-dire arrivée à échéance) et dont le montant est déterminé. Et bien entendu, la créance ne doit pas être prescrite.
Attention :
l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.
Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société) ou réside, et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat.
Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…) ainsi que des documents prouvant les relances qui ont été effectuées et la mise en demeure qui a été envoyée.
En pratique :
le site service publicQuel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant ou une entreprise doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.
La requête est gratuite devant le tribunal judiciaire. Elle coûte un peu plus de 30 € si elle est déposée devant le tribunal de commerce. Dans tous les cas, des honoraires seront dus si elle est déposée par un avocat ou par un commissaire de justice.
Attention :
lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.
La décision du tribunal
Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.
Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui.
Si le juge estime que votre requête est fondée, en totalité ou en partie, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette (pour la somme retenue par le juge), cette ordonnance étant un titre exécutoire. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte de commissaire de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure. Bien entendu, cette signification par le commissaire de justice a un coût.
Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.
Le recouvrement de la créance
Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.
Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.
Remarque :
il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.
En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.
Optimisez le pilotage de votre entreprise !
Prévisionnel, tableau de bord : des outils de gestion que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de piloter au plus près votre entreprise.
Ces dernières années ont été particulièrement chahutées : une reprise de croissance brutale post-Covid contrariée par une pénurie de matières premières, une guerre aux portes de l’Europe qui nous a plongés dans une crise de l’énergie aussi inattendue qu’inégalée, et enfin une guerre des droits de douane initiée par les États-Unis. Sans oublier les tensions générées par le conflit israélo-palestinien et l’instabilité politique française. Aussi, dans cet environnement chaotique, vous vous trouvez plus que jamais dans l’obligation de piloter votre entreprise au plus près. Pour vous y aider, des outils de gestion spécifiques existent. Ils vous permettent d’abord de vous projeter et d’écrire ce que devrait produire et consommer votre entreprise lors de l’exercice suivant, et ensuite d’analyser au jour le jour votre activité pour changer de cap rapidement si cela se révèle nécessaire. Prévisionnel, tableau de bord : voici une présentation de deux des outils les plus efficaces pour optimiser la gestion de votre entreprise en 2026.
Les comptes prévisionnels
Les comptes prévisionnels – on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs – sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent essentiellement un compte de résultat prévisionnel, accompagné, le cas échéant, d’un tableau prévisionnel de trésorerie.
À quoi servent les comptes prévisionnels ?
Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour l’exercice à venir, l’exercice 2026 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez comparer en permanence, durant l’exercice 2026, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs.
Comment établir un prévisionnel ?
On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en 6 étapes principales :
1. La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc.
2. La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement : investissements, embauches, souscriptions d’emprunts, augmentations de capital, etc.
3. L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et tenir compte notamment des difficultés d’embauche que vous pourriez rencontrer, d’une possible baisse de la consommation des ménages et/ou d’un attentisme persistant des entreprises dans leurs décisions d’investissement.
4. L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise, en accordant une attention particulière à l’augmentation de certaines d’entre elles, même si l’inflation semble derrière nous.
5. L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment).Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion (cf. ci-dessous), offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui peut comporter à la fois les données prévisionnelles et celles du dernier exercice clos, et faire ressortir leur évolution programmée en pourcentage.
6. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle , afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie de l’exercice 2026 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.
Valider des scénarios
Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses de travail. Une opération qui peut se révéler très précieuse dans la période très incertaine d’un point de vue économique et politique que nous traversons. Le Cabinet peut, par exemple, chiffrer une hypothèse pessimiste qui vous permettra de définir la meilleure stratégie à mettre en œuvre en cas d’aggravation de la situation économique et sociale.
Le tableau de bord
Le tableau de bord complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours qui suivent la fin du mois considéré). Il vous permet de suivre au plus près l’évolution de votre activité et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise.
À quoi sert le tableau de bord ?
Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui s’imposerait. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données commerciales, comptables et financières, afin de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Ainsi, grâce au tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2026, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.
Comment mettre en place un tableau de bord ?
La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité – pas seulement comptables, mais aussi des indicateurs commerciaux prospectifs – et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales.
Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action corrective efficace (niveau des ventes, coûts d’approvisionnement, nombre de demandes de devis, rapport entre les devis émis et les devis signés, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).
En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.
Comment présenter le tableau de bord ?
Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel.
On distingue dans ce document de synthèse trois grands types de données comptables :
• le chiffre d’affaires , qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations mensuelles ;
• les charges sensibles , celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;
• les charges fixes , qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).
Soignez la forme du tableau de bord
• Évitez de choisir trop d’indicateurs, sinon votre tableau de bord deviendra rapidement illisible, et donc inutile.• N’hésitez pas à mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents en jouant sur leur taille et leur couleur.• Ne vous contentez pas de chiffres, établissez des courbes, des camemberts, des graphiques, car ils facilitent la lecture et la compréhension du tableau de bord et des tendances qui s’en dégagent.• Si vous partagez votre tableau de bord avec vos principaux collaborateurs, n’hésitez pas à les impliquer dans sa conception, sur le fond comme sur la forme.
Comment interpréter et présenter vos comptes 2024
Bien analyser la performance de votre entreprise en 2024 vous permettra de mieux la présenter ensuite à vos partenaires financiers.
Vous êtes maintenant nombreux à disposer ou à être sur le point de disposer des comptes de votre exercice 2024, un exercice qui n’aura pas été simple, notamment la dernière partie de l’année, en particulier en raison du contexte économique et politique difficile, qui a marqué l’année écoulée. Ces comptes vont maintenant permettre au Cabinet de remplir vos obligations fiscales et de déclarer à l’administration votre résultat. Mais leur utilité va bien au-delà de ces aspects déclaratifs. Ils vous offrent d’abord la possibilité d’analyser avec précision votre résultat 2024, autrement dit de savoir quelle performance exacte vous êtes parvenu à réaliser. Puis, étape très importante en ce moment, ils vous permettent de communiquer sur cette performance et de la détailler à votre partenaire financier, à savoir votre banquier.
Interprétez la performance de votre entreprise en 2024
Les comptes qui vous ont été remis sont composés de trois documents : le compte de résultat, le bilan et l’annexe. Et vous le savez, c’est le compte de résultat qui mesure la performance réalisée par votre entreprise durant cet exercice.
Comment est déterminé le résultat ?
Le compte de résultat fait à la fois apparaître ce que votre entreprise a produit en 2024, c’est-à-dire son chiffre d’affaires, et ce qu’elle a consommé, c’est-à-dire ses charges.
Ces consommations pouvant être de natures très différentes. Il peut s’agir notamment d’achats de matières premières, d’énergie ou de marchandises à revendre, de frais de personnel, des impôts et taxes ou encore de frais financiers. Et de la différence entre son chiffre d’affaires et l’ensemble de ses charges découle le résultat net réalisé par votre entreprise.
La structure de votre résultat
L’examen de votre compte de résultat vous permet donc de déterminer la performance accomplie par votre entreprise en 2024. Mais vous devez affiner votre analyse, car cette performance peut découler de l’activité même de votre entreprise, de sa situation financière ou d’éléments exceptionnels. Ainsi, une perte importante n’aura pas du tout la même signification si elle est due à la destruction d’un bien par une tempête (évènement exceptionnel) ou si elle est associée à une forte baisse de la marge commerciale (liée à l’exploitation).
Il est donc important de bien savoir analyser la composition de votre compte de résultat, qui est divisé en trois parties :- une partie exploitation , qui comprend le détail des produits et charges d’exploitation et qui sert à déterminer le résultat de l’activité proprement dite ;- une partie financière , qui détermine le résultat financier ;- une partie exceptionnelle , d’où découle le résultat exceptionnel.
Étant précisé que c’est votre résultat d’exploitation qui traduit la performance de votre business.
Finalement, c’est le cumul de ces trois résultats (d’exploitation, financier et exceptionnel), diminué de l’impôt sur les bénéfices, qui détermine le bénéfice net comptable ou la perte de l’exercice.
Affinez votre analyse !
Pour favoriser une meilleure analyse, le compte de résultat est stratifié en différents niveaux intermédiaires, appelés « soldes intermédiaires de gestion ». Voici les principaux indicateurs à analyser :
Les soldes intermédiaires de gestion
| CHIFFRE D’AFFAIRES | |
| - Achats de marchandises | - Achats consommés |
| MARGE COMMERCIALE | MARGE SUR PRODUCTION |
| = MARGE BRUTE TOTALE - Charges externes | |
| = VALEUR AJOUTÉE - Impôts et taxes- Frais de personnel | |
| = EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION +/- Produits et charges divers- Dotations aux amortissements et provisions+ Reprises sur amortissements et provisions | |
| = RÉSULTAT D’EXPLOITATION +/- Produits et charges financiers(Résultat financier) | |
| = RÉSULTAT COURANT +/- Produits et charges exceptionnels(Résultat exceptionnel)- Participation des salariés- Impôts sur les bénéfices | |
| = RÉSULTAT NET |
Procédez à l’analyse pluriannuelle
Pour une bonne analyse, il est, par ailleurs, indispensable de vous référer à la présentation pluriannuelle de vos données comptables. Cette présentation pluriannuelle permet de mettre en évidence l’évolution de chaque poste et sa contribution positive ou négative dans l’élaboration du résultat. Et surtout, la comparaison entre l’année 2024 et l’année 2023 est essentielle. Elle vous permettra d’expliquer les principales incidences du ralentissement économique que nous traversons sur vos différents postes comptables.
L’idéal consiste même à procéder à une comparaison de votre performance 2024 avec celles des deux années précédentes et avec celle que vous anticipez pour 2025, dans le cadre de votre prévisionnel 2025. Ainsi, vous pourrez montrer comment votre entreprise devrait surmonter les difficultés liées à la conjoncture actuelle par une analyse précise de l’impact du contexte et de son évolution sur vos principaux postes comptables (CA, marge brute, principales charges d’exploitation, dont la masse salariale…).
Par ailleurs, et plus classiquement, le poids en pourcentage du chiffre d’affaires de certains postes est un indicateur important. Par exemple, le taux de marge globale — et son évolution — sera souvent plus intéressant à analyser que la progression en valeur absolue de cette marge. De même, au niveau de chacune des charges, il est plus pertinent de mesurer leur évolution par rapport au niveau d’activité. Ainsi, le ratio frais de personnel sur chiffre d’affaires et son évolution d’une année sur l’autre permettent d’analyser l’évolution du niveau de productivité de l’entreprise.
Communiquez vos comptes à votre banquier
Interpréter et comprendre vos comptes est indispensable, mais pas suffisant. Vous devez également communiquer sur votre performance, notamment la présenter et l’expliquer à votre banquier afin qu’il réponde présent lorsque vous aurez besoin de lui, surtout si vous anticipez un besoin de financement durant l’année 2025.
Cette démarche est importante, car elle vous permet de créer et de maintenir un climat de confiance entre lui et vous, ce qui se révèle particulièrement nécessaire lorsque des tensions apparaissent s’agissant de l’octroi de concours bancaires.
Quelques conseils de bon sens
Pour réussir votre rendez-vous, soyez clair et veillez à ne pas noyer votre interlocuteur dans des détails, et surtout à ne pas donner l’impression que vous cachez quelque chose. La transparence étant primordiale, à toute question du banquier, vous devez apporter une réponse. Si celle-ci n’est pas immédiate, notez-la et prenez soin de lui envoyer un petit courriel d’explications dans les plus brefs délais, après avoir pris soin d’interroger, au besoin, le Cabinet.
Les points à mettre en avant cette année
En raison du contexte international, politique et économique, l’année 2024 n’a pas été simple et doit orienter votre discours vers une série de points très spécifiques concernant la gestion de votre entreprise. Vous devez, en effet, attirer l’attention de votre banquier sur : - L’augmentation des charges que vous avez involontairement subie en 2024 en raison de l’inflation, même si celle-ci a nettement reculé par rapport à 2023. Mais parallèlement, mettez l’accent sur les économies que vous avez pu réaliser pour contenir cette augmentation. - Les incidences de l’augmentation de votre taux d’endettement. Si vous avez souscrit un PGE ces dernières années, votre taux d’endettement sur fonds propres a dû augmenter, ce qui peut inquiéter votre banquier. Rassurez-le si vous n’avez pas — ou pas intégralement — « consommé » votre emprunt. Et le fait que vous ayez commencé à le rembourser en 2024 est également de nature à apaiser ses craintes. - Le chiffre d’affaires que vous êtes allé chercher pour compenser l’éventuelle baisse des commandes que vous avez subie en 2024, notamment en ayant revu votre stratégie commerciale (par exemple, facturation de nouveaux services). - L’augmentation des prix des produits ou des services que vous vendez, qui vous a permis de préserver vos marges tout en ayant conservé la confiance et la fidélité de vos clients. - Votre document prévisionnel 2025, ainsi que l’état de votre carnet de commandes en ce début d’année, et plus généralement la façon dont vous envisagez la consolidation voire le développement de votre activité, de même que votre plan de trésorerie 2025.
Recourir à l’affacturage
Solution intéressante pour éviter totalement ou partiellement les problèmes de trésorerie, l’affacturage consiste pour une entreprise à céder ses factures en attente de règlement (ses « créances clients ») à un organisme financier spécialisé, lequel lui verse, en contrepartie, une somme représentant le montant des créances ainsi cédées et se charge d’en poursuivre le recouvrement. Présentation de ce mécanisme permettant à une entreprise d’obtenir rapidement une avance de trésorerie.
Avantages et inconvénients de l’affacturage
L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise à faire appel à un organisme financier, appelé factor, qui, moyennant rémunération, achète les créances de celle-ci et se charge de les recouvrer auprès de ses clients.
L’affacturage (aussi appelé factoring) est la convention par laquelle un établissement spécialisé, appelé factor (ou affactureur), qui est souvent, en pratique, un établissement de crédit, accepte de régler les créances qu’une entreprise détient sur ses clients professionnels, en contrepartie du transfert à son profit de ces créances et d’une rémunération, consistant en commissions et agios. Le factor paie ainsi l’entreprise de manière anticipée et se charge du recouvrement auprès des débiteurs des créances ainsi transmises, au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces derniers.
Ainsi, l’affacturage offre aux entreprises l’assurance d’un paiement rapide et sûr de leurs factures clients. Concrètement, il leur permet de déléguer la gestion des tâches administratives liées à la facturation. En cédant ses créances au factor, l’entreprise se décharge en effet des problématiques de suivi, de recouvrement ou encore de relance.
En outre, il est très rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les clients acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures (légalement dans les 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier). L’entreprise supporte donc un décalage entre le moment où elle facture et le moment où le client paie. En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise peut ainsi optimiser la gestion de sa trésorerie.
À noter :
l’affacturage n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les TPE-PME peuvent également y recourir, les sociétés d’affacturage disposant d’offres à leur intention.
Le recours à l’affacturage représente pour l’entreprise un coût non négligeable. Ainsi, avant d’entreprendre une telle démarche, l’entreprise doit bien étudier son poste client et calculer le coût de gestion de ses factures par rapport au coût du factoring. Ainsi, par exemple, si l’entreprise subit un délai moyen de paiement de ses factures important, conclure un contrat d’affacturage peut lui permettre d’optimiser sa trésorerie car, en cédant ses factures à une société d’affacturage, cette dernière lui en réglera le montant sans attendre l’échéance prévue. À l’inverse, si le délai moyen de paiement est plutôt court, le coût des prestations offertes par le factor peut être pénalisant pour la trésorerie de l’entreprise. Il est donc important pour l’entreprise d’analyser sa situation avant de faire appel à une société d’affacturage.
En outre, l’entreprise qui recourt à l’affacturage perd le contrôle de la gestion d’une partie de la relation avec ses clients. Si les relations entre le client et le factor ne sont pas bonnes, l’entreprise peut en pâtir.
Comment fonctionne l’affacturage ?
La société d’affacturage peut accepter d’acquérir la totalité ou une partie seulement des créances de l’entreprise. En achetant les créances d’une entreprise, l’affactureur est subrogé dans les droits de cette dernière.
Lorsqu’elle décide de recourir aux services d’une société d’affacturage, l’entreprise doit présenter à celle-ci l’ensemble de ses créances, et non pas simplement celles dont le recouvrement s’annonce délicat. La société d’affacturage va alors procéder à une analyse de la situation financière de l’entreprise (bilan et comptes des trois dernières années, statuts sociaux, état des difficultés de recouvrement…) et surtout de son poste clients. Si le résultat de cette analyse se révèle favorable, l’entreprise et la société d’affacturage signent un contrat d’affacturage.
Dans ce cadre, le factor peut accepter de prendre en charge le recouvrement de l’ensemble des créances de l’entreprise, moyennant leur transfert et une rémunération. Les factures sont alors remises au factor au fur et à mesure de leur émission via un bordereau les regroupant. Par ce transfert, le factor devient alors, par substitution, créancier des clients débiteurs à la place de l’entreprise. Il peut donc, de ce fait, exercer à l’encontre de ces derniers tous les droits que l’entreprise cédante détenait sur eux au moment du transfert. On dit que le factor est subrogé dans les droits de l’entreprise.
Le factor peut aussi choisir de ne pas acquérir toutes les créances, mais seulement certaines d’entre elles, notamment celles qu’il juge les moins risquées. Toutefois, dans ce cas, il peut tout de même accepter d’assurer le recouvrement des créances non approuvées, mais en simple qualité de mandataire de l’entreprise, laquelle conservera alors le risque de l’insolvabilité du débiteur.
Important :
l’entreprise qui recourt à l’affacturage doit avertir ses clients de l’existence d’un tel contrat au moyen, par exemple, d’une mention sur la facture indiquant que le règlement doit s’effectuer auprès de la société d’affacturage.
Lorsqu’il accepte d’acquérir les créances, le factor doit en régler le montant à l’entreprise, diminué des frais. Ce paiement s’effectue par une simple inscription au crédit du compte courant tenu entre l’affactureur et l’entreprise.
Une fois le transfert des créances opéré et son compte courant crédité du paiement correspondant, l’entreprise est libérée du recouvrement des créances et échappe ainsi au risque d’insolvabilité de ses débiteurs à l’échéance.
Attention :
le factor dispose d’un recours contre l’entreprise si les créances transmises sont nulles ou ne correspondent pas à ce qui a été prévu initialement.
Mais attention, investi, par la subrogation, de tous les droits attachés à la créance cédée, l’affactureur peut se voir opposer par le débiteur de la créance toutes les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise initialement créancière. Le débiteur peut ainsi invoquer à l’encontre du factor des exceptions telles que celles relatives à l’exception d’inexécution, à la mauvaise exécution du contrat ou encore à la prescription de l’action en recouvrement. Il peut également se prévaloir de la compensation de sa dette avec la créance qu’il détient sur l’entreprise cédante, lorsque cette créance est née avant la subrogation (c’est-à-dire avant le transfert de la créance au profit du factor). Le débiteur peut également opposer au factor la compensation d’une créance postérieure à la subrogation, dès lors que celle-ci est connexe avec celle que l’entreprise détenait sur lui, c’est-à-dire née d’un même contrat.
La rémunération de la société d’affacturage
Le factor prélève sa rémunération sur le montant des créances cédées par l’entreprise.
En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise ne récupère pas la totalité du montant des factures. En effet, le factor prélève sa rémunération sur celles-ci. D’abord, il se rémunère en prélevant une commission d’affacturage, fixée notamment en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui lui permet d’assumer ses frais de gestion, de relance de paiement des factures et de recouvrement des impayés. Ensuite, il prélève une commission de financement, sous forme d’intérêts, représentative de l’avance de trésorerie qu’il consent à l’entreprise. Enfin, il prélève une participation à un fonds de garantie destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume.
Les sociétés d’affacturage peuvent également proposer une tarification au forfait.
Délégation de pouvoirs, mode d’emploi
En tant que représentant légal d’une société, son dirigeant est la seule personne qui puisse conclure des actes au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, rien n’interdit au dirigeant de déléguer ses pouvoirs, cette pratique étant d’ailleurs courante dans les grandes sociétés et dans les groupes. Mais attention, pour être efficace, une délégation de pouvoirs doit satisfaire à certaines conditions.
Pourquoi déléguer ?
La délégation de pouvoirs permet au dirigeant de se décharger d’une partie de ses fonctions et aussi de se dégager de sa responsabilité pénale.
L’intérêt majeur d’une délégation de pouvoirs pour le dirigeant, c’est évidemment de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. Autre avantage, elle lui permet de transmettre des responsabilités à un collaborateur qui peut être mieux à même que lui d’intervenir dans le domaine considéré (un chef de chantier, un directeur du personnel, etc.). Sans compter qu’elle a aussi pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. À condition, bien entendu, que l’infraction commise soit rattachée au domaine de compétence délégué et que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti.
Ne pas confondre délégation de pouvoirs et délégation de signature
La délégation de pouvoirs se distingue de la simple délégation de signature. Dans le cas d’une délégation de signature, le dirigeant charge simplement une personne de signer des actes en son nom et en ses lieu et place. Le délégataire n’est alors qu’un mandataire du dirigeant : il ne représente pas la société. En revanche, dans le cas d’une délégation de pouvoirs, le dirigeant délègue une partie de ses pouvoirs au nom et pour le compte de la société. Le délégataire recevant ses pouvoirs de la société, il a donc ici le pouvoir de la représenter (dans la limite de sa délégation).
À noter :
seule une véritable délégation de pouvoirs peut entraîner une décharge de responsabilité pénale du dirigeant.
Parce que les délégations de pouvoirs sont consenties au nom de la société, la cessation du mandat du dirigeant délégant, quelle qu’en soit la cause (révocation, démission, décès), ne met pas automatiquement fin aux délégations que celui-ci aurait pu consentir.
Précision :
la délégation doit être opportune, c’est-à-dire justifiée au regard de la taille de l’entreprise, de ses activités et de son organisation interne. Une délégation mise en œuvre de manière artificielle risquerait d’être privée d’effet par les tribunaux.
Bien choisir le délégataire
Une délégation de pouvoirs peut être consentie aussi bien à un salarié ou à un associé qu’à une personne extérieure à la société.
Dans l’absolu, la qualité de délégataire n’est pas réservée au titulaire d’un statut particulier. Ainsi, le délégataire peut être aussi bien un salarié qu’un associé ou même une personne extérieure à la société. Dans les groupes de sociétés, par exemple, il est possible pour le dirigeant d’une société de confier une délégation de pouvoirs à un salarié d’une autre société du groupe. Ainsi, le dirigeant de la société tête de groupe peut déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité du travail pour l’ensemble des sociétés du groupe à un salarié d’une filiale.
Etant précisé qu’une délégation de pouvoirs donnée à un tiers ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité. Seule une délégation de pouvoirs consentie à un salarié emporte délégation de responsabilité, sous réserve que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. L’inadéquation du poste, de la compétence et de la rémunération du salarié avec la délégation de pouvoirs qui lui est consentie rendrait celle-ci inopérante.
Important :
dans tous les cas, le dirigeant est responsable des délégations de pouvoirs qu’il consent. Un choix hasardeux de délégataire, une mauvaise appréciation des missions confiées, un défaut de surveillance du délégataire seront autant de sources de responsabilité pour le dirigeant, pouvant, le cas échéant, justifier sa révocation.
Une délégation écrite, claire et précise
Il n’existe aucun formalisme pour établir une délégation de pouvoirs mais il est vivement conseillé d’établir un écrit.
En théorie, une délégation de pouvoirs peut être orale, aucune forme particulière n’étant imposée. Toutefois, en pratique, un écrit est fortement recommandé car il permet d’apporter la preuve de l’existence de la délégation et de son contenu. Cet écrit peut prendre la forme d’un acte spécifique ou d’une stipulation insérée dans le contrat de travail du salarié délégataire.
Et attention, pour produire pleinement ses effets, une délégation de pouvoirs doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté. Une formulation trop imprécise ou trop générale aurait pour conséquence de faire perdre toute efficacité à l’opération. Il convient donc d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de l’acte de délégation. À ce titre, il est vivement conseillé de mentionner le domaine et la portée de la délégation (objet, étendue des pouvoirs conférés au délégataire, réglementation qu’il lui revient de faire appliquer...) ainsi que sa date de prise d’effet et sa durée, une délégation de pouvoirs pouvant être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, elle prendra fin à l’arrivée du terme prévu. Dans le second cas, le dirigeant peut la révoquer à tout moment.
Attention :
lorsque la délégation consentie à un salarié apparaît comme un élément substantiel de son contrat de travail, cette révocation peut être considérée comme une modification d’un élément du contrat de travail de nature à entraîner sa rupture.
Si les statuts fixent des conditions de délégation, le dirigeant souhaitant déléguer une partie de ses pouvoirs devra s’y conformer. À défaut, il engage sa responsabilité et risque la révocation.
Veiller à bien définir les domaines de délégation
La délégation de pouvoirs ne peut pas être totale, elle doit se limiter à certains actes.
Par une délégation de pouvoirs, il ne peut être question de se décharger de tous ses pouvoirs et de toutes ses responsabilités. La délégation doit être limitée à certains actes et à certaines catégories de missions seulement. En outre, le dirigeant ne peut déléguer que les pouvoirs qu’il détient lui-même, et pas ceux appartenant à d’autres organes de la société.
Par ailleurs, une délégation de pouvoirs efficace doit pouvoir exonérer le dirigeant de la responsabilité attachée au domaine de délégation. On rappellera ici que les domaines dans lesquels la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sont nombreux. On évoquera en particulier, sans que cette liste soit exhaustive :- les infractions à la réglementation du travail (hygiène, sécurité, durée du travail, travail dissimulé, embauche illégale de travailleurs étrangers…) ;- les infractions à la législation fiscale ;- les infractions au droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante…) et de la consommation (pratiques commerciales déloyales ou trompeuses…) ;- les infractions spécifiques au droit des sociétés et au droit boursier ;- la contrefaçon.
Précision :
lorsque les conditions requises sont réunies, la délégation a donc pour effet de dégager le représentant légal de sa responsabilité pénale. Seul le délégataire s’expose alors aux poursuites à condition bien sûr :- que l’infraction commise puisse être rattachée au domaine de compétence délégué ;- et, cela va sans dire, que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou y ait pas lui-même consenti. Dans cette hypothèse, la délégation, aussi bien rédigée soit-elle, ne pourra pas permettre au dirigeant d’échapper aux poursuites.
Envisager des subdélégations
La personne qui a reçu une délégation de pouvoirs peut, à son tour, déléguer une partie des missions qui lui ont été confiées.
Le délégataire peut, à son tour, déléguer une partie des pouvoirs qui lui ont été confiés. On parle alors de subdélégation. De même, le subdélégataire peut, par suite, déléguer une partie de ses attributions. Et on peut arriver ainsi à des délégations en chaîne, pouvant, le cas échéant, comporter plusieurs ramifications.
Exemple :
un président de SAS a délégué au directeur juridique de la société la gestion des affaires juridiques de l’entreprise. Ce directeur juridique pourra, par la suite, déléguer à un juriste de son service les missions relatives à la gestion des affaires contentieuses et à un autre la rédaction et la révision des contrats.
Les subdélégations doivent être consenties dans les mêmes conditions que celles exigées pour la délégation. Sachant qu’en matière d’infraction à la sécurité du travail, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la subdélégation était valable même sans l’autorisation du dirigeant et il est permis de penser que cette solution s’applique aux autres matières. Toutefois, cette solution ne s’impose qu’en l’absence de stipulation contraire de l’acte de délégation, qui peut tout à fait interdire la subdélégation ou au moins subordonner celle-ci à l’autorisation préalable du dirigeant. De telles clauses sont d’ailleurs recommandées, dans la mesure où elles assurent au dirigeant une certaine maîtrise de la chaîne de délégations et de l’organigramme des pouvoirs et responsabilités de l’entreprise.
À noter :
si la subdélégation est parfaitement envisageable, la codélégation, c’est-à-dire le fait de déléguer une même mission à deux ou plusieurs personnes en même temps, est à proscrire car elle ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité.
Conditions générales de vente : êtes-vous à jour ?
Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles régissant les relations contractuelles qui s’appliquent entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et ses clients. Il s’agit donc d’un document commercial quasi-incontournable et particulièrement important, qu’il convient de rédiger avec le plus grand soin. Voici un point sur les règles à connaître en la matière. Il vous permettra de savoir si vos CGV sont établies dans les règles de l’art et au mieux de vos intérêts, ou de vous aider à rédiger des CGV si vous n’en disposez pas.
L’utilité des CGV
Une entreprise qui vend des produits ou des services a tout intérêt à disposer de CGV car elles lui permettent d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ses clients.
Même si, juridiquement, elles n’y sont pas obligées, les entreprises ont intérêt à disposer de conditions générales de vente (CGV). En effet, les CGV sont particulièrement utiles pour une entreprise en ce qu’elles ont pour objet d’informer ses clients professionnels et particuliers, préalablement ou lors de la conclusion de la vente, des conditions encadrant leur relation. Elles lui permettent ainsi d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ces derniers.
Mieux, dans la mesure où les professionnels sont astreints à une obligation générale d’information précontractuelle importante à l’égard des consommateurs, la réalisation de CGV permet à une entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bien rempli cette obligation. Lorqu’elle vend des produits aux consommateurs, une entreprise peut donc difficilement se passer de CGV.
Le contenu des CGV
Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. En pratique, très souvent, les entreprises y insérent également un certain nombre d’autres clauses.
Lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires imposées par la loi. Sachant qu’il est également possible, et même souhaitable, d’y insérer certaines clauses qui peuvent se révéler utiles.
Les mentions obligatoires
Les mentions que doivent contenir les conditions générales de vente sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations de services à des professionnels ou à des consommateurs.
Les mentions à l’égard des professionnels
À l’égard de ses clients professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner :- les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les modalités de la commande, les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, les conditions du transfert de propriété, les garanties offertes, etc. ;- les éléments de fixation du prix, comme le barème des prix unitaires des produits proposés à la vente (le cas échéant, il est possible de prévoir une clause de renégociation du prix qui prendra en considération, par exemple, les fluctuations du coût des matières premières) ;- les réductions (rabais, remises) de prix consenties ;- le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ;- les conditions de règlement.
S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Attention, des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).
Précision :
quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.
Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit à 15,21 % pour le 1er semestre 2024). Si, d’aventure, aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 14,50 % actuellement).
À savoir :
les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.
Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.
Attention :
l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.
Les mentions à l’égard des consommateurs
À l’égard de ses clients consommateurs, les CGV doivent notamment indiquer :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix ;
- les obligations du vendeur (modalités et délai de livraison, garanties légales de conformité et des vices cachés, garanties conventionnelles, le cas échéant) ;
- les obligations de l’acheteur (paiement du prix, modalités de paiement) et les procédures de recouvrement en cas de non-paiement ;
- les droits de l’acheteur (délai de rétractation, modalités de retour et de remboursement, moyens de recours en cas de litige).
Rappel :
les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.
Les mentions facultatives
À côté de ces mentions principales, il est évidemment possible, et même conseillé, d’insérer dans vos CGV certaines clauses usuelles qui vont venir renforcer votre sécurité juridique ou encadrer votre responsabilité.
Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son client.
Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive.
Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Enfin, est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.
À noter :
le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive (par exemple, une clause qui viendrait limiter les obligations légales du vendeur à l’égard des consommateurs).
Le client peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses. De même, rien n’empêche vos clients de négocier les CGV que vous proposez. Cette négociation pouvant aboutir à leur faire bénéficier de conditions particulières qui dérogent sur certains points aux CGV classiques.
La communication des CGV
Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients professionnels qui les leur demandent.
Si les entreprises n’ont pas l’obligation de rédiger des conditions générales de vente, elles ont, en revanche, l’obligation de les communiquer à ses clients professionnels lorsqu’elles en ont. En effet, la loi dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.
Attention :
l’entreprise qui refuse de satisfaire à cette demande est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une société.
À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les clients d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent. Un fournisseur est donc en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, à un détaillant) les conditions qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux supermarchés).
En revanche, communiquer ses CGV, quand l’entreprise en dispose, à ses clients consommateurs est une obligation absolue. Le consommateur étant considéré aux yeux de la loi comme vulnérable par rapport au professionnel et devant donc être protégé.
L’acceptation des CGV par les clients
Pour éviter les litiges, les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs clients ont bien pris connaissance de leurs CGV et qu’ils les ont acceptées.
Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande.
En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.
La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.
À noter :
il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le client tant le recto que le verso du document.
Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le client, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.
Les décisions à prendre avant la fin de l’année
La fin de l’année 2022 approche à grands pas. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de certains dispositifs ou de faire valoir certains droits avant qu’il ne soit trop tard ou encore de remplir certaines obligations dans les délais. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre les décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes pour votre entreprise, ainsi que pour votre patrimoine personnel, de façon à boucler l’année en toute sérénité.Voici un tour d’horizon des principales actions à entreprendre ou à finaliser et des réflexions à mener d’ici le 31 décembre.
Les décisions comptables
Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, c’est le moment de préparer la clôture des comptes de l’exercice 2022. Et aussi d’établir ou de finaliser votre prévisionnel pour l’année 2023.
Préparer la clôture des comptes
Vous êtes nombreux à clôturer votre exercice au 31 décembre. Si c’est votre cas, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de décembre. Dans ce cadre, vous devrez vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan !
Et vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. D’une manière générale, vous devrez notamment vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont votre expert-comptable aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le cabinet d’expertise comptable ce que vous devrez préparer.
Finaliser votre prévisionnel 2023
L’année 2022, surtout dans sa seconde partie, a été marquée par une forte inflation et de nombreuses difficultés d’approvisionnement. Et l’on nous promet une année 2023 encore plus compliquée.
Dans un tel contexte, il est plus que jamais indispensable de bâtir, avec votre expert-comptable, un prévisionnel, tant d’activité que de trésorerie, ou de le finaliser en cette fin d’année. Il vous permettra de simuler votre activité d’un point de vue comptable et financier pour l’année à venir en fonction de vos objectifs et de la conjoncture. Dans ce cadre, vous pourrez simuler plusieurs hypothèses pour 2023, au minimum une hypothèse conforme à cette fin d’année et une hypothèse de crise.
Vous aurez aussi tout intérêt à mettre en place un tableau de bord. Constitué d’indicateurs simples et pertinents (chiffre d’affaires, nombre de devis signés, taux de transformation des rendez-vous commerciaux…), il vous permettra de suivre, au cours de l’année prochaine, vos réalisations en les comparant à vos prévisions. Ainsi, vous pourrez être alerté très vite en cas d’écart et mettre en place les mesures correctives les plus appropriées.
Tester votre fichier des écritures comptables
En fin d’année, les services fiscaux se montrent généralement très actifs en raison de la prescription imminente de certains impôts. Il est donc conseillé de tester son fichier des écritures comptables (FEC) afin de pouvoir le remettre, exempt d’erreurs, dès le début d’un éventuel contrôle.
Souscrire un prêt garanti par l’État
Il est encore possible de souscrire un prêt garanti par l’État (PGE) dit « résilience ». En effet, en raison du contexte économique difficile, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir ce dispositif jusqu’à la fin de l’année 2022. Peuvent en bénéficier les entreprises dont la trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques du conflit en Ukraine. Elles peuvent emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires.
Les décisions sociales
En termes de ressources humaines, la fin de l’année est l’occasion notamment de vous pencher sur votre politique salariale pour 2023, de profiter de certaines aides encore en vigueur pour embaucher un nouveau collaborateur et de planifier les entretiens annuels d’évaluation de vos salariés.
Adapter votre politique salariale
En raison du contexte inflationniste actuel, vos salariés voient très certainement leur pouvoir d’achat diminuer. Au-delà du levier de l’augmentation de rémunération, plusieurs outils sont à votre disposition pour les accompagner financièrement, dès maintenant ou dans les mois à venir. Ainsi, vous pouvez verser à vos salariés une prime de partage de la valeur, laquelle est exonérée de cotisations et de contributions sociales (voire d’impôt sur le revenu) si elle ne dépasse pas, en principe, 3 000 € par an et par employé.
Mais vous pouvez aussi actionner bien d’autres dispositifs comme les titres-restaurant, le forfait mobilités durables (pour les trajets domicile-travail de vos salariés) ou encore l’intéressement. Autant d’avantages qui viendront, peu ou prou, préserver le pouvoir d’achat de vos salariés tout en valorisant votre « marque employeur ».
Profiter d’aides à l’embauche
Comme beaucoup d’entreprises actuellement, vous envisagez peut-être d’embaucher un ou plusieurs salariés. Bon à savoir (ou à rappeler) : si vous recrutez un salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avant le 1er janvier 2023, vous pouvez prétendre à une aide exceptionnelle pour la première année du contrat. Cette aide s’élève à 8 000 € pour un salarié majeur et à 5 000 € pour un salarié de moins de 18 ans. Il est donc encore temps d’en profiter. Sachant toutefois que cette aide pourrait être reconduite en 2023, mais que ses modalités n’étaient pas encore connues à l’heure où ces lignes étaient écrites.
Faire le point sur l’emploi de travailleurs handicapés
Vous le savez, les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif, sous peine de devoir verser une contribution à l’Urssaf. Si vous êtes concerné mais que vous pensez ne pas pouvoir atteindre cet objectif au 31 décembre 2022, vous pouvez encore rectifier le tir, par exemple, en accueillant en stage des personnes handicapées ou en employant des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Planifier les entretiens annuels de vos salariés
Avec l’année qui s’achève vient le moment des éventuels entretiens annuels d’évaluation des salariés. S’il peut paraître plus pertinent d’attendre le début de l’année 2023 pour vérifier que les objectifs chiffrés de 2022 ont été atteints (objectifs de chiffre d’affaires, par exemple), vous avez toutefois intérêt à les planifier. Et ce, afin de permettre à vos salariés et à vous-même de les préparer.
Et pensez également à organiser les entretiens professionnels (portant sur les perspectives d’évolution) qui, eux, doivent obligatoirement avoir lieu tous les 2 ans.
Offrir des cadeaux de fin d’année
La fin de l’année est également l’occasion d’offrir un cadeau à vos clients et/ou à vos salariés. Si vous envisagez de le faire, sachez que les cadeaux (ou les bons d’achat) que vous donnerez à vos salariés en cette fin d’année 2022 seront exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dès lors que leur valeur n’excédera pas 171 € par salarié.
Rappelons aussi que la TVA supportée sur les cadeaux dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire (client, salarié, fournisseur...) est déductible. Et que les cadeaux, offerts tant à vos clients qu’à vos salariés, constituent, en principe, une charge déductible des bénéfices imposables de votre entreprise.
Les décisions fiscales
Le cas échéant, vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour déposer une réclamation fiscale concernant certains impôts mis en recouvrement ou payés en 2020 et pour demander le dégrèvement de votre contribution économique territoriale 2021.
Déposer une réclamation fiscale
Puisque nous sommes en décembre, le temps presse désormais pour faire valoir certains droits en matière de fiscalité. Ainsi, au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration. À ce titre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), les impôts locaux de 2021 et les éventuelles propositions de redressement reçues en 2019. Sachez aussi que vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible, cette fois sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.
Demander le dégrèvement de la CET 2021
Autre point à examiner, votre entreprise peut avoir droit à un plafonnement de sa contribution économique territoriale (CET) lorsque la somme de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont elle est redevable excède 2 % de la valeur ajoutée qu’elle a produite. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez, d’ici le 31 décembre 2022, demander au service des impôts des entreprises dont relève votre principal établissement le dégrèvement de votre CET 2021.
Les décisions patrimoniales
Les quelques semaines qui restent jusqu’à la fin de l’année peuvent être mises à profit pour adapter votre stratégie patrimoniale et pour optimiser votre fiscalité personnelle.
Consentir des dons à des associations
Pour faire baisser la pression fiscale en 2023, vous pouvez consentir des dons à des associations d’ici le 31 décembre 2022. En effet, ces dons ouvrent droit, selon les cas, à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 50 € ouvre droit à une réduction d’impôt de 33 €.
Mieux, lorsque le don est consenti en faveur d’un organisme d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques, la réduction d’impôt est de 75 % pour un don d’un montant inférieur ou égal à 1 000 €. La fraction au-delà de 1 000 € ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant donné. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois être supérieure à 20 % du revenu imposable.
Alimenter votre contrat retraite
Autre opération possible pour diminuer votre impôt, vous pouvez, si vous ne l’avez pas déjà fait, procéder à des versements complémentaires sur votre contrat retraite (Perp, contrat Madelin, PER…) avant la fin de l’année de façon à pouvoir profiter à plein de vos plafonds de déduction fiscale.
En effet, vous pouvez déduire de votre revenu imposable, dans la limite d’un plafond global, les cotisations que vous versez sur votre Perp. Ce plafond étant égal au plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % des revenus professionnels de l’année précédente, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) de l’année en cause, soit une déduction maximale de 32 909 € pour les versements effectués en 2022 ;
- ou 10 % du Pass de l’année précédente, soit une déduction maximale de 4 114 € pour les versements effectués en 2022.
Même logique pour le contrat Madelin : la déduction de vos cotisations sur vos revenus professionnels (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux) s’effectue à hauteur de 10 % du Pass, auxquels s’ajoutent 15 % du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois ce même plafond, soit une déduction maximale de 76 102 € pour 2022.
Pour le Plan d’épargne retraite (PER), le plafond de déduction dépend de votre statut social. Si vous êtes travailleur non salarié, vous appliquez le plafond alloué au contrat Madelin. Dans les autres cas, c’est le plafond du Perp qui doit être appliqué.
Réaliser un investissement immobilier
Depuis quelques mois, les taux des crédits immobiliers sont à la hausse. Au mois de novembre 2022, les taux atteignaient 1,80 % sur 15 ans, 2 % sur 20 ans et 2,20 % sur 25 ans. Et ce phénomène devrait se poursuivre. Toutefois, dans la mesure où les taux restent aujourd’hui relativement faibles, en particulier au regard de la forte inflation (6,2 % au mois d’octobre 2022), il peut être encore intéressant de mener sans tarder un projet d’acquisition immobilier.
Sans compter que si vous envisagez d’investir dans l’immobilier tout en défiscalisant, sachez que le dispositif Pinel, qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu, sera moins avantageux en 2023. En effet, la réduction d’impôt, qui s’élève aujourd’hui à 12 % pour un engagement sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans, tombera respectivement à 10,5 %, 15 % et 17,5 % en 2023. Sauf si vous choisissez d’acquérir un bien respectant les critères du nouveau dispositif Pinel+ (critères de performance énergétique notamment). Car dans ce cas, vous pourrez bénéficier des taux de réduction proposés jusqu’à présent.
En outre, la souscription d’un emprunt vous permettra de réduire la facture de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI). En effet, les charges d’emprunt liées à un bien immobilier constituent un passif déductible, ce qui va mécaniquement réduire votre base taxable à l’IFI.
Dans la continuité, vous aurez également intérêt à vous pencher sur votre assurance-emprunteur. Vous avez, là encore, un moyen de réaliser des économies. Pourquoi ? Parce que l’assurance proposée par la banque lors de la souscription d’un emprunt n’est généralement pas la meilleure du marché (niveau de garanties limité, cotisations élevées…). À ce titre, vous avez désormais la possibilité de résilier votre contrat d’assurance à tout moment.
Énergie : et si vous adoptiez les écogestes dans votre entreprise !
Pour passer l’hiver, mais surtout pour aborder l’indispensable transition écologique, il nous faut traquer les gaspillages énergétiques dans nos entreprises. À ce titre, des comportements plus vertueux doivent être adoptés.
Une ambition collective et un projet d’entreprise
La lutte contre le gaspillage et la recherche de l’efficacité énergétique doivent constituer un véritable projet d’entreprise.
Entre autres conséquences dramatiques, la guerre en Ukraine a mis en lumière notre extrême dépendance aux énergies. Dans cette période de pénurie et de flambée des prix, passer l’hiver apparaît donc comme un défi. Mais il ne faut pas s’y tromper, la fin de cette guerre, que chacun espère proche, ne débouchera pas sur une nouvelle période d’insouciance énergétique. En effet, la crise climatique à l’œuvre et la nécessité de nous affranchir de nos rapports « toxiques » avec certains pays fournisseurs nous ferment définitivement cette voie et nous invitent à adopter durablement, dans nos entreprises et ailleurs, des comportements plus vertueux. Des comportements qui nous permettront, à la fois, de réaliser des économies et de réduire l’impact climatique de nos activités professionnelles.
Une ambition collective
Si la mise en œuvre de solutions technologiques nous aidera à lutter contre le gaspillage énergétique, à elles seules, elles ne suffiront pas. Comme en matière de cybersécurité, la lutte contre le gaspillage et la recherche de l’efficacité énergétique ne posent pas seulement un problème technique. En la matière, l’ambition doit être collective, autrement dit impliquer tous les collaborateurs. Car ce sont eux qui appliqueront les écogestes.
Une gestion de projet
Comme dans tout projet, le point de départ consiste à fixer des objectifs et à définir un calendrier qui laissera le temps de les atteindre. D’un point de vue formel, un cahier des charges, qui détaillera les pistes à suivre et les résultats intermédiaires attendus à l’issue de chaque étape, pourra être rédigé. Une fois cet acte fondateur posé, il conviendra de constituer un groupe projet composé de collaborateurs à la fois motivés et très au fait du fonctionnement quotidien de l’entreprise. Il faudra les libérer partiellement de certaines de leurs tâches professionnelles et les doter de moyens qui leur permettront, dans un premier temps, de dresser un état des lieux. Dans ce cadre, ils pourront, par exemple, mandater un prestataire afin qu’il procède à un audit énergétique (des bâtiments, des systèmes de chauffage, des machines et, le cas échéant, des process industriels) ou qu’il étudie le coût d’une transition énergétique (passage du gaz à l’électricité, par exemple) ou celui de travaux d’isolation des locaux de l’entreprise.
De l’analyse et des recommandations à la conduite du changement
Le projet de lutte contre le gaspillage énergétique dans l’entreprise ne pourra être mis en oeuvre que si vos collaborateurs y sont étroitement associés.
De l’analyse aux recommandations...
À l’issue de cet état des lieux, le groupe projet sera invité à présenter ses recommandations. Autrement dit, les solutions techniques mais également humaines qui, une fois déployées, permettront d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique initialement définis. Sachant que par solutions humaines, il faut comprendre l’adoption de comportements plus économes en termes d’énergie. Cela peut aller de simples écogestes de bon sens, comme éteindre les lumières et l’ordinateur en quittant son bureau, réduire le chauffage la nuit et le week-end, favoriser le covoiturage… à la définition de process de production ou d’une organisation du travail moins énergivores.
À ce titre, certains sites gouvernementaux, comme et , abritent plusieurs guides et fiches pratiques qui présentent des écogestes et mesurent leur efficacité. Le plus souvent, ces écogestes sont regroupés par secteurs d’activité (industrie, agriculture…) ou par thèmes transverses (mobilité durable, usages numériques plus sobres…).
Précision :
« Les entreprises s’engagent »
... à la conduite du changement
La mise en œuvre de ces solutions constitue l’étape suivante du déploiement du projet. Sans surprise, elle suppose une adhésion massive des collaborateurs. Celle-ci sera plus facilement obtenue en les associant le plus tôt possible au projet. Concrètement, s’il n’est pas envisageable de tous les accueillir dans l’équipe (sauf dans les TPE), il est recommandé de leur mettre à disposition des outils de communication (blog, messagerie électronique, intranet…) grâce auxquels ils pourront non seulement suivre l’avancée du projet (la transparence est ici de mise), mais aussi soumettre des idées pour définir des écogestes plus adaptés à leur pratique professionnelle.
Bien entendu, en fonction de la complexité des solutions retenues, il sera peut-être nécessaire d’organiser des sessions de formation. Ces dernières pourront être communes, si un seul métier est exercé dans l’entreprise, ou spécifiques, en fonction des services et des activités des uns et des autres.
Une fois encore, l’Ademe peut se révéler très utile grâce à . Une dizaine de formations, pour l’essentiel gratuites, sur les entreprises en général et sur les sociétés industrielles en particulier, et une trentaine sur l’adaptation énergétique des bâtiments y sont proposées.
10 incontournables écogestes à effectuer au bureau
Voici une liste de 10 actions que vous pouvez facilement et rapidement accomplir ou mettre en place :1 - favorisez le covoiturage et la mobilité douce de vos collaborateurs (vélo, trottinette, voiture électrique…)2 - invitez vos collaborateurs à télétravailler les mêmes jours afin, pour ces jours-là, de réduire la consommation énergétique de vos locaux3 - faites passer le thermostat à 19° en hiver et à 26° en été (climatisation)4 - programmez le chauffage pour qu’il baisse la nuit et les week-ends5 - utilisez le Wi-Fi plutôt que la 4G sur les smartphones de votre équipe6 - éteignez les lumières en sortant, ou mieux, installez des détecteurs de présence7 - remplacez vos vieux néons de plafond par des tubes LED8 - placez vos bureaux au plus près des fenêtres pour réduire le besoin de lumière9 - éteignez vos ordinateurs, vos écrans et vos photocopieurs la nuit et le week-end10 - coupez, si c’est possible, l’eau chaude dans les sanitaires de vos bureaux.
Le suivi et l’évaluation du projet
Pour qu’il soit mené jusqu’à son terme, l’avancement du projet doit donner lieu à un suivi et être régulièrement évalué.
L’avantage avec l’énergie est qu’elle est facilement quantifiable. L’adoption d’indicateurs destinés à mesurer les progrès réalisés tout au long de la démarche ne posera donc aucun problème. Les plus évidents étant la consommation de gaz et d’électricité de l’entreprise ou encore la quantité de gaz à effet de serre que ses activités émettent. Sur ce dernier point, l’Ademe, encore elle, propose sur lequel il est possible de trouver des outils permettant de dresser le bilan des émissions de gaz à effet de serre d’une organisation.
À noter :
l’Ademe propose une aide aux PME industrielles qui souhaitent réaliser une étude d’optimisation de la performance énergétique. Elle peut couvrir jusqu’à 70 % des dépenses engagées. Par ailleurs, les entreprises (commerces, artisans, restaurants, bureaux…) propriétaires ou locataires d’un bâtiment à usage tertiaire de moins de 1 000 m2peuvent bénéficier d’une aide. Baptisée « Coup de pouce », cette dernière prend la forme d’une prime, distribuée par des entreprises de l’énergie (les fameux CEE), qui permet de réduire le coût de remplacement d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude au charbon, au fioul ou au gaz par un dispositif moins énergivore. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de France Rénov’ au 0 808 800 700.
Plus largement, l’avancement du projet pourra être régulièrement évalué, donnant lieu à des points d’étapes auxquels tous les collaborateurs de l’entreprise seront invités à participer. Et pour créer une implication encore plus forte, vous pourrez même intégrer les progrès à réaliser, en termes d’adoption d’écogestes, dans les objectifs personnels de vos collaborateurs.
N’hésitez pas également à convier vos partenaires (clients, fournisseurs, banquiers, conseils…) à ces points d’étapes afin de les impliquer dans cette dynamique vertueuse qui nous concerne tous.
Factures 2022 : êtes-vous au point ?
Vous le savez : toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à une autre entreprise est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires.À ce titre, nous vous invitons à profiter de ce début d’année 2022 pour vérifier que vos factures sont bien conformes à la règlementation. Et aussi à commencer à vous préparer à la facturation électronique qui s’imposera à vous dans quelques années. Voici un point sur ce sujet.
Les mentions obligatoires sur les factures
Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi. Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.
Les mentions générales
Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général, qui sont reproduites sur le modèle ci-dessous :
1 - Le nom de votre entreprise, ou la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;
2 - Les nom et adresse de votre client (et l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse du client) ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d’identification à la TVA, notamment en cas de livraisons intracommunautaires ;
3 - La date de la facture ;
4 - Le numéro de la facture et l’éventuel numéro du bon de commande ;
5 - La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;
6 - Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;
7 - Toute réduction de prix (remise, rabais) acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;
8 - La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;
9 - L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;
10 - Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé ;
11 - Si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, la mention selon laquelle vous acceptez les règlements par chèque ou par carte bancaire.
Attention :
le défaut de facturation ou l’omission d’une mention obligatoire sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale (une société, une association...).
Les mentions spécifiques à certaines opérations
Certaines mentions relatives à l’application d’un régime spécifique en matière de TVA doivent également être indiquées sur les factures.
Ainsi, si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la référence à la disposition du Code général des impôts ou de la directive communautaire en vertu de laquelle l’opération bénéficie de cette exonération.
Autre cas particulier, si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Aucun montant ni taux de TVA ne devant évidemment figurer sur vos factures dans ces deux hypothèses.
Enfin, parfois, c’est le client qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le client « autoliquide » la TVA. Les factures correspondantes doivent alors impérativement comporter le numéro d’identification à la TVA du client et la mention : « Autoliquidation ».
Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire lorsque vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, c’est la disposition qui fonde l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) qui doit être indiquée sur la facture, en lieu et place de la mention « Autoliquidation ». Et n’oubliez pas, là aussi, de faire apparaître le numéro d’identification à la TVA de l’acheteur.
Et les ventes aux particuliers ?
S’agissant des ventes de produits à des particuliers, l’émission d’une facture n’est obligatoire que si le client le demande ou s’il s’agit d’une vente à distance. Dans les autres cas, il vous suffit de remettre un simple ticket de caisse à votre client. Et pour une prestation de services réalisée pour un particulier, vous êtes tenu d’établir, sinon une facture, tout au moins une note, dès que le prix est supérieur à 25 € TTC ou si votre client vous le demande.
La facture électronique
Une fois les factures établies, vous avez le choix de les transmettre au format papier ou de façon dématérialisée, sauf à l’égard de vos clients du secteur public (État, collectivités territoriales...) pour lesquels la facturation électronique est de rigueur. Une facture électronique qui va devenir obligatoire dans les années à venir à l’égard de tous vos clients professionnels, établis en France, qui relèvent de la TVA.
Initialement prévue pour 2023, l’obligation de facturation électronique a été retardée de plusieurs mois afin de laisser le temps aux entreprises de s’y préparer, notamment en adaptant leur système d’information.
Une facture électronique, c’est quoi ?
Une facture électronique est une facture qui doit être créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Autrement dit, l’ensemble du processus de facturation doit être dématérialisé. Ainsi, une facture créée sur support papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue par mail, ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.
Une obligation progressive
La facturation électronique va progressivement s’imposer aux entreprises. Ainsi, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’obligation d’émettre de telles factures, elle, entrera en vigueur de façon échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise. Elle s’appliquera à compter :
- du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
- du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et pour les micro-entreprises.
Pour satisfaire à cette nouvelle obligation, les entreprises devront avoir recours à une plate-forme de dématérialisation, comme le portail public Chorus Pro. En pratique, vous adresserez vos factures à vos clients professionnels par l’intermédiaire de cette plate-forme, laquelle se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plate-forme de dématérialisation utilisée par votre client. Vous n’enverrez donc plus directement vos factures à vos clients professionnels.
Faut-il adhérer à une association de commerçants ?
Les associations de commerçants sont très présentes dans les villes et villages de France ainsi que dans les centres commerciaux. Ainsi, selon la Fédération française des associations de commerçants (FFAC), plus de 6 000 associations de commerçants, d’artisans et de prestataires de services existent en France.Si vous êtes commerçant, quel intérêt avez-vous à adhérer à une telle association ? Voici quelques éléments de réponse.
Le rôle d’une association de commerçants
Une association de commerçants assure la défense et la promotion de ses membres.
Les associations de commerçants ont d’abord pour objet de défendre les intérêts de leurs membres auprès des autorités (municipalité, administrations, chambre de commerce ou des métiers, office du tourisme, conseil départemental...). Se regrouper en association permet donc aux commerçants de mieux faire entendre leur voix auprès des principaux décideurs de la vie locale, ainsi qu’auprès des autres acteurs économiques (entreprises locales, presse, autres associations…). En outre, elles sont, en principe, sinon associées, tout au moins consultées lors de la prise de décisions en matière notamment d’aménagements locaux (stationnement, circulation, piétonnisation des rues, projet d’urbanisme commercial...) ou d’organisation d’évènements notamment culturels.
Les associations de commerçants jouent également un rôle essentiel pour la dynamisation des quartiers ou des centres commerciaux dans lesquels elles sont présentes. En effet, elles permettent de renforcer l’activité commerciale de la zone considérée. Elles contribuent ainsi à la promotion et au développement de l’activité de leurs adhérents par la mutualisation de moyens (outils de communication, de marketing et de publicité), la mise en place d’opérations collectives (animations commerciales, jeux concours, défilés...) ou la proposition de nouveaux services aux clients (cartes de fidélité, chèques-cadeaux, prise en charge partielle du coût du stationnement...).
Ainsi, pour un commerçant, un artisan ou un prestataire de services, adhérer à une telle association peut constituer une bonne façon d’améliorer sa notoriété, d’augmenter le trafic dans son magasin, de fidéliser sa clientèle et donc d’accroître son chiffre d’affaires. Sans compter qu’elle lui donne l’occasion de rencontrer d’autres commerçants, de partager des problématiques communes et de porter des projets avec eux. Elle lui permet aussi d’être mieux informé des opérations évènementielles mises en place dans sa ville ou dans son quartier et d’avoir connaissance de certaines études réalisées par divers organismes (la CCI, par exemple) qui peuvent l’intéresser (bilan commercial des soldes ou des fêtes de fin d’année...).
Sachant que bien entendu, l’efficacité d’une association de commerçants est liée notamment au dynamisme de ses dirigeants et à celui de ses adhérents, à la notoriété de certains d’entre eux (une grande surface, un magasin de marque franchisée…), et à sa capacité à fédérer, à mobiliser et à se faire entendre auprès des autorités…
Le fonctionnement d’une association de commerçants
Une association de commerçants fonctionne comme n’importe quelle autre association. Pour y adhérer, le paiement d’une cotisation annuelle est notamment requis.
La plupart des associations de commerçants sont enregistrées auprès de la mairie de la commune considérée et de la chambre de commerce et d’industrie. Il est donc très facile de les repérer. Bien entendu, pour adhérer à l’association de commerçants de votre ville ou de votre quartier, il vous faudra payer une cotisation annuelle dont le montant s’élève généralement à une centaine d’euros maximum.
Inconvénient de l’adhésion : en étant membre d’une association de commerçants, vous perdez un peu de liberté car vous êtes contraint de vous plier aux décisions votées par la majorité même si vous n’y êtes pas favorable.
Et sachez que toute personne est libre d’adhérer à une association. Ce principe est régulièrement rappelé par les tribunaux. Ainsi, la clause d’un bail commercial qui oblige le commerçant à adhérer, pendant toute la durée du bail, à l’association de commerçants présente, par exemple, dans le centre commercial dans lequel il est installé est nulle. Un commerçant peut donc valablement refuser de verser à l’association de commerçants les cotisations qu’elle lui réclame dès lors qu’il n’y a pas adhéré ou après qu’il s’en est retiré.
Comme toute association, une association de commerçants doit être enregistrée à la préfecture et dispose ainsi de la personnalité juridique. En principe, elle n’a pas de but lucratif, ses profits ne pouvant pas être partagés entre ses membres. Elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Elle définit librement ses organes de fonctionnement et leurs attributions ainsi que l’organe habilité à la représenter vis-à-vis des tiers. Traditionnellement, les organes de l’association sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. Ce dernier étant composé du président et éventuellement d’un ou de plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et éventuellement d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et éventuellement d’un trésorier adjoint.
Pourquoi établir un plan de continuité d’activité ?
Aucune entreprise n’est à l’abri d’un sinistre qui pourrait bloquer son activité. S’y préparer en établissant un PCA reste le meilleur moyen de limiter son impact.
Cartographier les risques
Identifier les risques qui pourraient bloquer l’activité de l’entreprise est la première démarche à mettre en œuvre lorsque l’on établit un PCA.
Le risque zéro n’existe pas. Même si toutes les précautions ont été prises, une entreprise peut être victime d’un incendie, d’une inondation, d’une cyber-attaque ou encore d’un bris de machine qui, brutalement, va interrompre son activité ou significativement la réduire. Alors plutôt que de se contenter d’espérer que le pire n’arrive jamais, mieux vaut s’y préparer en établissant un plan de continuité d’activité (PCA). Un document dans lequel seront décrits les risques majeurs qui pèsent sur l’entreprise et les actions à mettre en place pour en limiter les impacts en cas de survenue.
Une entreprise est une machinerie complexe qui, suite à un évènement indésirable, peut se gripper.
La première démarche qui préside à l’élaboration d’un PCA consiste donc à identifier les fonctions et les lignes métiers de l’entreprise (chaîne de production, service de maintenance, service comptable, système informatique…) dont l’arrêt brutal mettrait en péril, à très court terme, l’activité de l’entreprise.
Alors, comment faire ?
• Avant tout, il va falloir identifier les risques qui pèsent sur l’entreprise compte tenu de son activité, de sa localisation et de son organisation (multi-sites, par exemple…). Grâce à une matrice de criticité (mesurant la fréquence et la gravité des risques), il sera possible de les hiérarchiser et ainsi de ne prendre en considération que ceux qui sont majeurs.• Ensuite, pour chaque ligne métier, devra être défini le « temps d’arrêt maximum supportable » (TAMS), soit la durée au-delà de laquelle son arrêt entraînerait des dommages sérieux pour l’entreprise.• Enfin, devra être estimé le « temps d’arrêt probable » (TAP). Un délai qui, bien entendu, variera en fonction du sinistre envisagé.
Identifier les vulnérabilités
Désormais doté d’une liste de risques, il devient possible de mesurer l’impact de chaque sinistre sur les lignes métiers et ainsi de savoir si le temps d’arrêt probable provoqué par chacun d’eux est supérieur au temps d’arrêt maximum acceptable. Lorsque c’est le cas, des actions visant à réduire le TAP devront être envisagées.
Exemple : une entreprise située en bord de fleuve peut être victime d’une inondation. 10 jours sont nécessaires pour changer les moteurs électriques qui assurent le fonctionnement de la chaîne de production. Or, il n’y a que 5 jours de stock. Cette situation devra être prise en compte dans le PCA.
Important :
élaborer un PCA est un travail qui demande un savoir-faire très spécifique et beaucoup d’expérience. Il ne peut être correctement réalisé qu’en se faisant accompagner par un consultant spécialisé.
Réagir de manière adaptée
Lorsque survient un sinistre, chacun doit savoir quel rôle jouer dans les actions qui permettront à l’entreprise de redémarrer son activité.
Identifier les risques majeurs qui pèsent sur l’entreprise n’est pas le seul objectif d’un PCA. Établir ce document va également permettre de définir l’ensemble des actions à mener suite à un sinistre pour en réduire les impacts et rendre possible un redémarrage de l’activité.
Le plan d’urgence
Pour garder le contrôle de la situation et agir de manière efficace au moment d’un sinistre, il faut être préparé. Raison pour laquelle une cellule de crise sera constituée lors de la réalisation du PCA. Outre un directeur, elle comprend les responsables des lignes métiers sensibles et une personne chargée de fournir les moyens nécessaires à la gestion de la crise.
Elle a pour mission d’organiser le déploiement du plan de continuité de l’activité. Autrement dit :• d’analyser la situation (liste des dégâts, fonctionnement des services…) ;• de mettre en œuvre les actions d’urgence (prévenir les pompiers, les forces de l’ordre, mettre en sûreté les personnes et les biens, contacter son assureur…) ;• de communiquer sur le sinistre vers les équipes et l’extérieur ;• de préparer les phases de gestion de crise et de redémarrage de l’activité (mobiliser les moyens humains et techniques, mobiliser des partenaires et des prestataires, trouver de nouveaux locaux…).
Et attention, les personnes en charge d’appliquer le PCA doivent parfaitement connaître leur rôle afin d’agir correctement et sans attendre dès la survenue du sinistre. Une préparation est donc nécessaire.
Précision :
afin de limiter le risque d’apparition de rumeurs suite à un sinistre et de rétablir la confiance en interne et vers l’extérieur, il convient de mettre en place un plan de communication, définir les messages et charger un porte-parole de les diffuser.
La gestion de la crise
L’étape de cartographie a mis en évidence les principaux risques de voir un sinistre bloquer le fonctionnement d’un service clé de l’entreprise.
Une des missions du PCA consiste à définir les actions à mettre en œuvre pour traiter ces risques. Ainsi, en cas de sinistre, elles permettront d’atteindre, très rapidement, un niveau de fonctionnement minimum acceptable. Deux types d’actions pourront être lancés (elles seront définies en tenant compte de leur efficacité et de leur coût) :• des solutions palliatives destinées à contourner les services interrompus (activation d’un accord de sous-traitance signé avec un autre industriel lors de l’élaboration du PCA permettant une production minimum, par exemple) ;• des solutions de secours grâce auxquelles l’entreprise pourra retrouver un niveau de fonctionnement dégradé mais acceptable (emploi d’intérimaires pour étiqueter à la main des bouteilles de liqueur après l’incendie de la machine dédiée, par exemple).
À savoir :
l’établissement d’un PCA a également l’avantage de réduire, en amont, la plausibilité du sinistre, comme par exemple en déménageant un entrepôt vers un site plus élevé pour limiter les risques d’inondation.
Le redémarrage de l’activité
Les solutions mises en œuvre dans le cadre de la gestion de crise sont par nature transitoires. Elles vont perdurer le temps que les conditions de redémarrage de l’activité soient réunies. Les actions permettant un redémarrage de l’entreprise seront également listées et présentées avec précision dans le PCA.
À noter :
pour s’assurer que certaines solutions inscrites dans le PCA pourront être déployées avec efficacité en cas de sinistre (utilisation d’une machine de secours, remplacement d’un homme-clé défaillant…), il est important de les tester très en amont.
Mettre à jour le PCA
Un PCA n’a pas vocation à finir au fond d’un tiroir. Il doit être actualisé pour tenir compte de l’évolution des risques qui pèsent sur l’entreprise.
L’entreprise et les risques qu’elle encourt évoluent en permanence. Le PCA étant là pour y répondre, il doit également être mis à jour régulièrement pour prendre en compte :• les nouveaux risques qu’engendre l’évolution de l’entreprise (changement d’organisation, d’activité…) ;• l’évolution des priorités (développement de l’export, renforcement d’une activité jusque-là secondaire…) ;• le changement du personnel (prendre en compte les nouveaux métiers, identifier les nouveaux hommes-clés…) ;• l’évolution des ressources sur lesquelles l’entreprise peut compter en cas de crise (changement de local d’entreposage de certains matériels, changement de matériel et donc des conditions d’utilisation…) ;• les enseignements tirés d’un récent sinistre (correction des procédures initialement envisagées…).
Généralement, un PCA est mis à jour tous les 2 à 3 ans.
Un PCA toujours disponible
En cas de sinistre, le PCA doit être accessible rapidement et facilement, à toutes les personnes (et à elles seules) qui sont missionnées pour le mettre en œuvre. Aussi, le PCA et ses annexes doivent être :- stockés dans des endroits connus par ces personnes ;- tenus à jour ;- traduits dans d’autres langues, si besoin ;- stockés dans un lieu à l’abri des sinistres.
La règlementation à connaître pour installer une enseigne commerciale
L’installation d’une enseigne sur un local commercial est soumise à un certain nombre de règles. Voici, dans les grandes lignes, ce qu’un commerçant doit savoir en la matière avant de mettre son projet à exécution.
Une autorisation préalable
Une autorisation préalable à l’installation d’une enseigne est requise dans certains cas.
En tant que commerçant, vous avez évidemment le droit d’installer une enseigne sur votre magasin pour en signaler la présence et en préciser l’objet (bar, hôtel, optique, vêtements, maroquinerie...), l’enseigne constituant un élément du fonds de commerce au même titre que la clientèle.
En principe, l’installation d’une enseigne est libre. Toutefois, le commerçant doit demander une autorisation préalable à la mairie si son commerce est situé dans une commune couverte par un règlement local de publicité (RLP) édicté par la commune considérée.
De même, une autorisation est requise pour apposer une enseigne notamment sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, sur un monument naturel ou un arbre, dans un site classé, un parc national, une réserve naturelle, un parc naturel régional ou encore une zone protégée autour d’un site classé.
Enfin, l’installation d’une enseigne à faisceau laser requiert également une autorisation.
Précision :
l’installation d’une enseigne sans autorisation peut être punie par une amende de 7 500 € au plus.
En pratique, lorsqu’une autorisation est requise, la demande doit être adressée par le commerçant au moyen d’un formulaire (Cerfa n° 14798*01) :- soit en mairie, si la commune est couverte par un RLP ;- soit en préfecture, en l’absence de RLP.
Un seul formulaire peut être utilisé pour déclarer jusqu’à trois enseignes (au-delà, une autre demande doit être déposée).
Attention :
certaines communes ou certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE). Les tarifs sont publiés par arrêté municipal et sont généralement consultables sur le site de la mairie.
Lorsque le local commercial est loué, le bailleur propriétaire de l’immeuble ne peut pas interdire au commerçant d’apposer une enseigne. En revanche, des clauses du bail commercial, voire du règlement de copropriété s’il existe, peuvent valablement fixer certaines conditions à la pose d’une enseigne au regard notamment des caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique et soumettre à l’accord du bailleur ou du syndic toute modification de cette enseigne.
Emplacement et dimensions de l’enseigne
L’emplacement choisi pour installer une enseigne en conditionne la taille et la forme.
Lettres individuelles découpées, panneau, bandeau-support, caisson double face... Quelle que soit sa forme, l’enseigne doit être composée de matériaux durables et conservée en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement par le commerçant. Bien entendu, elle ne doit pas gêner la circulation, la signalisation et la sécurité routière.
À noter :
en cas de cessation d’activité, l’enseigne doit être supprimée dans les 3 mois, sauf si elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
Les emplacements autorisés pour installer une enseigne offrent beaucoup de possibilités : en façade (parallèle ou perpendiculaire au mur), sur une toiture, sur une clôture, sur un auvent ou une marquise, sur le garde-corps d’un balcon ou d’une fenêtre. Une enseigne peut également être scellée ou posée sur le sol. Sachant que la taille et la forme autorisées pour une enseigne varient selon l’emplacement choisi.
Enseigne fixée au sol
Une enseigne fixée au sol ne peut dépasser 6 m2 (12 m2dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants). Lorsqu’elle fait plus de 1 m2, elle doit être installée à au moins 10 mètres de la baie d’un immeuble.
Sa hauteur est limitée en fonction de sa largeur :- à partir de 1 m de largeur, elle ne doit pas dépasser 6,5 m de haut ;- lorsqu’elle fait moins de 1 m de large, elle ne doit pas dépasser 8 m de haut.
Enseigne en façade
Installée en façade, l’enseigne ne doit pas couvrir plus de 15 % de la surface (portée à 25 % lorsque la surface de la façade est inférieure à 50 m2), vitrine comprise. Et lorsqu’elle est apposée à plat sur un mur ou parallèle au mur, elle ne doit pas en dépasser les limites, ni constituer une saillie de plus de 0,25 m.
Enseigne sur toiture ou terrasse
L’installation d’une enseigne sur le toit d’un immeuble ou sur une terrasse en tenant lieu est soumise à des règles différentes selon que l’activité signalée est ou non l’activité principale de l’immeuble concerné.
Lorsque l’activité que l’enseigne signale est exercée dans plus de la moitié du bâtiment, l’enseigne ne peut pas dépasser 3 m de haut, si la façade a moins de 15 m de haut. Pour une façade de plus de 15 m de haut, la hauteur de l’enseigne est limitée au 1/5 de la façade, dans la limite de 6 m.
Lorsque l’activité signalée par l’enseigne est exercée dans moins de la moitié de l’immeuble, l’enseigne doit respecter la législation applicable aux enseignes publicitaires sur toiture ou sur terrasse. Ainsi, l’enseigne ne doit pas excéder :- 1/6 de la hauteur de la façade de l’immeuble et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure à 20 m ;- 1/10 de la hauteur de la façade et au maximum 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m.
Dans tous les cas, l’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 50 cm de haut.
La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut en principe excéder 60 m2.
En pratique :
la réglementation en la matière étant très spécifique, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des services municipaux pour vérifier la conformité de l’installation envisagée avec celle-ci.
Et les enseignes lumineuses ?
Les enseignes lumineuses doivent respecter certaines normes techniques.
Les enseignes lumineuses sont autorisées, mais doivent respecter certaines normes techniques fixées par arrêté (seuil maximal de luminance, efficacité lumineuse).
Par ailleurs, elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, cette obligation ne s’appliquant pas aux éclairages d’urgence comme celui des pharmacies ni aux éclairages publics. Lorsque l’activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, elles doivent être éteintes au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et peuvent être rallumées au plus tôt 1 heure avant la reprise de cette dernière.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Quant aux enseignes clignotantes, seules les pharmacies et les autres services d’urgence peuvent en être équipés.
Précision :
ce n’est que depuis le 1er juillet 2018 que toutes les enseignes et publicités lumineuses (sauf dérogation) doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin. En effet, auparavant, cette obligation, introduite par un décret du 30 janvier 2012, ne s’appliquait qu’aux nouvelles publicités lumineuses dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants et aux nouvelles enseignes lumineuses, quelle que soit la taille de la commune, c’est-à-dire installées après cette date. Car un sursis de 6 ans, qui a donc expiré le 1er juillet 2018, avait été accordé aux publicités et enseignes lumineuses installées avant janvier 2012. Quant aux règles d’extinction des publicités lumineuses dans les agglomérations de plus de 800 000 habitants, elles sont prévues par le règlement local de publicité propre à la commune concernée.
5 conseils pour préserver votre e-réputation
Dans le monde « digitalisé » d’aujourd’hui, l’e-réputation de l’entreprise doit être regardée comme un véritable actif. Tout doit donc être mis en œuvre pour la préserver !
Selon les derniers chiffres de Médiamétrie, 84 % des Français de 2 ans et plus sont connectés à Internet et l’utilisent régulièrement. Les avis de clients mécontents, la vidéo d’un collaborateur faisant une blague de mauvais goût ou la photo de jeunesse d’un chef d’entreprise en train de dévoiler son anatomie lors d’une soirée arrosée peuvent donc, à tout moment, s’inviter sur les réseaux sociaux pour y faire le buzz et mettre à mal l’e-réputation de l’entreprise.
Voici 5 conseils pour limiter les risques de crise et y faire face lorsqu’elle survient malgré les efforts fournis.
1) Faire un bilan e-réputation
Savoir comment votre entreprise est considérée par les internautes est la première démarche à accomplir.
Avant tout, il est conseillé de dresser un bilan e-réputation grâce auquel vous allez découvrir comment votre entreprise est perçue par les internautes.
Cette opération vous permettra également d’identifier des éléments qui pourraient nuire (ou nuisent déjà) à son image. Cette démarche comprend 2 volets :
Que dit-on de votre entreprise sur Internet ?
Très simplement, lors de cette première phase, vous devrez lancer des recherches, via Google, Bing ou Qwant en utilisant le nom de l’entreprise, de ses dirigeants, de ses produits et de ses marques. Et ne vous contentez pas des résultats dits « Web ». Cliquez aussi sur les volets « Images », « Vidéos » et « Réseaux » (lorsqu’ils existent) pour découvrir les différents types d’informations associés à votre entreprise. Réitérez ensuite ces recherches sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+…).
Lorsqu’un contenu critique ou potentiellement « nuisible » apparaît, consultez la page sur laquelle il se trouve, enregistrez son adresse et tentez d’identifier son auteur.
Comment présentez-vous votre entreprise sur Internet ?
Si l’image de votre entreprise dépend des commentaires des internautes, elle est aussi tributaire des outils de communication que vous avez mis en place pour la faire connaître. Vous devez donc, là encore, vous glisser dans la peau d’un internaute lambda afin de passer en revue le site Internet de votre entreprise.
L’objectif ici est simple : traquer ce qui irrite les internautes ou leur donne une mauvaise image de l’entreprise (pages jamais ou rarement mises à jour, rubrique d’actualités sans… actualités, questions d’internautes restées sans réponse, page non adaptée à un affichage sur un smartphone…). Cette même démarche d’analyse devra également être menée sur les comptes détenus par l’entreprise et ses dirigeants sur les réseaux sociaux.
2) Mettre en place une veille
Suivre, en temps réel, ce qui se dit sur votre entreprise vous permettra d’anticiper la survenue d’un bad buzz.
Immédiatement après avoir dressé votre bilan e-réputation, vous devrez mettre en place une veille qui vous permettra de capter les signes avant-coureurs d’une crise ou d’un « bad buzz ». Si vous avez identifié des forums ou des groupes de discussion sur lesquels vous avez déjà été critiqué, rendez-leur visite régulièrement afin de prendre la température et abonnez-vous à leurs flux.
De manière plus globale, vous pouvez également utiliser des outils dédiés qui vont vous alerter lorsque des contenus en rapport avec votre entreprise, ses marques, ses produits ou ses dirigeants seront mis en ligne ou diffusés sur les réseaux sociaux. Certains, comme Google Alertes, sont gratuits ; et d’autres, comme Synthesio ou Mention, plus spécifiques et donc plus efficaces, sont payants (abonnements à partir de 30 € par mois).
3) Sensibiliser toute l’équipe
La réputation de l’entreprise est l’affaire de tous. Sa préservation doit être assurée par les dirigeants comme par les salariés.
Quasiment tout le monde utilise Internet, nous l’avons déjà dit. Toutes les informations, tous formats confondus, qui s’y trouvent et qui ont un lien avec l’entreprise sont donc susceptibles d’y être dénichées.
Conséquence : les dirigeants de l’entreprise et leurs collaborateurs doivent être très vigilants lorsqu’ils interviennent sur Internet ou sur les réseaux sociaux :- pour le compte de l’entreprise : attention aux réponses cinglantes adressées à des clients mécontents, aux actualités publiées avec des fautes d’orthographe, aux photos prises pendant une pause et laissant penser que personne ne travaille dans l’entreprise… ;- dans le cadre privé : en évitant de publier une critique visant un manager ou un client sur sa page Facebook, une photo ou d’une vidéo illustrant un accident du travail ou un problème technique rencontré dans l’entreprise.
En outre, tout le monde, désormais, est en possession d’un téléphone pouvant filmer et photographier. Chacun doit donc éviter de trop se « faire remarquer » lorsqu’il représente l’entreprise dans un lieu public.
Illustration :
il y a presque 10 ans, aux États-Unis, 2 salariés d’une célèbre chaîne de fabrication et de livraison de pizzas à domicile se sont filmés préparant les produits de manière peu ragoûtante (c’est le moins que l’on puisse dire !). Postée sur YouTube, la vidéo a été vue des millions de fois et a créé un climat de défiance à l’égard de la marque et suscité des doutes sur les conditions d’hygiène dans lesquelles ses produits étaient préparés.
4) Effacer les données critiques
Il est conseillé, lorsque cela est possible, de faire disparaître d’Internet les informations qui pourraient nuire à l’e-réputation de l’entreprise.
Lors de votre e-bilan, vous pouvez découvrir une information de nature à entacher l’e-réputation de l’entreprise. Lorsqu’elle se trouve sur le site Internet ou sur le compte d’un réseau social de l’entreprise, supprimez-la ou corrigez-la sans attendre. Si ce n’est pas le cas, contactez son auteur ou le responsable du site pour qu’il la supprime. S’il refuse ou ne réagit pas, 2 solutions s’offrent à vous :- l’information constitue une atteinte au respect de la vie privée d’un dirigeant ou d’un collaborateur de l’entreprise. Dans cette hypothèse, la personne concernée peut exercer son droit à l’oubli numérique en saisissant les éditeurs des moteurs de recherche (via un formulaire spécifique proposé sur leur site) et en leur demandant de déréférencer la page sur laquelle se trouve l’information ;- l’information ne constitue pas une atteinte à la vie privée (ou la demande de déréférencement n’a pas abouti). Il est alors possible de mandater une agence Web afin qu’elle « noie » la page en créant d’autres pages « positives » répondant aux mêmes termes de recherche.
5) Faire face au bad buzz
Nier et refuser de communiquer est la pire des attitudes à adopter lorsque l’on doit faire face à un bad buzz.
Lorsqu’un bad buzz éclate (déchaînement de critiques sur Internet), car il n’est pas toujours possible de l’éviter, il convient de suivre quelques règles :- reconnaître les faits (sans les minimiser, au risque de créer un nouveau bad buzz) ;- rappeler que l’on a compris pourquoi cette information ou ce comportement ont pu choquer, décevoir ou contrarier les internautes ;- présenter des excuses publiques si c’est nécessaire ;- supprimer le message incriminé lorsque c’est possible ;- et surtout, rester toujours courtois, même face à des internautes agressifs.
Oser l’humour :
en 2015, un célèbre fabricant de cannelés a été victime d’un rongeur très photogénique (la photo diffusée par un internaute montrait une souris en train de dévorer un cannelé dans une vitrine). En réaction, le fabricant a posté la photo en question sur Facebook, accompagnée du message suivant : « Avis à vous tous : les souris aiment les cannelés ! », avant de rappeler que les cannelés exposés n’étaient pas destinés à la consommation.
Comment motiver vos équipes
Motiver ses collaborateurs, créer de l’engagement sont des défis que tout chef d’entreprise se doit de relever. Et les enjeux sont d’importance. Une étude réalisée par l’institut Gallup, en 2013, mettait ainsi en évidence que les unités de production dans lesquelles l’engagement des collaborateurs était le plus fort se révélaient 22 % plus productives que les autres, enregistraient un taux d’absentéisme 37 % inférieur et connaissaient 48 % d’accidents du travail en moins. Autant de raisons de se pencher sur les actions qu’il est possible de mettre en œuvre pour mobiliser ses collaborateurs.
Réunir les conditions pour travailler
L’employeur doit avant tout permettre à ses salariés de travailler dans de bonnes conditions.
Avant d’envisager toute action destinée à produire un surcroît de motivation chez ses collaborateurs, il est indispensable de leur offrir des conditions qui leur permettent tout simplement de faire leur travail.
On veillera ainsi à mettre à leur disposition des outils adaptés et en nombre suffisant, des locaux confortables, des moyens de communication et de déplacement performants et entretenus.
Au-delà de ces aspects matériels, il faudra s’atteler à offrir un environnement garantissant le bien-être des salariés, en assurant notamment leur sécurité, en œuvrant pour limiter leur souffrance physique et psychique au travail et en favorisant le dialogue social. Pourquoi ? Simplement parce que faire naître un tel environnement et l’entretenir crée une plus grande implication qui, comme le montrent de nombreux travaux, se traduit par une meilleure performance économique. Une étude britannique réalisée en 2010 (T.A. Wright, Oxford University) démontrait ainsi que le bien-être d’un employé pesait à hauteur de 25 % sur ses performances.
Améliorer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs est donc un investissement rentable.
À noter :
selon une étude réalisée en 2016 par Ipsos dans 17 pays, le fait de permettre à un salarié de changer régulièrement d’espace de travail (bureau, salle commune, chez soi…) est un critère de motivation fort.
Faire preuve de reconnaissance
La plupart des salariés attendent de leur employeur qu’il leur exprime un minimum de reconnaissance.
Offrir de bonnes conditions de travail à ses salariés est nécessaire, mais pas suffisant. Car la motivation des collaborateurs passe aussi par la reconnaissance que l’employeur leur témoigne. La preuve, une enquête réalisée par l’institut CSA en novembre 2013 indiquait qu’après les conditions de travail (59 % des sondés), la reconnaissance, avec le développement professionnel, constituait la principale attente des salariés (45 %).
Le chef d’entreprise a donc tout intérêt à satisfaire ce besoin. Pour ce faire, il convient de montrer au collaborateur combien il est important pour l’entreprise et pour le service dans lequel il évolue. À ce titre, plusieurs attitudes pourront être adoptées au quotidien. D’abord, il est essentiel de lui transmettre des objectifs clairs et de lui attribuer les moyens permettant de les atteindre. Ensuite, pendant le déroulement et surtout au terme d’une mission dévolue au salarié, le manager doit donner son avis sur les résultats atteints et évaluer le travail réalisé. S’il est satisfait, remercier et féliciter le collaborateur vont de soi. Encore faut-il le faire... À l’inverse, si les actions du salarié vont dans le mauvais sens, il faut aussi savoir le dire. Ce qui n’est pas toujours facile à faire...
Reconnaître un salarié, c’est aussi le mettre en avant non seulement par rapport aux autres personnes de son service ou de l’entreprise (le féliciter publiquement, par exemple), mais aussi, le cas échéant, aux yeux des clients ou des partenaires (renforcer son identification par ces derniers, lui déléguer certaines signatures...).
Enfin, vous le savez, la motivation des collaborateurs s’obtient également par leur stimulation. On pense ici en particulier à la rémunération qui leur est octroyée. Au-delà des augmentations régulières du salaire de base, le versement de primes répondant à l’accomplissement d’un effort particulier (travail pendant un week-end) ou à la réalisation d’un objectif déterminé de même que l’attribution d’un certain nombre d’avantages en nature (titres-restaurant, bons d’achat...) ont vocation à renforcer leur engagement dans l’entreprise. Sans compter la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale (intéressement ou participation aux résultats) qui peut favoriser le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
En pratique :
connaître le ressenti de ses collaborateurs n’est pas si évident. Organiser périodiquement des sondages ou mettre à disposition une boîte à suggestions permet de prendre conscience des insatisfactions pour mieux y répondre et recréer de la motivation.
Créer une dynamique de groupe
La motivation des salariés doit également être collective et pas seulement individuelle.
Motiver chaque collaborateur est un levier de performance, créer une dynamique de groupe en est un autre. L’idée est ici de déployer des pratiques communes qui permettront à chaque collaborateur de s’investir dans l’intérêt de l’équipe à laquelle il appartient, qu’elle soit permanente (un service, par exemple) ou constituée pour remplir une mission temporaire et spécifique (chantier, déploiement d’une solution digitale, lancement d’un nouveau produit…). Dans tous les cas, l’approche doit être « systémique » : les collaborateurs doivent être en interaction dynamique et poursuivre un but commun. En toute logique, la première étape consiste à définir clairement le but à atteindre. Puis, il faudra s’interroger sur les moyens dont dispose l’équipe mais surtout sur le rôle que chacun doit y tenir. Ce dernier point est important car il permet d’identifier toutes les contributions à l’œuvre commune. Leurs auteurs s’en trouvent ainsi reconnus et valorisés.
Cette reconnaissance mutuelle est un des ferments de la dynamique de groupe, que cette dernière soit basée sur la compétition (équipe de commerciaux) ou sur la coopération (équipe interdisciplinaire). Il convient donc de la stimuler, notamment en créant des moments au cours desquels les actions de chacun et leur poids dans la réussite collective seront rappelés (réunions d’étapes, rapports, soirées marquant l’aboutissement du projet). Bien entendu, des gratifications collectives, comme une prime attribuée à chaque membre de l’équipe en cas d’atteinte de l’objectif commun, pourront également soutenir cette dynamique.
Manager ses équipes
Tout employeur ou tout manager doit veiller à consacrer une partie de son temps à l’accompagnement de ses collaborateurs.
Jouer les managers est difficile et ingrat : il faut écouter, encourager, faire preuve d’autorité, évaluer tout en sachant que ces actions seront souvent critiquées. En outre, manager prend du temps. On estime qu’un chef d’entreprise ou un cadre doivent investir de 10 à 20 % de leur temps dans l’accompagnement de leurs équipes. Sans surprise, leur rôle dans la motivation des collaborateurs est essentiel. Récemment interrogés par BVA, 62 % des salariés français estiment que la première qualité d’un bon manager est de savoir motiver ses équipes. Une mission qu’il pourra plus facilement remplir s’il sait trancher les conflits, déléguer des missions à ses collaborateurs sans s’en désintéresser, mais aussi être exemplaire. Autrement dit, s’il est capable de « mettre les mains dans le cambouis » afin que ses collaborateurs n’aient pas l’impression de travailler pour lui, mais avec lui. Un changement de perception très mobilisateur !
À noter :
certaines entreprises françaises ont recours à un management très hiérarchique. Ainsi, selon une étude de la Dares publiée en 2015, 19,3 % (contre 14,2 % en 1998) des salariés français déclaraient que leurs supérieurs leur disaient, non seulement quoi faire, mais également comment le faire. Une situation qui démotive les salariés. 55 % d’entre eux estimant que certaines de leurs compétences ne sont pas utilisées.
Combien vaut votre entreprise ?
Combien vaut mon entreprise ? Cette question, vous vous l’êtes sans aucun doute déjà posée. Et sans devoir être une obsession, cette préoccupation est, en effet, plus que légitime. Surtout lorsque l’heure de la transmission approche. Car évaluation rime avant tout avec cession. Même si les raisons de se pencher sur la valorisation de votre entreprise peuvent en réalité être très nombreuses.
Dans quelles situations évaluer votre entreprise ?
Transmission familiale, cession, mise en place d’une stratégie patrimoniale… autant de raisons pour un dirigeant d’évaluer son entreprise.
Dans certaines situations, la mission d’évaluation de l’entreprise s’impose d’elle-même. C’est le cas dans les hypothèses de transmission à titre onéreux, qu’il s’agisse de cession ou de reprise. Dans ces cas, il est indispensable de préparer l’opération et la négociation en faisant procéder à l’estimation de la valeur de l’entreprise.
De même, en cas de transmission à titre gratuit, de transmission familiale, par voie de donation notamment, l’évaluation s’impose. À la fois pour des raisons fiscales – la valeur servira d’assiette aux droits de donation – et pour être à même de respecter l’égalité successorale entre les héritiers.
Une évaluation est aussi de rigueur dans le cadre de certaines opérations de restructuration comme la fusion de deux entités ou l’apport d’une branche autonome d’activité d’une société à une autre. Ici, la loi exige, en règle générale, l’intervention d’un professionnel, le commissaire aux apports ou à la fusion, pour procéder à l’évaluation afin que les droits des associés soient respectés.
Mais une évaluation peut être très utile dans bien d’autres cas :- dans le cadre de certaines assurances, où une valorisation est indispensable pour fixer le montant des primes ;- dans le cadre d’une évaluation du patrimoine du dirigeant, étape indispensable pour élaborer ou réorienter sa stratégie patrimoniale.
Enfin, plus globalement, il peut être extrêmement intéressant pour le dirigeant de savoir combien vaut son entreprise pour découvrir sur quelles bases repose cette valeur et donc les événements qui peuvent la fragiliser. Et surtout pour suivre dans le temps l’évolution de cette valorisation et donc l’impact de sa gestion sur celle-ci.
De ce point de vue, primordial pour vous, il peut s’avérer très utile de planifier une évaluation régulière de votre entreprise, afin de bien suivre l’impact de ses performances, et d’être alerté au plus vite sur les raisons ou circonstances qui feraient se stabiliser ou diminuer sa valeur.
Un suivi qui peut d’ailleurs se révéler précieux pour déterminer le moment le plus opportun pour la céder. Même si l’évaluation ne coïncidera pas forcément, une fois l’opération de vente achevée, avec le prix auquel l’entreprise aura été cédée. Car ne l’oubliez pas : la valorisation ne coïncide pas toujours avec le prix qui peut être tiré de la cession de l’entreprise. Pourquoi ? D’abord, parce qu’une évaluation ne traduit la valeur d’une entreprise qu’à un instant T. Au bout de quelque temps, elle peut donc se révéler obsolète. Ensuite, parce qu’à la différence d’une valeur calculée avec objectivité, le prix dépend beaucoup des circonstances de la transaction (urgence de l’opération, concurrence entre les acheteurs potentiels, intérêt stratégique de l’opération pour l’acheteur…).
Les différentes méthodes d’évaluation
Certaines méthodes s’appuient sur des données issues de l’entreprise, d’autres sur les prix enregistrés lors de cessions d’entreprises comparables.
Particularité : il existe plusieurs catégories de méthodes d’évaluation. Certaines sont basées sur des données issues de l’entreprise elle-même, notamment de sa comptabilité. C’est le cas des méthodes patrimoniales et d’actualisation des flux de trésorerie. D’autres reposent sur la comparaison avec d’autres entreprises ayant fait l’objet de transactions récentes.
Ainsi, en pratique, 4 modes d’évaluation sont principalement utilisés :- la méthode patrimoniale ;- la méthode d’actualisation des flux de trésorerie ;- la méthode des multiples des résultats ;- le barème d’évaluation des fonds de commerce.
Évacuons pour commencer la méthode d’actualisation des flux, qui a la préférence des financiers mais qui suppose une excellente maîtrise des mathématiques financières pour en appréhender tous les tenants et aboutissants (!). Dans les grandes lignes, elle consiste à considérer qu’une entreprise vaut la somme des flux de trésorerie qu’elle pourra dégager. Elle suppose donc d’abord d’établir un plan d’affaires sur plusieurs années détaillant les prévisions de performance de l’entreprise. Puis, par l’application de savantes formules, de calculer la valeur de ces flux futurs au regard de leur probabilité de réalisation. Autrement dit, l’évaluation prend en compte le niveau de risque de non-réalisation de ces prévisions, ainsi que le niveau d’inflation, par le biais de ce que l’on appelle un taux d’actualisation. Une méthode qui est réservée aux entreprises d’une certaine taille disposant d’un process fiable d’établissement de prévisions annuelles. Et aux praticiens en maîtrisant bien tous les paramètres !
La méthode patrimoniale
La méthode patrimoniale consiste à évaluer séparément les éléments d’actif et de passif de l’entreprise. Elle est donc particulièrement adaptée aux entreprises familiales, notamment aux holdings et aux entreprises dégageant une rentabilité modeste.
Elle suppose notamment de passer en revue et de réévaluer tous les éléments d’actif de l’entreprise, en tenant compte des plus-values latentes, y compris des actifs qui ne figurent pas au bilan comme, le cas échéant, le fonds de commerce lorsqu’il a été créé par le chef d’entreprise. Et d’en retrancher le total des passifs de l’entreprise, là encore en tenant compte des passifs qui, éventuellement, ne figurent pas au bilan, comme les passifs sociaux (indemnités de départ à la retraite, par exemple).
La méthode par comparaison
Cette troisième méthode est largement utilisée. Elle consiste à appliquer à certains agrégats financiers significatifs de la valeur de l’entreprise, comme son résultat net courant, un multiple de valorisation constaté sur les transactions dans le secteur d’activité sur la période et dans la même zone géographique. Par exemple, à valoriser l’entreprise 7 fois son résultat net courant. Bien entendu, la difficulté consiste à répertorier des opérations récentes ayant porté sur des entreprises comparables afin de prendre connaissance de ce multiple.
L’utilisation du barème d’évaluation des fonds de commerce
Une autre méthode, très simple, voire simpliste, est utilisée pour obtenir un ordre de grandeur de valorisation des fonds de commerce. Elle consiste à utiliser un barème fiscal qui est établi et mis à jour par l’administration sur la base des dernières transactions intervenues et qui procure une évaluation basée sur le chiffre d’affaires des 3 dernières années. Ce barème doit, bien entendu, être manié avec moult précautions. D’abord, il est réservé à l’évaluation des fonds de commerce. Ensuite, il ne délivre qu’un ordre de grandeur, les fourchettes de chiffre d’affaires étant en général extrêmement larges. Sans compter qu’il s’appuie sur des moyennes de valorisation et ne tient donc pas compte des particularités de chaque entreprise ni de leur situation. Enfin, la valorisation en découlant ne comprend pas la valeur de certains éléments, les stocks de marchandises en particulier.
Quel statut pour le conjoint de l’exploitant agricole ?
Le conjoint d’un agriculteur qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation doit opter en faveur d’un statut qui détermine avant tout son régime de protection sociale.
Le conjoint qui participe à la mise en valeur de l’exploitation agricole de son époux (se) doit opter en faveur d’un statut juridique. Mais quel statut choisir ? La question est délicate pour au moins deux raisons.
D’abord, la qualité de conjoint d’un exploitant recouvre des situations très différentes selon qu’il participe, entièrement ou partiellement, à l’activité agricole. Le choix d’un statut est donc en premier lieu guidé par cette situation objective.
Ensuite, l’option en faveur d’un statut plutôt qu’un autre dépend essentiellement des effets recherchés d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial et surtout social. Une véritable réflexion doit donc être menée en la matière.
Voici un point sur les différents statuts possibles, et sur les principales conséquences qu’ils emportent tant pour le conjoint que pour l’exploitant, des époux qui travaillent ensemble dans l’exploitation familiale pouvant être tous deux exploitants, ou l’un être le collaborateur, voire le salarié, de l’autre.
Le conjoint coexploitant
Deux époux qui mettent en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole sont, d’un point de vue juridique, présumés être des coexploitants. Très fréquente en pratique, cette situation correspond à celle où le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation en se partageant les tâches et les rôles. Selon la loi, ils sont alors censés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. Autrement dit, l’un ou l’autre des époux est habilité à réaliser l’ensemble des actes que requiert le fonctionnement normal de l’exploitation (commande de matériel, vente des produits...). Autre conséquence de cette présomption de mandat réciproque : la totalité des biens des deux conjoints, quels que soient leur régime matrimonial et la nature de ces biens, est engagée et peut faire l’objet de poursuites par les créanciers de l’exploitation.
Sachant toutefois que chacun des époux dispose de la faculté de déclarer devant notaire que son conjoint ne pourra plus se prévaloir de ce mandat présumé prévu par la loi. Et, par ailleurs, que cette présomption de mandat n’existe plus lorsque l’un des conjoints cesse de participer de manière régulière aux travaux de l’exploitation.
À noter :
lorsque le conjoint participant à l’exploitation est cotitulaire des baux ruraux avec son époux, il bénéficie de toutes les prérogatives attachées au statut du fermage (droit au renouvellement, droit de préemption...). Et même si les baux ne sont consentis qu’à un seul des époux, ce conjoint dispose de certains droits sur ces derniers : droit de regard sur leur résiliation, droit de se faire céder les baux du vivant de l’exploitant ou de les poursuivre après son décès...
D’un point de vue social, l’option du conjoint pour le statut de coexploitant doit être expressément formulée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA). Le conjoint est alors affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. À ce titre, tout comme son époux, il cotise à ce régime sur ses revenus professionnels et bénéficie de l’ensemble des prestations sociales qui y sont attachées.
Et fiscalement, à l’instar de son époux, le conjoint coexploitant sera imposé au titre des bénéfices agricoles tirés de l’exploitation selon le régime d’imposition auquel il est soumis (micro-BA, régime simplifié ou réel).
Attention :
lorsque le conjoint exerce une activité extérieure à l’exploitation, il ne peut pas prétendre au statut de coexploitant. Un conseil : dans la perspective où il a vocation, à l’avenir, à devenir lui-même exploitant, par exemple lorsqu’il succédera à son époux parti en retraite ou décédé, il a intérêt à posséder ou à préparer d’ores et déjà un diplôme agricole. Car ce diplôme lui sera alors indispensable.
Le conjoint collaborateur
La situation dans laquelle le conjoint travaille de façon régulière, même à temps partiel, dans l’exploitation de son époux sans être rémunéré (ni associé) et sans avoir lui-même la qualité de chef d’exploitation (coexploitant) est également très fréquente. Dans cette hypothèse, il peut (et même il doit) opter pour le statut de collaborateur. En pratique, l’option s’opère par le biais d’une notification à la caisse de MSA dont relève le chef d’exploitation, accompagnée d’une attestation sur l’honneur par laquelle l’intéressé déclare participer, sans être rémunéré, à l’activité agricole de son époux.
L’intérêt de ce statut est surtout de conférer une protection sociale au conjoint de l’agriculteur. Ainsi, il bénéficie de droits personnels à la retraite (régime de base et complémentaire) et a vocation à percevoir une pension en cas d’invalidité ainsi que certaines prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Bien entendu, ce statut a un coût pour l’exploitant qui doit acquitter les cotisations sociales correspondantes pour son conjoint.
Autre avantage de ce statut : lors du décès de l’exploitant, le conjoint collaborateur aura droit au versement d’une créance, dite de salaire différé, prélevée sur la succession lorsqu’il aura participé, « directement et effectivement », pendant au moins 10 ans, à l’activité de l’exploitation.
Juridiquement, lorsqu’il a la qualité de collaborateur, le conjoint est présumé avoir reçu de son époux chef d’exploitation le mandat d’accomplir les actes d’administration pour les besoins de l’exploitation. Mais à la différence du conjoint coexploitant, le conjoint collaborateur n’est qu’un simple mandataire qui n’est donc pas engagé sur son patrimoine personnel par ces actes.
À noter que le statut de collaborateur est ouvert non seulement au conjoint de l’exploitant individuel, mais aussi à celui de l’associé d’une exploitation constitué sous la forme d’une société (GAEC, EARL, SCEA...) dès lors qu’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société (et qu’il n’est pas lui-même associé).
Précision :
le concubin d’un exploitant agricole, de même que la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité (Pacs), doit également faire le choix d’un statut lorsqu’il travaille régulièrement dans l’exploitation. Il peut donc notamment prétendre au statut de collaborateur.
Le conjoint salarié
Le choix du salariat répond avant tout à la nécessité de verser une rémunération au conjoint en contrepartie de son activité dans l’exploitation. Outre lui conférer une véritable couverture sociale, celle du régime des salariés agricoles, ce statut lui donne également une autonomie financière. Attention, l’activité du conjoint doit être réelle, la loi exigeant qu’il « participe effectivement » à l’exploitation, ce que n’hésite pas à contrôler la caisse de MSA.
L’option pour le statut de salarié est évidemment coûteuse pour l’exploitant qui acquitte, en sus du salaire, les charges sociales patronales correspondantes. Mais fiscalement, ce salaire est déductible des revenus imposables de l’exploitant soumis au régime réel, en totalité ou partiellement selon qu’il est ou non adhérent d’un centre de gestion agréé. De son côté, le conjoint qui perçoit un salaire est redevable de cotisations salariales et est évidemment imposé sur ces sommes au titre des traitements et salaires.
Le conjoint associé
Enfin, lorsque des époux travaillent ensemble dans l’exploitation familiale, ils peuvent décider de la mettre en valeur sous la forme d’une société, le plus souvent d’un GAEC (possible entre deux époux seulement depuis quelques années) ou d’une EARL. Ils auront alors tous deux la qualité d’associé, permettant ainsi à chacun de pouvoir être reconnu comme chef d’exploitation, en particulier en matière de protection sociale. Sachant que le choix de la constitution d’une société par les époux n’est évidemment pas dicté par la seule préoccupation de leur conférer un statut...
En conclusion :
chaque statut présente des avantages et des inconvénients qui doivent être attentivement analysés avec l’aide d’un professionnel – le Cabinet est à votre disposition pour vous conseiller en la matière – et des services de la caisse de Mutualité sociale agricole.
10 décisions à prendre avant la fin de l’année
La fin de l’année 2016 approche à grands pas. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de dispositifs mis en place de façon temporaire, de faire valoir vos droits avant qu’il ne soit trop tard, ou d’être en règle au regard de certaines obligations légales. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre certaines décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes pour votre entreprise. Tour d’horizon des 10 actions ou réflexions à mener avant le 31 décembre.
1 - Profiter d’une aide à l’embauche
Le dispositif d’aide à l’embauche d’un premier salarié prend fin le 31 décembre 2016.
Si vous n’avez pas employé de salarié, au-delà de la période d’essai, au cours des 12 derniers mois et que vous envisagez de procéder à un recrutement, notamment en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d’au moins 6 mois, vous pouvez prétendre à une aide de 4 000 € maximum. Mais attention, ne tardez pas à mettre votre projet à exécution car pour bénéficier de cette prime, le premier jour du contrat de travail de ce nouveau salarié devra démarrer au plus tard le 31 décembre 2016.
À noter :
pour gagner du temps et de l’argent, vous pouvez décider de transmettre les fiches de paie à vos salariés par voie dématérialisée. Sachant qu’à compter du 1er janvier 2017, leur accord préalable ne sera plus requis.
2 - Faire le point sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif.
Si votre entreprise compte 20 salariés ou plus depuis au moins 3 ans, vous devrez, au 31 décembre 2016, employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de votre effectif. Mais si vous pensez que cet objectif ne sera pas atteint et que vous ne pouvez pas embaucher, vous avez encore un peu de temps pour rectifier le tir d’ici la fin de l’année.
Ainsi, pour remplir votre obligation, vous pouvez notamment:- accueillir des stagiaires handicapés ou des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;- conclure des contrats de prestation de services ou de sous-traitance avec des établissements du secteur adapté ou protégé tels que les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ;- conclure des contrats de prestation de services ou de sous-traitance avec des travailleurs indépendants handicapés.
À défaut de remplir cet objectif de 6 %, vous devrez verser une contribution annuelle auprès de l’Agefiph allant de 400 à 600 fois le montant du Smic horaire par « bénéficiaire manquant ».
3 - Évaluer la pénibilité
Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques auxquels leurs salariés ont été exposés en 2016.
Au plus tard le 31 janvier 2017 (le 10 janvier pour les exploitants agricoles), vous devrez déclarer, dans la DADS, les facteurs de risques auxquels vos salariés ont été exposés en 2016, au-delà des seuils fixés par décret (travail de nuit, exposition au bruit, postures pénibles...). Une évaluation qui doit être faite pour chaque salarié et qui peut nécessiter l’intervention de prestataires extérieurs. Aussi est-il opportun d’anticiper cette démarche afin de pouvoir lui consacrer le temps et l’énergie nécessaires.
4 - Déposer une réclamation fiscale
Les actions en réclamation pour les impôts de 2014 et les impôts locaux de 2015 doivent être intentées avant le 31 décembre 2016.
Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander un avantage fiscal dans votre déclaration, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration. Mais attention là encore, car l’action en réclamation sera prescrite à la fin de l’année, et ce pour la plupart des impôts de 2014 et pour les impôts locaux de 2015. Prenez donc la peine de vérifier que vous n’avez pas d’impôts à réclamer avant cette date !
5 - Récupérer la TVA
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour rectifier des erreurs commises en matière de déduction de TVA sur vos déclarations de 2014.
Lorsque vous avez oublié de déduire une partie de votre TVA, vous pouvez réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il vous suffit de la mentionner sur votre prochaine déclaration. Agissez vite, car vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 seulement pour rectifier des erreurs concernant vos déclarations de 2014 ! Vous pouvez également solliciter, dans ce même délai, l’imputation ou le remboursement de la TVA que vous avez acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées au titre de 2014.
6 - Réaliser des investissements industriels
Pour bénéficier du dispositif de suramortissement, un investissement industriel doit être réalisé avant le 14 avril 2017.
Souvenez-vous, en 2015, une mesure temporaire avait été instaurée pour inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels et leur permettre ainsi d’accélérer la modernisation de leur outil de production et de gagner en compétitivité.
Concrètement, grâce à cette mesure, vous pouvez, en principe, bénéficier d’une économie d’impôt en déduisant de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % du prix de revient de l’investissement réalisé.
Sachant que le bien doit être acquis, fabriqué, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat au plus tard le 14 avril 2017 (ou le 31 décembre 2017 pour les poids lourds). Si cette date butoir peut vous sembler lointaine pour profiter de ce dispositif, il est conseillé d’engager d’ores et déjà une réflexion en la matière car les biens éligibles sont souvent des investissements lourds pour la trésorerie de votre entreprise (machines-outils, tracteurs…). Un délai de plusieurs semaines n’est donc pas trop long pour évaluer la situation et prendre votre décision.
7 - Acheter des voitures
La fiscalité en matière d’achat de véhicules risque d’être modifiée à compter du 1er janvier 2017.
Outre des investissements industriels, la fin de l’année 2016 est aussi l’occasion de vous interroger sur l’achat de voitures pour votre entreprise. En effet, l’amortissement des véhicules de tourisme est déductible du bénéfice imposable, dans la limite d’un certain plafond. En principe, ce plafond est fixé à 18 300 €. Mais pour les véhicules les plus polluants, c’est-à-dire ceux émettant plus de 200 g de CO2/km, il est abaissé à 9 900 €. Or le projet de loi de finances pour 2017 propose d’étendre progressivement l’application du seuil de 9 900 € afin qu’il concerne, d’ici à 2021, les véhicules émettant plus de 130 g de CO2/km seulement. Même si cette mesure n’est pas encore définitive, vous pouvez donc envisager d’accélérer l’achat d’un véhicule considéré comme polluant. Ou, à l’inverse, retarder l’acquisition d’un véhicule propre (électrique ou hybride rechargeable) car, pour ces derniers, le plafond de la déduction devrait être relevé à 30 000 € en 2017.
8 - Optimiser son contrat retraite
Faites calculer votre disponible fiscal pour procéder ensuite à d’éventuels versements complémentaires sur votre contrat Madelin avant le 31 décembre 2016.
Pour vous assurer un complément de revenus lors de votre retraite, vous avez peut-être souscrit un contrat Madelin et/ou un plan d’épargne retraite populaire (Perp). Des contrats qui vous permettent, dans certaines limites, de déduire de vos revenus les cotisations que vous avez versées. Mais attention, le plafond de déduction fiscal du Madelin est annuel. Ce qui signifie que si vous ne l’avez pas utilisé entièrement, vous risquez de perdre définitivement une partie de l’enveloppe fiscale. C’est la raison pour laquelle il est opportun de vous rapprocher de votre conseiller afin qu’il calcule votre « disponible fiscal ». Une fois cette donnée obtenue, vous pourrez alors, le cas échéant, réaliser des versements complémentaires avant le 31 décembre 2016. Rappelons toutefois que, dans le cadre d’un Perp, le plafond non utilisé est reportable sur 3 années.
9 - Facturer les travaux ou les prestations réalisés
Veillez à recouvrer les sommes que vous avez facturées avant le 31 décembre 2016.
Si, comme beaucoup d’entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, veillez à établir les factures correspondant aux travaux ou aux prestations que vous avez réalisés avant cette date et à vous faire payer les montants considérés. En effet, cette opération vous permettra de faire apparaître ces sommes dans vos comptes, et donc de disposer d’un meilleur bilan comptable 2016.
10 - Produire un FEC exempt d’erreur
Pour éviter toute déconvenue lors d’un contrôle fiscal, il est fortement conseillé à tous les chefs d’entreprise d’anticiper la création du fichier des écritures comptables.
Sous peine d’amende, les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée doivent, en cas de contrôle, fournir à l’administration fiscale leur comptabilité sous la forme d’un fichier dématérialisé appelé « FEC » (fichier des écritures comptables). Et attention, ce FEC doit être établi en respectant des règles très précises de contenu mais aussi de forme. Le risque de commettre une erreur, surtout dans la précipitation d’un contrôle, est donc bien réel. C’est pourquoi procéder à des essais de création de ce fichier, en cette période de fin d’année où le fisc est toujours actif, est fortement conseillé !
Comment motiver votre équipe commerciale ?
Pour une entreprise, l’argent est le nerf de la guerre et ce sont les commerciaux qui, par leurs actions de prospection et de gestion de clients, sont en première ligne pour en trouver. Une mission difficile qui réclame des compétences techniques, un sens développé de la psychologie et une ténacité sans faille. Des profils rares qui, pour être séduits par une entreprise et lui offrir le meilleur d’eux-mêmes, doivent être challengés mais aussi valorisés. Zoom sur quelques approches efficaces pour fidéliser et motiver votre équipe commerciale.
Une rémunération incitative
Proposer une rémunération en rapport avec les résultats est indispensable pour motiver une équipe commerciale.
Rémunération fixe ou variable ?
Sans surprise, rémunération et efficacité commerciale sont intimement corrélées. Dans cette profession où, fait rare, on parle d’argent sans complexe, le fait que la rémunération soit le premier critère de motivation est d’ailleurs parfaitement assumé. Généralement, cette dernière se compose d’une partie fixe et d’une partie variable. À gros traits, la première, dans la mesure où elle est garantie, permet à un commercial de s’investir dans la gestion de son portefeuille clients en programmant des visites ou des appels destinés tout autant à fidéliser qu’à déboucher sur une nouvelle vente. La seconde vient stimuler le désir de conquête de nouveaux clients ou de nouveaux marchés. Dans la pratique, le plus souvent, les vendeurs principalement affectés à des missions de prospection se voient proposer une part variable pouvant représenter jusqu’à 70 % de leur rémunération. Pour les autres, cette dernière dépasse rarement les 30 %.
Encadrement des primes, bonus et commissions
Pour permettre une meilleure maîtrise budgétaire et, le cas échéant, s’assurer d’être toujours en mesure de faire face à la demande des clients, on a coutume, dans beaucoup d’entreprises, de plafonner les commissions des commerciaux. Une approche qui, bien que rationnelle, est mal vécue par les vendeurs, surtout par les plus performants. Pour éviter de les décourager et de les voir partir à la concurrence, il est donc recommandé, lorsqu’il est nécessaire d’avoir un contrôle quantitatif sur les ventes, de préférer la dégressivité des commissions à leur plafonnement. Dans le cas contraire, le plafonnement des commissions n’est pas souhaitable. Certains auteurs reconnus comme Doug J. Chung, professeur à la Harvard Business School, invitent même les entreprises à proposer des surprimes de dépassement d’objectif. Quant au bonus qu’il est possible de décrocher en atteignant un objectif précis, s’il peut être un formidable « booster » lorsqu’il est perçu comme un supplément exceptionnel, il ne manquera pas d’inquiéter et de créer du découragement s’il représente une part essentielle de la rémunération.
Plus largement, ces seuils et ces plafonnements, lorsqu’ils sont trop ou mal utilisés, risquent d’être contreproductifs. Ils peuvent ainsi conduire les commerciaux à mettre de côté des commandes plutôt qu’à les transformer au cours de l’exercice (on parle alors de « l’effet frigo »). Par ailleurs, leur usage induit, au sein des équipes, des traitements qui pourront être considérés comme inégalitaires et donc démotivants. Un vendeur qui a manqué son objectif de 1 % est-il moins méritant que celui qui l’a dépassé de 1 % ?
Enfin, la stratégie qui consiste, chaque année (trimestre, mois…), à revoir les objectifs à la hausse à commissions et bonus égaux, a également tendance, à plus ou moins long terme, à saper la motivation des équipes. Inutile donc d’en abuser.
Cultiver un esprit sportif
Offrir des défis à relever est un excellent levier pour initier une dynamique vertueuse dans un groupe de commerciaux.
Un challenge réaliste…
Aimer relever les défis est un trait commun à tous les professionnels de la vente. La détermination des objectifs à atteindre représente donc une mission importante pour le chef d’entreprise ou le responsable de l’équipe commerciale. Comme dans le sport, le challenge doit être suffisamment ambitieux pour stimuler l’esprit de compétition du vendeur tout en restant atteignable. Proposer un défi à l’évidence impossible à relever étant la meilleure façon de démotiver un collaborateur. Bien entendu, sans revenir en détail sur les aspects financiers et pour que le jeu en vaille la chandelle, il est aussi important de veiller à ce que les efforts en termes de temps, de déplacements et de compétences que le vendeur devra fournir restent en rapport avec les gains offerts par l’entreprise pour atteindre les objectifs fixés.
… à relever en équipe
Permettre à un commercial de jauger sa performance en la comparant à celle des autres est une pratique classique de motivation des forces de vente. Ce système ludique qui flatte l’esprit de compétition peut être vertueux pour peu qu’il respecte certaines règles. D’abord, il est indispensable que les conditions de mise en concurrence soient équitables. Par exemple, il faut veiller à ce que chacun se voit attribuer des secteurs de prospection offrant, à effort égal, les mêmes perspectives économiques et à ce que les moyens qui sont donnés aux uns et aux autres soient équivalents. Ensuite, il est essentiel de privilégier une approche incitative et non punitive. Autrement dit, on préférera distinguer le ou les trois meilleurs « transformateurs de contact en client » du semestre plutôt que d’afficher un classement complet faisant apparaître aussi les derniers. Enfin, on veillera à valoriser dans le temps cette performance en offrant, par exemple, au(x) lauréat(s) un trophée ostensible (une montre, des bouteilles de champagne…).
D’une manière plus générale, les démarches qui permettront de valoriser un collaborateur commercial ne pourront avoir qu’un impact positif sur sa motivation. Il en va ainsi du choix de sa voiture de fonction, de la gamme de matériel bureautique qui lui est attribué (tablette, smartphone…) ou encore du type d’hôtels et de restaurants dans lesquels il est autorisé à descendre lors de ses tournées.
Un management de soutien
L’autonomie est un élément clé du fonctionnement des commerciaux. Mettre en place un management très directif risque ainsi de limiter toute prise d’initiative, pourtant déterminante dans ce type de fonction. Une fois encore, le parallèle sportif s’impose, le manager devant agir comme un « coach » pour permettre à chaque vendeur de donner le meilleur au service du collectif (l’entreprise). D’abord, il doit être à l’écoute de tous les membres de l’équipe afin de les remotiver en cas de besoin. Ensuite, il doit être en mesure d’identifier leurs faiblesses et de les aider à les combler.
À noter :
le métier de commercial est un métier technique. Il faut donc veiller à former régulièrement vos collaborateurs sur les produits ou services vendus mais aussi sur les nouvelles techniques de vente.
Pour cela, il ne doit pas hésiter à accompagner ses jeunes collaborateurs en clientèle ou à demander à un autre commercial, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, de le faire. Adopter ce type de management par l’exemple permet d’être crédible lorsque l’on définit des objectifs et que l’on délivre des conseils. Ce partage d’expérience permet, en outre, d’instaurer un précieux climat de confiance.
Le statut du conjoint du chef d’entreprise
Le conjoint d’un chef d’entreprise qui participe régulièrement à l’activité professionnelle de ce dernier a l’obligation de choisir entre l’un des trois statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié. Le choix du statut du conjoint est une question qui dépend essentiellement de la situation patrimoniale des époux et personnelle de l’intéressé ainsi que de la situation financière et du statut juridique de l’entreprise. Explications.
Le conjoint collaborateur
Le statut de conjoint collaborateur est réservé au conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans être rémunéré ni associé.
Les personnes concernées
Pour prétendre au statut de conjoint collaborateur, le conjoint ou le partenaire pacsé du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale doit :- exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise ;
Attention :
le conjoint qui exerce à l’extérieur de l’entreprise une activité non salariée, ou une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, est présumé ne pas exercer une activité régulière au sein de l’entreprise.
- sans percevoir de rémunération ;- sans avoir la qualité d’associé.
Ces conditions sont cumulatives.
En outre, le statut de conjoint collaborateur n’est accessible qu’au seul conjoint ou partenaire pacsé :- du chef d’entreprise individuelle (artisanale, commerciale ou libérale) ;
- du gérant associé unique d’une EURL ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont l’effectif n’excède pas 20 salariés.
À noter :
si ce seuil est dépassé pendant 24 mois consécutifs, le chef d’entreprise doit, dans les 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur.
L’exercice de l’option
L’option pour le statut de conjoint collaborateur doit être communiquée par le chef d’entreprise lui-même aux organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.
Ainsi, le chef d’entreprise procède à cette communication auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :- soit, lors de la création de l’entreprise, en joignant la déclaration de l’option choisie au dossier unique de déclaration de création d’entreprise ;- soit, après la création de l’entreprise, en transmettant une déclaration modificative dans un délai de 2 mois à partir de la date à laquelle le conjoint remplit les conditions pour prétendre à ce statut.
Remarque :
la radiation du conjoint ou du partenaire pacsé doit être déclarée dans les 2 mois à compter de la cessation du respect des conditions requises.
Dans tous les cas, le CFE notifie au conjoint ou partenaire pacsé la réception de cette déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour les entreprises soumises à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), l’option pour le statut de conjoint collaborateur fera alors l’objet d’une mention au registre, soit au moment de l’immatriculation, soit après celle-ci par une inscription modificative.
Précision :
dans le cas d’une entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers, l’option fera l’objet d’une mention à ce répertoire.
Les effets du statut de conjoint collaborateur
Sur le plan juridique, le conjoint collaborateur, dûment mentionné au RCS ou au répertoire des métiers, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes de gestion concernant l’entreprise (établir un devis, signer un bon de commande…).
Remarque importante :
par déclaration faite devant notaire, chacun des époux ou des partenaires pacsés peut cependant mettre fin à la présomption de mandat. Son conjoint devra être présent ou dûment appelé. Cette déclaration notariée doit faire l’objet d’une mention au RCS (ou au répertoire des métiers). Elle n’est opposable aux tiers que dans les 3 mois suivant l’inscription de cette mention. En l’absence de cette mention, elle n’est opposable aux tiers que s’il est établi qu’ils en avaient connaissance.
Selon l’article L. 121-7 du Code de commerce, dans ses rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis par le conjoint collaborateur pour les besoins de l’entreprise sont réputés accomplis pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent, à la charge du conjoint collaborateur, aucune obligation personnelle.
Mais c’est surtout sur le plan social que le statut de conjoint collaborateur emporte ses effets les plus significatifs. Ainsi, en particulier, le conjoint collaborateur doit être personnellement affilié au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise (régime des artisans, des industriels et commerçants ou des professions libérales). L’affiliation concerne non seulement les régimes de base mais aussi les régimes obligatoires de retraite complémentaire et d’invalidité-décès.
En pratique, les cotisations vieillesse du conjoint collaborateur sont calculées à sa demande :- soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise ;- soit, avec l’accord du chef d’entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier, qui est déduite du revenu professionnel du chef d’entreprise pris en compte pour déterminer l’assiette de sa propre cotisation d’assurance vieillesse.
Par ailleurs, le conjoint collaborateur peut demander à racheter des périodes d’activité, dans la limite de 6 années. Ce rachat est possible jusqu’au 31 décembre 2020.
Enfin, en cas d’exploitation de l’entreprise sous forme de société, il peut bénéficier du plan d’épargne d’entreprise. En revanche, le conjoint collaborateur ne bénéficie pas d’une assurance chômage (sauf s’il a souscrit une assurance personnelle).
Le conjoint associé
Le statut de conjoint associé s’applique à celui qui exerce une activité régulière dans l’entreprise et qui détient des parts sociales.
Les personnes concernées
Pour prétendre au statut de conjoint associé, l’époux ou le partenaire pacsé doit :- exercer une activité régulière dans l’entreprise ;- détenir des parts sociales soit en réalisant un apport personnel, soit en revendiquant la qualité d’associé du fait que son époux a acquis les titres sociaux en réalisant un apport de biens communs. Le conjoint associé peut aussi acquérir des titres sur ses fonds propres.
Ces conditions sont cumulatives.
En outre, le statut de conjoint associé n’est accessible qu’au seul conjoint ou partenaire pacsé :- du dirigeant d’une société unipersonnelle (artisanale, commerciale ou libérale), à gérant unique de type EURL ou SASU ;- du gérant d’une SARL, d’une société en nom collectif (SNC), d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ou encore du dirigeant d’une société par actions simplifiées (SAS).
L’apport du conjoint peut être en numéraire (somme d’argent) ou en nature (un brevet, une machine…). Toutefois, le conjoint qui n’a pas d’argent à investir, mais qui veut être associé, peut effectuer un apport en industrie (mise à disposition de son travail, de ses connaissances techniques, de ses services…). Le partage des bénéfices de l’entreprise se fait au prorata des parts détenues par chacun. Il en est de même pour la contribution aux pertes.
L’exercice de l’option
Le statut du conjoint associé doit être indiqué :- lors de l’immatriculation de l’entreprise ou de la déclaration d’activité auprès du CFE ;- au cours de la vie de l’entreprise, dans les deux mois suivant le début de la participation régulière et effective du conjoint associé.
Les effets du statut de conjoint associé
Le conjoint associé peut participer ou non à l’activité de l’entreprise. Quoiqu’il en soit, en sa qualité d’associé, il dispose d’un droit de vote aux assemblées. Il a la possibilité d’être nommé dirigeant et détient alors des pouvoirs de gestion.
Remarque :
la nomination du conjoint associé en tant que dirigeant de la société n’est pas possible dans une EURL ou une SASU.
Le conjoint associé ne reçoit en principe aucune rémunération, sauf s’il est aussi salarié ou dirigeant rémunéré. Dès lors, il n’a droit qu’à une part des bénéfices. Fiscalement, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), les dividendes distribués sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers non soumis à cotisations sociales mais qui donnent lieu au paiement des prélèvements sociaux. Dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, le conjoint associé est imposable sur sa quote-part de bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles selon l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, le conjoint associé n’est responsable qu’à hauteur de son apport (sauf dans les SNC). Sa responsabilité est, en revanche, étendue s’il est cogérant. En effet, en tant que dirigeant, il peut être amené à supporter une partie des dettes de la société en cas de liquidation judiciaire.
Enfin, s’agissant de la couverture sociale, le conjoint associé est obligatoirement affilié au régime général de la Sécurité sociale lorsqu’il est gérant minoritaire assimilé à un salarié ou qu’il remplit les conditions du salariat. En revanche, le conjoint associé est personnellement et obligatoirement affilié au RSI lorsqu’il participe pleinement à l’activité de l’entreprise sans être salarié ou lorsqu’il est dirigeant assimilé à un non-salarié. Le conjoint qui est simplement associé, sans être gérant et sans participer à l’activité de l’entreprise ne relève d’aucun régime de protection sociale obligatoire.
Le conjoint salarié
Le statut de conjoint salarié concerne le conjoint qui participe à l’activité de l’entreprise, sous un lien de subordination en percevant une rémunération au moins égale au Smic.
Les personnes concernées
Pour prétendre au statut de salarié, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin du chef d’entreprise doit :- participer à titre habituel à l’activité de l’entreprise ;- travailler sous l’autorité de l’époux ou du compagnon dirigeant ;- percevoir un salaire au moins égal au Smic.
Ces conditions sont cumulatives.
Remarque :
pour déclarer le conjoint salarié, le chef d’entreprise doit procéder, comme pour tout salarié, à une déclaration d’embauche.
Le conjoint salarié ne peut pas prendre part à la gestion de l’entreprise car il ne dispose pas d’un mandat du chef d’entreprise pour prendre de telles décisions. Il agit en effet sous la subordination du chef d’entreprise. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée dans le cadre d’une défaillance de l’entreprise.
Les effets du statut du conjoint salarié
En tant qu’affilié au régime général de la Sécurité sociale, le conjoint salarié a les mêmes droits qu’un salarié ordinaire, c’est-à-dire qu’il voit ses soins remboursés, qu’il bénéficie des indemnités journalières maladie ou accident du travail, du repos maternel et des indemnités correspondantes, d’une pension ou rente en cas d’invalidité ainsi que d’une pension vieillesse. En contrepartie de cette large couverture sociale, il doit payer des cotisations élevées, au même titre que tout salarié. Il peut également, en principe, prétendre à l’assurance chômage.
Le salaire versé au conjoint est déductible des résultats de l’entreprise s’il n’est pas excessif et qu’il correspond à un travail effectivement fourni. Dans les sociétés soumises à l’IS, le salaire et les charges sociales correspondantes sont entièrement déductibles. Dans les entreprises soumises à l’IR, le salaire est totalement déductible si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé. Actuellement, pour les non adhérents, la déduction annuelle est limitée à 13 800 € si les époux sont mariés sous un régime de communauté et elle est totale si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Attention :
à compter du 1er janvier 2016, la déduction intégrale du salaire du conjoint salarié adhérent à un organisme de gestion agréé est supprimée. Au même titre que les non-adhérents, la déduction annuelle sera limitée. Et cette limite a été plafonnée à 17 500 €.